Comment n’avions-nous pas deviné que le réalisateur italien Paolo Sorrentino était napolitain ?
Il y avait, pourtant, dans la filmographie du cinéaste, quelques indices.
Par exemple, cet Il Divo (2008) le plus grand film sur la politique du XXIe siècle. L’œuvre, scorsesienne, flamboyante et sarcastique, racontait la vie d’Andreotti, sorte de Mitterrand italien, démiurge de tous les scandales et intrigues de l’histoire parlementaire de la péninsule, navigant, comme un Borgia, entre les fantômes d’Aldo Moro, les soutanes pourpres du Vatican, et les demi-sels de la mafia. Le film, en réalité, était digne d’une peinture de Caravage — en clair-obscur gourmand, avec des trognes de malfrats et des capes de prince, d’une beauté épuisante et toxique, et Andreotti le patricien paraissait surgir, théâtral et reptilien, d’une Crucifixion aux rouges mats.
Et puis, ce « Loro », portrait subreptice de Berlusconi en héros presque houellebecquien dans sa villa de Sardaigne ; corps flasque mais désir tournant à vide, presque poignant ; intelligence cruelle et vertige du temps qui passe ; le film recelait une musique, cette fois plus légèrement ironique, sur les coulisses du pouvoir, l’intimité d’un seigneur maître de rien, qui semblait, tout à coup, s’élever des lignes d’un Malaparte croquant à l’oblique les paladins du mal à l’heure de leurs petits-déjeuners. Et dans ce roi sans royaume, ce glorieux croulant, ce truqueur mirobolant et, littéralement impuissant, passait déjà le profil d’un ange avili et infirme, obèse de sa légende raturée et de ses excès, Maradona le héros du FC Naples…
Rome, d’ailleurs, ne convenait pas spécialement bien à Sorrentino ; cette « Grande Belleza », qui fit sa renommée, paraissait compenser par un surrégime de paillettes la fatigue écrasée de ses personnages ; on se disait que Sorrentino semblait déplacé, dépaysé.
La Main de Dieu, film entièrement napolitain, film sur l’adolescence de Sorrentino, confirme ces quelques pistes. Le réalisateur livre – hélas, sur Netflix – son œuvre la plus pure et la plus ravageuse.
Autant l’avouer immédiatement, l’histoire de « La Main de Dieu » est ténue.
C’est un souvenir d’une enfance aux amis prodigieux ; l’évocation d’un été à nul autre pareil, celui de la venue de Maradona à Naples et celui de son but mythologique en Coupe du monde ; un portrait allègre et somptueux d’une famille impossible sortie d’Ettore Scola, des affreux, sales et gentils, qui déjeunent, font des farces, s’entre-déchirent et se réconcilient, une galerie explicitement Fellinienne de monstres irrésistibles, le père banquier communiste, la mère multipliant les canulars, les déguisements et les appels anonymes, le frère se rêvant acteur, la voisine aristocrate déchue couvant son fils retardé, la tante prenant le métro en compagnie de San Gennaro, le saint patron de Naples ; tous inoubliables et insupportables pour le héros, un jeune adolescent, Fabietto, qui, on le comprend vite, devrait se prénommer Paolo. Sorrentino exhume ces personnages prisonniers des années 1980 et d’une fine couche de poussière de laquelle ils bondissent, vivants, comme les emmurés en eux-mêmes des pentes de l’Etna et de Pompéi. Film d’initiation et de souvenirs, qui balance entre une nostalgie presque pagnolesque et une démesure sous le signe de Fellini – où les obsessions de Sorrentino sont versées pour le meilleur, comme sa fascination pour les corps chenus devenant une scène de dépucelage circassienne – l’auteur de « 8½ » apparaissant d’ailleurs le temps d’un casting, pour déclamer que la « réalité est moche »…
Et puis, à la césure du film, un drame atroce vient précipiter le destin de ce garçon lunatique ; il croise la route d’un réalisateur acariâtre, paranoïaque et vitupérant, qui le somme de choisir l’art, Naples et la vie plutôt que le chemin du deuil et du chagrin. La Main de Dieu devient alors aussi bouleversant et intime qu’un grand roman de Dickens – la route circulaire d’un orphelin vers la littérature ou le cinéma – un David Copperfield où les falaises d’Angleterre plongeraient dans les eaux émeraudes d’Ischia.
« La Main de Dieu » – c’est donc, celle, tricheuse et sublime de Maradona, qui oblique légèrement la trajectoire d’une balle pour la faire rentrer dans les cages, anglaises, dans le stade Azteca de Mexico. C’est la force impérieuse de la fatalité qui brusque le cours d’une existence innocente, celle d’un enfant choyé et protégé, pour le propulser dans le monde des adultes, celui du sexe, de la nuit, les contrebandiers du port de Naples qui boucanent jusqu’à Capri. C’est aussi, semble dire Sorrentino, cette falsification magique de la vie, celle qui permet d’altérer la réalité, moche, hideuse et tragique, en une sublime collection d’images. La Main de Dieu est un éloge, fellinien irrémédiablement, de la contrefaçon et de l’artifice, des grues de cinéma et des trucs de chefs opérateurs ; mais aussi un éloge, moins bruyant que chez Fellini, d’une grâce parfaite deux heures durant, de cette manière de bifurquer le réel ou de le recréer quand il s’est évanoui, qui s’appelle poésie. « La Main de Dieu », ce sont également les plaisanteries tendres de sa mère, ou ce son répétitif et chuintant, « pfiou…pfiou… » murmuré par un prisonnier, pour se souvenir du temps où il fendait les flots si vite que son navire volait au-dessus des vagues et faisait retentir cette musique presqu’imperceptible…
« T’as un truc à raconter ? », s’énerve le mentor du protagoniste – inspiré à Sorrentino par son modèle Antonio Capuano, lorsque Fabietto lui avoue son envie de faire du cinéma. Le héros, bouleversé, au terme d’une nuit d’échappée belle, lui confie son chagrin irrépressible, et sa frustration de n’avoir pas pu dire adieu à ceux qu’il aimait, de n’avoir même pas pu les voir avant de les enterrer. Le cinéma de Sorrentino trouve ainsi sa vérité, entre la foi dans l’artifice et la certitude, lucide et douloureuse, que même la représentation ne peut tout rédimer. Chez Michel-Ange, « la Main de Dieu » est naturellement un symbole – la puissance démiurgique du monde n’a ni index ni majeur. Le simple fait de figurer le destin par une main signifie que personne n’est dupe de ce que les hommes ont ainsi personnifié leurs angoisses primitives, de même que chacun des admirateurs de Maradona savait qu’il n’avait pas marqué dans les règles. C’est un mythe à l’envers, manifeste et évident, qui, comme chez Baudelaire, annonce lui-même son caractère fictif : « Larvatus prodeo » : j’avance masqué. Il s’ensuit un long et éprouvant cri – celui de Sorrentino, sommé de revêtir ce gant divin et infirme à la fois, battu d’avance par le malheur. Le trucage n’est pas seulement magique, comme chez Fellini, et optimiste, il est hanté par son impuissance à atteindre le point boréal de la douleur. Il faut pourtant le tenter, car c’est le drôle métier de vivre, et de créer. Alors, on peut entrer dans les lisières, magiques, d’un espace où le ballon rentre dans les filets, et où le cinéma ressuscite les morts. Le cri de Sorrentino trouve dans ce film son enveloppe la plus somptueuse : comme Maradona, la grâce ne s’empoigne pas, mais elle se frôle. Comme le hors-bord du personnage, le film glisse, propulsé, et caresse la surface de son étendue avec un toucher captivant, phénoménal, pfiou…pfiou…
« Nous croyions à l’époque que nous allions changer le monde, et c’est le monde qui nous a changés », s’avouent les personnages de Nous nous sommes tant aimés, un film de Scola tout aussi mélancolique sur une génération pleine de renoncement. Sorrentino n’a pas changé le monde par son cinéma, mais son cinéma l’a changé, jusqu’à retourner, plus pur, malicieux et virtuose, à cette scène inaugurale et palpitante, où tous les pouvoirs du cinéma, comme ses limites pourtant magiques, sont contenus.




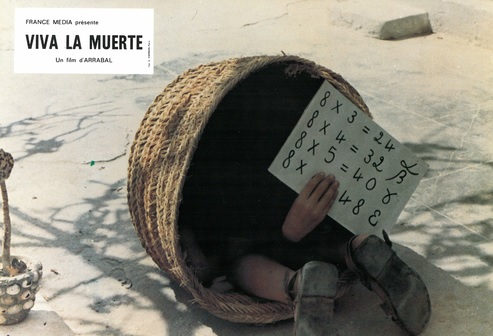



Netflix, « por desgracia », o la estupidez « intelectual.
Pourquoi: « hélas sur Netflix » ? Heureusement que Netflix existe pour produire des films et des documentaires de qualité !