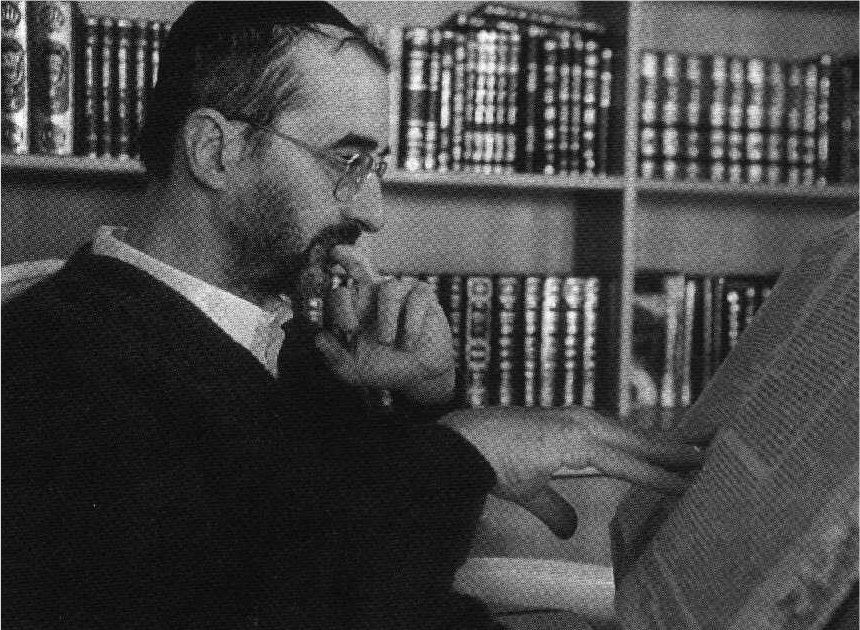Préambule
Je voudrais ici, touchan aux Profils perdus de Stéphane Mallarmé, técrire deux articles successifs, pour que s’y essaient deux voix différentes, afin de préluder à votre lecture ; l’une, pas tant exotérique que judiciaire, l’autre, pas tant ésotérique qu’intimiste. Ainsi, je parlerai d’abord du dehors de son livre, pour ménager un espace autour de lui, comme une haie contre les prédateurs qui passent (chez les hommes, c’est toujours la bêtise qui chasse) ; ensuite, je parlerai moins des idées ou doctrines du livre, que de sa façon, qu’on y sent (quand bien même, pour aider le lecteur qui se sentirait égaré, je me donnerai un temps de citation). Ensuite, il sera temps de le lire car, si je n’ai pas été trop mauvais, votre plaisir sera sauf.
Premier article : Le maître à penser
Savez-vous ce qui se passe quand un grand esprit s’empare d’une grande oeuvre ? Exactement le contraire de ce qu’on répute, touchant les grandes oeuvres et les grands esprits. On répute, dans les grandes oeuvres, des fumées, celles de l’encens des prêtres qu’elles réclament (virtuelles, donc, mais précises) ; celles, moins regardantes, des mystères sacrés, qui élit le génie pour des raisons extrêmement variées («sa lippe», «sa lèpre», «ses lobs», «ses limbes»…) ; une fois admis ce théorème, entrent en scène les grands esprits, dotés d’un cerveau-caïman, qui ouvriraient grand leur gueule et vous avaleraient tout cela d’un seul coup d’un seul, digérant tout, même les fumées.
Or les fumées prennent moins de place qu’on ne le voit, moins encore que les grandes oeuvres. Si bien que les grandes gueules n’ont nul besoin d’être si volumineuses, non plus pour ingérer que pour expectorer.
Voilà pourquoi Jean-Claude Milner, concluant ici sa longue lecture de Mallarmé, fait le contraire des tonitruants : il vient doucement saisir quelques fils fragiles comme le poète, et les dessine en croquis successifs et complémentaires, seulement retournés, pour certains (c’est-à-dire : remis à l’endroit) par la pénétration d’intelligence qui n’est possible qu’à condition de s’abstenir du culte.
J’ai deux exemples, parmi tant.
Dans Crise de vers : «vers il y a sitôt que s’accentue la diction» ; dans la réponse à l’enquête sur la poésie de Jules Huret : «Les jeunes gens, me répondit-il, qui me semblent avoir fait œuvre de maîtrise, c’est-à-dire œuvre originale, ne se rattachant à rien d’antérieur, c’est Morice, Moréas, un délicieux chanteur, et, surtout, celui qui a donné jusqu’ici le plus fort coup d’épaule, Henri de Régnier, qui, comme de Vigny, vit là-bas, un peu loin, dans la retraite et le silence, et devant qui je m’incline avec admiration. Son dernier livre : Poèmes anciens et romanesques, est un pur chef-d’œuvre.»
Ces deux citations ont été lues et relues par les professeurs, qui sont des gens honorables parce qu’ils se chargent des jeunes gens, comme Mallarmé, d’ailleurs, sembla le faire.
Mais l’honneur, comme le sérieux professoral, ne sont pas tout : il y a des moments où il faut trahir la bonne réputation, et pointer quelque stylet (non pervers, mais parce que c’est le monde qui l’est ; les gens très-sensibles, comme Mallarmé, le savent et l’enregistrent beaucoup mieux que les autres) ; en attendant des temps meilleurs, l’intelligence n’a pas d’autre arme.
Milner retourne le fil, donc : la couture était à l’envers ? C’est pire. Quand Mallarmé écrit qu’il «y a vers dès que s’accentue la diction», il fait parler – pointe Milner – la doctrine d’Hugo pour la mettre en pièces.
L’exercice d’admiration pour la jeunesse ? De la langue d’Esope – et, secrètement, le désaveu de ces auteurs de «chefs-d’oeuvre» qui ne font jamais qu’atteindre leur propre sommet. De fait, le poète, «en grève de la société», l’est surtout de celle des hommes de lettres.
Le reste est à l’avenant. Le livre de Milner réserve des surprises, ponctuelles mais décisives, frappantes et sèches – parce qu’un génie n’éclate qu’en scintillations, parfois en éclairs, mais jamais en gloire, parce que la gloire dure trop longtemps : on n’est jamais intelligent que par courts instants, courts comme un poète, comme un sonnet, comme un coup de dés ; – jamais comme une institution, comme ces décors qui s’éternisent.
Je terminerai donc ainsi mon premier tour de ronde, autour de ces profils perdus de Stéphane Mallarmé : congé donné aux fausses grandeurs. Au nom de la vraie – à la lettre près (celle de «l’alphabet» que vante le grand poète.
Tenez, en guise d’illustration : il faut lire l’excellente préface de Bernard Marchal aux Divigations, chez Poésie Gallimard, pour comprendre tout l’enjeu, si précieux, du petit livre ; là où Marchal, sceptique devant l’histrion Mallarmé, raconte que le poète en finit en fait avec «l’absolu», et invente, en somme, une littérature «pour les hommes», ledit Marchal montre qu’il n’a pas, lui, retourné le fil – et nous ne le lui reprocherons pas. Ce sont des gestes qui offusquent tellement les professeurs et les commentateurs (comme tel linguiste rencontré cet été, admirateur de Bourdieu malgré le jardin sublime où il était convié, et qui, au seul nom prononcé de Milner, vibra d’une réprobation si sincère qu’elle vous désarma ; sincère comme le pastis) !
Et pourtant, il faut savoir les accomplir.
On répondra ainsi à M. Marchal, par-dessus son épaule, «… Mais, cher M. Marchal (on sera aimable et même gêné, car vraiment, il n’y est pour rien), croyez-vous que ce mot “d’absolu” ait simplement l’esquisse d’un sens, comme l’aurait aussi cet “Azur” des autres zozos ? Ne saviez-vous pas qu’à se détourner de l’absolu, c’est non Mallarmé, mais toute la maison Gallimard qui s’est vouée ? “L’absolu”, cher Monsieur, est un mot tout juste bon pour les commerçants, et leurs obligés, les hommes de lettres de leur écurie ; quant au “deuil de l’absolu”, c’est une bondieuserie de la religion littéraire, tout juste bonne à faire du chiffre – mais pas de la lettre.
Non, Mallarmé ne crée pas, derrière lui, la littérature, après avoir abattu l’aile cramoisie de l’absolu. Car tout de même, cher Monsieur, vous admettrez qu’il y a ici un fait troublant : à savoir que la fin de votre préface, que je vous ai résumée, est l’exacte synonyme (si on ose ainsi rapporter à un seul mot la totalité de votre texte, ainsi que Mallarmé, lui, fait un seul mot de tout son vers) de la quasi-totalité des préfaces et des études consacrées aux grands auteurs et aux grandes oeuvres, à savoir que tout finit, enfin, finalement, par le triomphe de la littérature – si bien que vous faites de Mallarmé un idolâtre parmi tant d’autres – ou plus exactement, à l’égal (mais pas plus) d’André Gide et de Jean d’Ormesson, un habitant de la maison Gallimard, maison de Littérature, qui s’y est entièrement destinée depuis son premier jour.
Mallarmé n’est pas un «auteur Gallimard». Au contraire, comme Hugo il met d’avance en pièces la maison Gallimard, qui publiera pieusement son Coup de Dés, merci à elle ; son vrai maître à penser, le glorieux Paul Valéry, avait d’ailleurs suggéré à André Breton les deux titres-clés des revues surréalistes : Commerce et Littérature – commerce parce qu’on a besoin des autres, de cette camaraderie des gens de lettres (cf : “Je suis un solitaire”), et littérature parce qu’il faut bien donner à la camaraderie quelque motif se s’agréger (cf : “le hasard” – soit, en définitive, le refus des illusions consolantes.)
A quoi Mallarmé répond, abruptement, par deux mots qui n’ont pas cours chez Gallimard : pensée et poésie.»
Deuxième article: L’ombre d’un poète
Rendre visite à Mallarmé
J’ai participé à une rencontre. Cela n’arrive quasiment jamais. Surtout avec les morts, et que dire des gens glorieux qu’on ne rencontre pas, puisque chez eux on rencontre la pellicule qu’on nomme, en société, gloire.
Moins encore on ne rencontre les vivants – parce qu’ils ne savent jamais sur quel pied danser avec ce Purgatoire social sans purgation ; car cette épreuve de la foule sociale, de quoi nous délivre-t-elle, nous accablant de ses devoirs, de ses augmentations, de ses réseaux, bref, de cet immense mycélium dont nous devenons les champignons, sortis une nuit humide d’un ploc, et tentant d’en compenser furieusement la honte par tout le bruitage possible ?
On ne rencontre pas dans le bruit ; on rencontre avec le silence, qui soudain reçoit un supplément.
Il fit donc, ce rencontreur, ce qu’il put avec un mort, si bien que tout s’en est déposé comme la lie – tout, à savoir ce qu’il fit, ce mort, à défaut de qui il fut ; advint pourtant, heureuse nouvelle, une rencontre.
Je veux dire ici que M. Mallarmé fut enfin rencontré par un de ceux, innombrables, qui ont écrit sur lui. Rencontré, enfin visité, car il était bien seul et ne s’en plaignait pas ; oh non, il n’avait pas été visité par ses petits élèves aux mines savantes, qui ne cherchaient, y compris les bougons, qu’à s’embellir, soit s’éclairer, se composer de feux au midi de sa fréquentation.
Ils le croyaient glorieux, et le furent ; l’étant, ils l’avaient laissé au bord de la route, et ne s’en souciaient guère.
Et encore, je ne parle pas des malins qui, à grands renforts de déclarations, dirent le fréquenter post mortem : c’étaient des hommes de lettres, soit le contraire d’un poète. Chacun sa place, tout de même.
Puis vinrent les professeurs – sinistre cortège tout juste bon à panthéoniser.
Une visite rendue à Mallarmé, belle nouvelle pour quelques uns ;
c’est une toute petite visite, mais c’est pourquoi – plus longue, tout aurait été perdu – elle suffit à vous remplir d’amitié, cette substance rare que moi je recueille chaque fois que je vais voir un certain vieux peintre ou certain peintre un peu plus jeune, que je désigne anonymement pour le seul plaisir de réveiller en moi le sentiment intime qu’aucune nomination n’égalera jamais ;
visite rendue comme on rend une politesse : celle, extrême, excessive, des phrases de Stéphane, – tantôt vers, tantôt prose, toujours poésie, soit, seule définition qui n’en soit pas mortelle, faites, avec tant de tact et d’amour de la langue. D’amour vrai, s’entend, ce qui ne s’entend plus, désormais, pas plus qu’amour, pas plus que langue – du moins, la française, défigurée par sa droite, par sa gauche et par son centre.
Visite de courtoisie si élégante et si légère qu’elle me permit, à mon tour, de lui avoir rendu visite. Pourquoi ? Savez-vous comment il s’y prit ? Il y a là une opération, ou modalité, secrète, d’apparence aisée mais d’art difficile, qui joue un très grand rôle : en ne disant pas tout. C’est un art que certains, dans le monde, pratiquent depuis quelques millénaires ; à eux s’oppose l’idolâtrie en général, et la caste littéraire en particulier, qui ne sait prendre au sérieux que la nudité, et ignore que le couvrement, avant d’être érotique, est la condition absolue pour qu’advienne ce qu’on appelle imprudemment un homme ; si bien que très peu, sur ce continent adverse, tentèrent de le rencontrer (je parle de l’homme, ou, plus exactement, d’un homme.)
Et pourtant, il s’est trouvé bien là, à l’occasion de cette visite, présent et bienveillant, calme, sage, intelligent. Pas trop – tout de même, pas trop intelligent.
Car un homme n’est pas sa photographie, ni son portrait en gloire, ni sa mise en fiches, en friche, en pièces, bref, en volumes universitaires par ses thuriféraires idolâtres si chers à feu James Joyce.
La condition, pour qu’il soit un homme (qu’il soit, et je n’ai pas dit qu’existe, car c’est, à côté de cette visite, une bien grossière finesse, sinon ficelle, que l’existence), c’est qu’on l’appréhende par son ombre. Oui, il n’est pas d’homme de face, pas d’homme d’en face, pas d’homme en majesté – ceux qu’on nomme par exemple les théoriciens, l’un parmi les masques sociaux qu’arborent ceux, pour reprendre le mot merveilleux d’un ami que rien n’arrache à son art propre, qui se montent le bourrichon.
Guide de la visite
Certains voudront un guide, non parce qu’ils sont flemmards, mais parce qu’il n’auront pas confiance, tout à fait, dans ce que j’ai annoncé. On a tellement l’habitude de lire par habitude, de sorte que rien ne se soit passé quand le livre se referme, et qu’on s’en contente, en somme, car après tout, il vaut mieux que rien n’advienne, plutôt qu’advienne un malheur, et toute surprise recèle sûrement un malheur ; or j’ai parlé de visite, donc j’ai parlé de surprise. Pour assurer qu’elle a eu lieu, je reprends au picaresque son art du très long titre, qui permet de vérifier que des évènements ont lieu, de sorte qu’on pourra regarder ce qui compte, les phrases et leurs phases, les stases, enfin, où s’ouvre la pensée.
(A lire, si possible, à la Jouvet, qui annonce la marchandise) :
Chapitre 1, les constellations : de la désuétude complète des cartographies célestes, passant sous la férule de la physique moderne ; de ce fait, une élucidation des constellations mallarméennes, et une première doctrine du vers, «spirituel zodiaque» ; enfin, du compte dont se fonda la mathématique, et qui importe au poète.
Chapitre 2, le Joueur : de ce que le vers fut d’abord pensé comme l’art de produire un seul et long mot où se répare le hasard des mots, entendus comme ces sons qui importent tant au poète ; puis, de ce que cette tâche, d’abolir le hasard, s’oppose par essence à cette confiscation de toute expression au bénéfice du vers, par le ci-devant Hugo, car tout chez lui, toute littérature, toute prose est rabattue sur le vers, ce qu’on sait, ma foi, fort bien si on a des lettres, mais qu’on aura toujours d’autant plus mal compris qu’on aura plus de lettres (si bien que Mallarmé est exactement l’adversaire de Hugo, dont il ne sera pas dit, qu’on se le dise, le fin mot) ; d’où l’on arrive à ce que le vers ne pense pas, car seule pense la prose. Puis, de ce que la foule et le hasard sont une seule et même chose, et de ce que la foule n’est pas regardée par le vers, qui seul s’en prend au hasard dans la langue ; d’un essai d’abolir la foule par le Livre, puis du renoncement au livre mais non à la poésie ; enfin, de l’invention d’une poésie qui, en définitive, pense.
Chapitre 3, le Linguiste : d’une élucidation renversante du sonnet en X, où tout se suspend, comme chacun sait, à nul ptyx ; seulement, de ce que nul ptyx est ramené à ce qu’il est effectivement, à savoir l’acrostiche de toutes les familles phonématiques des langues indo-européennes, alors tout juste découvertes ; puis de ce que ce Mot de tous les mots de toutes les langues (indo-européennes, c’est notable, car il en est d’autre) servira au «Maître» (de maison) à bâtir le seul tombeau digne d’Anatole (qui, d’ailleurs, signifie le lever de tout astre, voir chapitre 1.)
Chapitre 4, le Fondateur d’institutions : de ce qu’il s’est agi, comme il a déjà été mentionné plus haut mais dans une autre perspective, de chasser le hasard de la foule en fondant l’institution du Livre – et de ce que, en passant, Mallarmé se révèle là comme le seul poète politique de son temps – ; du rôle que joue le Coup de dés dans cette tentative, et de ce qu’il s’ensuit, finalement, un adieu au politique.
Chapitre 5, l’Homme double : du poète, du poète Stéphane, veux-je dire, parlant de la société d’une part, et des poètes et de leur société, de l’autre ; de ce que le poète, en grève de la société, l’est tout autant, quoiqu’en une fine journée des dupes (l’enquête de Jules Huret) de la caste des poètes (que Stéphane raille si finement qu’elle ne peut que se féliciter d’être si délicatement louée, et lui aussi, d’être tout seul, vraiment seul, et libre de cette gangue atroce dont une caricature brueghelesque s’appelle aujourd’hui Saint-Germain-des-Prés.
Chapitre 6, le Sociologue cruel : des proses du poète qui, en grève contre la société avons-nous dit quoique dans une autre perspective, thématisent différents effets de ratage que l’on constate immanquablement dans la foule, qu’elle soit miséreuse, politique (la Commune, nom vulgaire de la Pénultième), puis, dans une version plus subtile de la foule, qui s’appelle le Camarade dont le poète pourrait bien voir son propre double, ou mieux, son ego sans alter, sinon qu’il chercherait une image de soi – partant, appartiendrait à la foule.
L’ombre regagnée
Car, maintenant que vous voilà rassuré et que vous pouvez, en toute inquiétude, acheter ce livre et le lire, vous savez qu’autre chose qu’une ombre a été montré là ; qu’on n’aura pas, dans ce livre, tourné autour de la nuit comme ce pauvre Mallarmé. Au contraire, on aura produit, en clair-obscur, une série de profils tirés à la ligne de Mallarmé comme les poissons d’or de Debussy sont pêchés à son ruban pianistique ; dessins et portraits en mots sur mots celant la face et parlant de côté, profils dépareillés, traits non-concentriques, pas nerveux et obstinés comme ceux d’un Giacometti, mais d’une seule ligne, certaine, et sûre d’être partielle, pourtant finie, taiseuse – à l’imitation de l’absente de tout bouquet.
Cela, afin que l’essentiel soit sauf. Non, pas moi. Ni le génie. Ni la Grande Oeuvre.
L’ombre.
Dans l’ombre de Mallarmé, une autre ombre est tapie ; elles ne sont pas consanguines, pas plus qu’elles ne copulent dans quelque excitation qui les verrait jouir de l’abomination de la bête à deux dos – je dis l’abomination du commentaire. L’une, au contraire, s’abrite de l’autre, et l’ombre s’épaissit. Je tais le nom de celui qui vint, parce qu’il est précieux à cet instant précis, où il a levé non seulement le mystère de quelques phrases de Mallarmé, mais le secret de misère, de bonté et de fragilité si pure qui offrit au petit homme malodorant ses effluves de vie – et à son visiteur, l’occasion de marcher sur la terre.
Reste la littérature – elle n’a aucun intérêt.
Sinon, un jour, parfois, par exception, la phrase d’un poème.