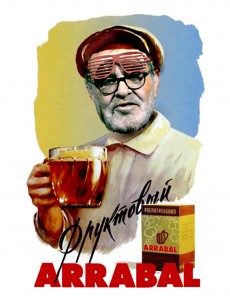Le théâtre est toujours un éphémère, un gaudeamus et parfois une catastrophe qui, depuis la première fois, sans raison, m’a donné jour et nuit, et m’offre çà et là, toutes les satisfactions que peut connaître un poète dramatique. Parfois, spontanément, des acteurs inconnus m’écrivent «très cordialement». Le message le plus récent est celui qui me dérange et me passionne le plus.
Sans que je le mérite, il semble que «sur mon théâtre, le soleil ne se couche pas». C’est ce que les universitaires et les étudiants me disent généreusement lorsqu’ils m’accordent la faveur d’étudier et d’analyser mes modestes pièces. Parfois on dit à juste titre que les auteurs de ces enquêtes complexes (les «thésards») «soutiennent» leur thèse, alors que dans d’autres pays ils la «défendent». Dois-je aux «thésards» comme aux «théâtreux» qui m’écrivent, motu proprio, de ne pas avoir disparu ?
Combien je leur dois à tous, comme à mes professeurs, et surtout à l’inoubliable mère Mercedes ! Adolescent, je pensais, et mon entourage le confirmait, être un dessinateur ou un peintre. En tout cas, c’était ma première et presque unique tâche. Je répétais, euphorique : «Je serai peintre» comme mon père «qui à la prison de Burgos…».
C‘était à l’écriture que je consacrais le moins de temps. Parfois, je composais des «choses», des dialogues, presque toujours pour attirer l’attention de ma mère. L’année de la comète, j’ai appelé ma première pièce Pique-nique en campagne, qui deviendra Pic-nic. Je ne sais pas pourquoi, dans les lieux les plus reculés, on peut «mettre» en scène, par exemple ce Pic-nic ou Le tricycle ou Fando & Lis... Qu’ont donc ces pièces pour être présentées aujourd’hui ou demain, à Tegucigalpa ou Tatanarive ? Pourquoi les Coréens de l’extrême nord, rien de moins, ont-ils pu m’éblouir à Moscou avec leurs adaptations des textes de mon adolescence, comme tant de villes proches de nous où j’aime à présent assister à leurs précieuses représentations d’amateurs ?
Je ne sais pas pourquoi généralement on se souvient aussi maladroitement que par erreur, mais je pense et je suppose sans aucune malice, de ma première première, urbi et orbi, qui s’est déroulée à Madrid. Je pense qu’il ne reste presque plus personne parmi ceux qui y ont assisté. Les mieux inspirés, souvent de bonne foi, affirment aujourd’hui que l’auteur (c’était moi-même il y a 62 ans, à 25 ans) devant tant de colère et les trépignements assourdissants du public avait quitté la scène, abattu, pour se rendre à Paris.
En réalité, j’étais déjà à Bouffémont (France) depuis 1955 et, bien sûr, mon expatriation n’avait rien à voir avec la réception du Tricycle le 16 janvier 1958 à Madrid.
J’étais tuberculeux, dans un sanatorium français, quand j’ai appris la nouvelle incroyable : celui qui était pour moi le meilleur groupe espagnol (Dido) allait présenter ma pièce dans l’un des plus beaux théâtres de Madrid : Les Beaux-Arts. La grande salle n’avait-elle rien à voir avec celle qu’on appelle ainsi aujourd’hui. Alors Dido, précisément, jouait le meilleur théâtre du monde en faisant connaître depuis Eugen Ionescu jusqu’à Samuel Beckett. À 25 ans, j’étais associé à de tels précurseurs et à ceux que je considérais comme les meilleurs acteurs de cette époque, tels que Victoria Rodríguez.
Les moins complaisants entendirent des cris et des trépignements là où, plus qu’ému, je n’entendais qu’une ovation unanime.
Josefina Sánchez Pedreño – j’espère qu’à son occultation Pan l’a conduite vers le soleil – était une femme exceptionnelle qui compte et a compté dans ma vie autant que la Mère Mercedes. C’était une personne intelligente et courageuse qui m’a littéralement fait sortir de la prison de Carabanchel… Pour donner une idée du succès public qu’a remporté le théâtre, elle et sa petite amie racontaient comment le grand dramaturge espagnol («le plus titré», selon tous) Don Joaquín Calvo Sotelo de l’Académie Royale Espagnole de la Langue et Grand Croix de l’Ordre d’Isabelle la «Católica», est apparu dans l’espoir de voir ma pièce. Mais malgré ses triomphes constants en tant qu’auteur et sa popularité d’hermanísimo-del-proto-mártir [le superfrère du martyr par excellence] rien ne lui a permis d’obtenir une place, et on a dû lui dire qu’il ne restait pas une seule entrée.
La critique hostile dans le journal phalangiste Arriba du romancier Don Gonzalo Torrente Ballester (prix du Prince des Asturies en 1982 et du Prix Cervantès en 1985) a été largement diffusée. Je pense qu’en toute conscience et honnêteté, il n’a pas aimé du tout mon théâtre. Quelques mois plus tard, il n’appréciait pas davantage le texte de Samuel Beckett ni la traduction de Fin de partie faite par ma femme.
Ma première création à Paris a eu lieu quand j’avais 26 ans au théâtre Lutèce sous la direction de Jean-Marie Serreau. La majorité du public et certains critiques n’ont pas aimé le duo que Bertolt Brecht et moi avions formé. Certains qui ont bien voulu ne pas trop me citer ont condamné l’auteur allemand. Cette fois, aucun grand dramaturge n’a essayé de se présenter. Anouilh, par exemple, a appris mon existence (comme la plupart de mes futurs collègues) à cause de mon incarcération à Madrid. Incidemment, il a très généreusement tenté d’intercéder pour ma libération en demandant à son «ami» le nonce de Sa Sainteté (qui deviendrait pape) d’intervenir…
De ma première première à New York dans un double spectacle avec The Zoo Story, il me reste très peu de souvenirs. Le producteur était très fier (à ma grande stupeur) de créer, comme à Paris, un théâtre «misérabiliste pour deux œuvres très très misérabilistes». La première fois que j’ai vu mon co-auteur, Eduard Albee, au contraire, il m’a semblé même (à tort) avoir «une» main manucurée. Plus tard, lors d’autres visites à New York, son agent m’a raconté certaines de ses aventures violentes qui n’avaient rien à voir avec ma première impression.
En réalité, j’ai toujours été un ami proche des collègues que je connais ou que j’ai rencontrés. Je pense que tout le monde ou presque (à l’exception de ceux qui m’ont banni sur ordre du «parti») m’a défendu quand j’étais en prison. Arthur Miller, à la dernière page de ses souvenirs Timebends, a déclaré : «F.A., c’est un auteur de la plus haute importance et l’un de mes préférés depuis longtemps», Samuel Beckett a écrit aux juges en 1967 : «F.A. devra beaucoup souffrir pour écrire… que. F.A. soit rendu à sa propre douleur». Le contraire est vrai en politique. Le grand ennemi des staliniens au pouvoir; étaient-ce les Troskistes ? Celui des SS, les SA ? De César, Marcus Junius Brutus Cæpio ?
Un groupe d’acteurs m’informe cordialement sous le titre : Un désastre pour le métier.
«..tous les théâtres du monde sont presque toujours ouverts. Mais les plus officiels sont fermés plus de la moitié de l’année. Leurs directeurs ont-ils des privilèges interdits au commun des “théâtreux” ? Ils se permettent le luxe de ne pas lire les grandes oeuvres des poètes dramatiques; par exemple, hier; ni Beckett, ni Adamov (etc. etc.) n’ont réussi a être au moins refusés par ces grandes institutions qui n’ont même pas encore aujourd’hui de comité de lecture. Les Thomas Bernard ou les Albee nouveaux se trouvent dans l’impossibilité de voir leurs pièces lues et jugées comme le font sans problèmes tous les éditeurs, depuis les plus grands jusqu’au plus modeste. Le théâtre est paralysé : il reste totalement et obstinément fermé aux nouveaux poètes. Au mieux l’un des salariés se déguise en auteur. Pourquoi cette mise à l’écart des poètes dramatiques ? Pourquoi cette exception flagrante ? Cela des années après que les Ionesco, les Antonin Artaud n’ont réussi qu’à trouver des théâtres “très très misérabilistes” dirigés par des non-salariés pour commencer à exister… Personne ne s’en soucie… ?»
La vérité est que je m’en soucie trop. Mais il serait indécent que… je… me… plaigne.