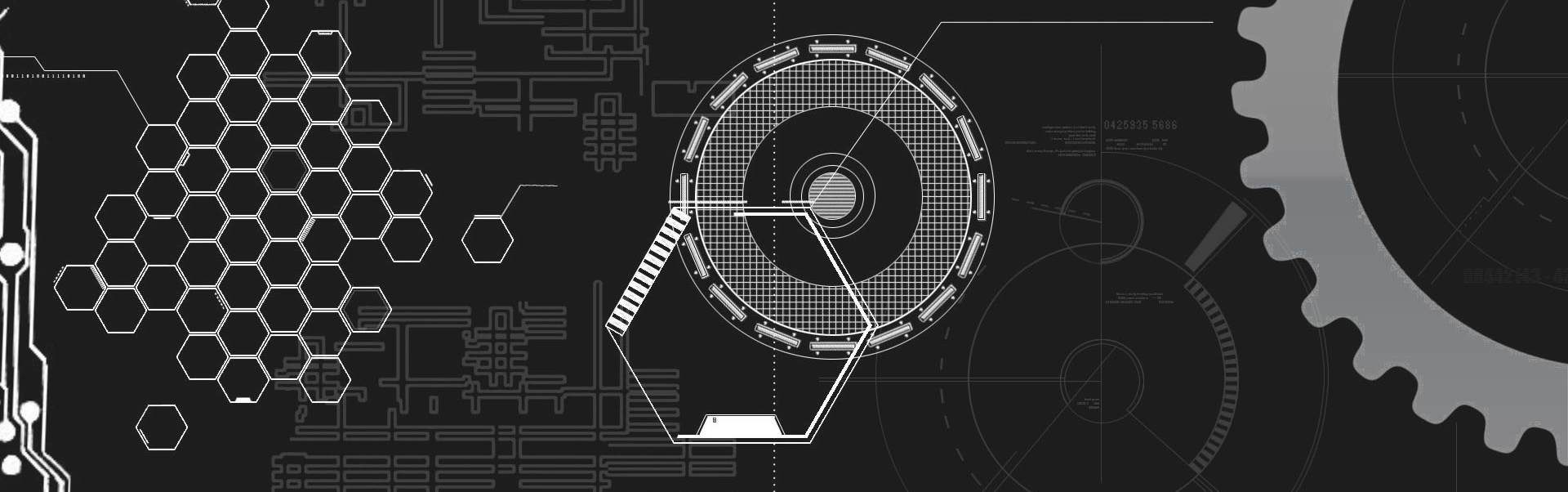«La toute première chose dont je me souvienne, dans ma prime enfance, c’est d’une flamme, d’une flamme bleue d’une cuisinière à gaz que quelqu’un venait d’allumer.» Ainsi Miles Davis amorce-t-il le premier chapitre de son autobiographie, co-écrite avec Quincy Troupe en 1989. «Cette peur était comme un défi, une invite à aller de l’avant, vers quelque chose dont j’ignorais tout.» L’anecdote symbolise à merveille ce qu’a été la vie de cette personnalité hors du commun.
Il naît le 26 mai 1926 à Alton, Illinois, dans une famille de la bourgeoisie noire, puis passe son enfance à East Saint Louis. Son père est dentiste, son grand-père comptable, et chez les Davis on n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Les gentilles risettes pour plaire aux Blancs n’entrent pas dans les us et coutumes de la maison, surtout en un temps où la folle haine raciste poussait encore, comme en 1917, à pendre des Noirs à des réverbères. La dignité, dans l’attitude des Davis, se rapproche plus de la célèbre formule que clamera plus tard l’écrivain James Baldwin et futur ami de Miles : «Je ne suis pas votre nègre.»
Autant le langage de l’homme était cru, ponctué de «mother fucker» – ce qui dans sa bouche pouvait être un compliment –, autant le jeu du musicien était fin, sensible et mélodieux : «Pourquoi jouer tant de notes, alors qu’il suffit de jouer les meilleures ?», interrogeait-il de sa fameuse voix brisée.
Il faut dire que dès l’âge de treize ans le jeune trompettiste apprend les subtilités de son art à Saint Louis, ville dans laquelle il se perfectionne en intégrant divers groupes, se forgeant rapidement une bonne réputation locale. Mais c’est en 1944 qu’un événement va bouleverser sa vie. Le Big Band du chanteur Billy Eckstine vient jouer au Riviera Club cette musique qui révolutionne alors le monde du jazz : le bebop. Et l’interprète ne s’entoure pas de tocards : Dizzy Gillespie à la trompette et Charlie «Bird» Parker au saxophone, c’est-à-dire les ceintures noires du genre. Entendre ces deux pointures va créer chez Miles Davis ce qu’il nommera «la plus grande émotion de ma vie tout habillé». Dès lors, partir à New York et les retrouver devient pour lui une obsession. Son père accepte de l’inscrire à la prestigieuse Juilliard School new-yorkaise afin qu’il y poursuive des cours de musique classique. En fait, tous les soirs Miles passe son temps à rechercher les deux compères novateurs dans Harlem, au Minton’s Playhouse et dans les clubs de la 52ème rue. Il revoit Dizzy mais Bird est introuvable. D’ailleurs, le loustic en question – aussi doué soit-il –, ne sait pas forcément lui-même où il sera le lendemain. L’héroïne s’invite dans ces clubs très hip et Bird ne se prive de rien. Une fois Charlie Parker retrouvé, Miles entre enfin dans cette formation créative et se fait un nom dans le mouvement bebop dès l’automne 1945.
Très vite, le jeune passionné désire plus. Il lui faut son propre style et sa voie à lui. Atteint de ce que Bachelard appelait «le complexe de Prométhée», Miles s’empare du feu de ses maîtres. Il veut faire autant, et même davantage. En 1948, il fonde un «nonette» (ensemble de neuf musiciens) et choisit le saxophoniste blanc Lee Konitz, dont le jeu léger contraste avec le son traditionnel du bebop dur. Miles invente un univers plus doux et des lignes harmoniques faciles à retenir. Le «cool jazz» est né. Il enregistre en 1949 un album déterminant mais qui ne sera publié que plusieurs années années plus tard, «Birth of The Cool». En 1956, il créé son premier grand quintette avec John Coltrane au sax, Paul Chambers à la contrebasse, Philly Joe Jones à la batterie et Red Garland au piano. La formation est prolifique, chacun joue comme un dieu et les chefs d’œuvres se succèdent chez Columbia et Prestige. C’est l’époque «Hard bop».
Mais Miles n’en a jamais assez et il a une nouvelle idée en tête : rendre sa musique plus flexible, utiliser des modes africains et orientaux. En 1958, il lance le «jazz modal» (très inspiré par son nouveau pianiste Bill Evans) et sort en 1959 «Kind of Blue» : les grilles d’accords habituelles et complexes explosent au profit d’une plus grande liberté d’improvisation. Le disque est à ce jour encore considéré comme l’album de jazz le plus célèbre de tous les temps.
Le moment le plus dangereux pour un musicien est souvent celui de la réussite. La tentation est grande de se figer dans ce qui a fonctionné. Le risque alors est de se répéter puis de lasser le public. Miles, devenu star, en était conscient et il n’était pas question pour lui de s’empoussiérer dans un style. En 1963, il découvre Tony Williams, un prodigieux batteur de dix-sept ans, et ne choisit désormais que des musiciens plus jeunes que lui, dont le pianiste de vingt-trois ans Herbie Hancock.
A la fin des années 1960, la musique populaire devient électrique. Le monde aussi. C’est l’époque du Mouvement pour les droits civiques, des mobilisations contre la ségrégation dans le Sud. Malcom X et Martin Luther King sont assassinés. Les Black Panthers se constituent. Jimi Hendrix dynamite son morceau «Fire» à Woodstock avant de distordre l’hymne américain en opposition à la guerre du Viêt-nam qui fait rage. Les hélicoptères «Huey», utilisés par l’armée US contre les troupes de Hô Chi Min, deviennent la cible d’un rock moderne et sont visés par les guitares Fender. Inspiré par cette ambiance chauffée à blanc, Miles troque ses élégants costumes italiens contre des vêtements colorés au nouveau goût du jour dans la jeunesse contestataire, et utilise orgues, pianos et guitares électriques. Il se lance dans des expériences rock et, dans «Silent Way» mais surtout l’album «Bitches Brew», génère des sonorités jamais entendues jusque-là. Les réactions des critiques de jazz, auparavant élogieux, deviennent incendiaires. Ainsi ce pauvre Stanley Crouch ira jusqu’à écrire : «Miles, le vendu le plus remarquable de l’histoire du jazz.» C’était comme si le compositeur venait de verser du napalm sur leurs certitudes. «Miles aujourd’hui prêt à se prostituer comme il prostituait les femmes du temps où il était toxico», lira-t-on même. Miles n’en a cure. A ses musiciens, il ne donnait qu’un mot d’ordre : «Joue !» Et «Bitches Brew» fut un succès, au point que la formation se produisit au très rock festival de l’Ile de Wight en 1970.
Les conservateurs sont prévisibles dans la mesure où ils restent collés à leurs habitudes, cloîtrés dans leur passé. Or le jazz est une musique d’adaptation, d’intrépidité et de surprise. Les critiques, se sentant soudain vieux, se comportaient comme ces réactionnaires d’aujourd’hui dont parle Michel Serres dans son dernier essai au titre ironique, «C’était mieux avant». Le philosophe rappelle qu’avant, c’était Staline et les goulags, Hitler et les camps d’extermination, les maladies, la mauvaise hygiène. Mais Miles Davis se moquait bien des «Grand Papa Ronchon», comme Serres les nomme de manière générique. Il combattait cette tendance naturelle à regretter ses vingt ans, recherchait en permanence la nouveauté créatrice, restait à l’affût de jeunes musiciens capables de le dérouter. Il les défiait et se voulait défié à son tour. Ses récompenses décernées par la profession musicale ? Elles étaient rangées en vrac dans un placard qu’il n’ouvrait jamais. Sûrement pensait-il qu’il n’y a pas d’avenir pour celui qui ne conjugue ses verbes qu’au passé.
Bien sûr, l’urgence de vivre lui joua parfois des tours. En 1975, les excès en tous genres, associés à une maladie des hanches et son diabète, interrompirent quelques temps sa carrière. Il revint, affaibli, en 1981 et donna plusieurs concerts, notamment à l’Avery Fisher Hall, le 5 juillet. Il ressemblait alors à ces héros brûlés dont on soupçonne la fin tragique et imminente. Qui aurait cru à ce moment précis que le trompettiste était en train de souffler sur des braises enfouies sous ses propres cendres, qui n’attendaient qu’à reprendre feu. Et le feu reprit. Tel le phénix, non seulement le musicien renaquit, mais il aborda les années 1980 à bras le corps pour s’aventurer dans des grooves plus funky que jamais, admirant désormais Michael Jackson et Prince. Il s’entoura de nouveaux complices, comme le jeune bassiste Marcus Miller, au talent diabolique, dont la technique de «slap» était déjà à se damner. Il s’imposa une discipline physique et se remit aux tournées. Les albums s’enchaînèrent, dont le fameux «Tutu», en 1986, en hommage à l’évêque sud-africain Desmond Tutu. Ce fut une réussite, et Miles conquit de nouveaux fans.
Son jeu, à la fois suave et percutant, était au summum de son art. Sous les projecteurs, il fallait le voir se pencher de temps à autre sur sa trompette rouge pour laisser durer une note, la sueur coulant sur sa peau noire ébène. C’était l’instant où il n’avait plus besoin de porter le masque de la dureté. Puis, lorsqu’un de ses instrumentistes, comme le saxophoniste Kenny Garrett, improvisait un solo qui touchait le miracle émotionnel, – ce fameux «orgasme spirituel», pour reprendre la formule du célèbre guitariste Carlos Santana évoquant ce qu’il avait éprouvé à l’écoute de Miles Davis –, on sentait dans l’allure du trompettiste un mélange de fierté et d’évidence qui sous-entendait «ben oui, quoi, ce gars c’est ma découverte». Son dernier album, «Doo-Bop» sortit six mois après sa mort. Le compositeur y expérimentait cette fois tous les styles… du hip-hop. Il est loin le temps où la flamme de la gazinière effrayait le petit garçon, mais celle allumée par le génie Miles Davis, continue, vingt-sept ans après sa mort, à éclairer le chemin de nouvelles générations.