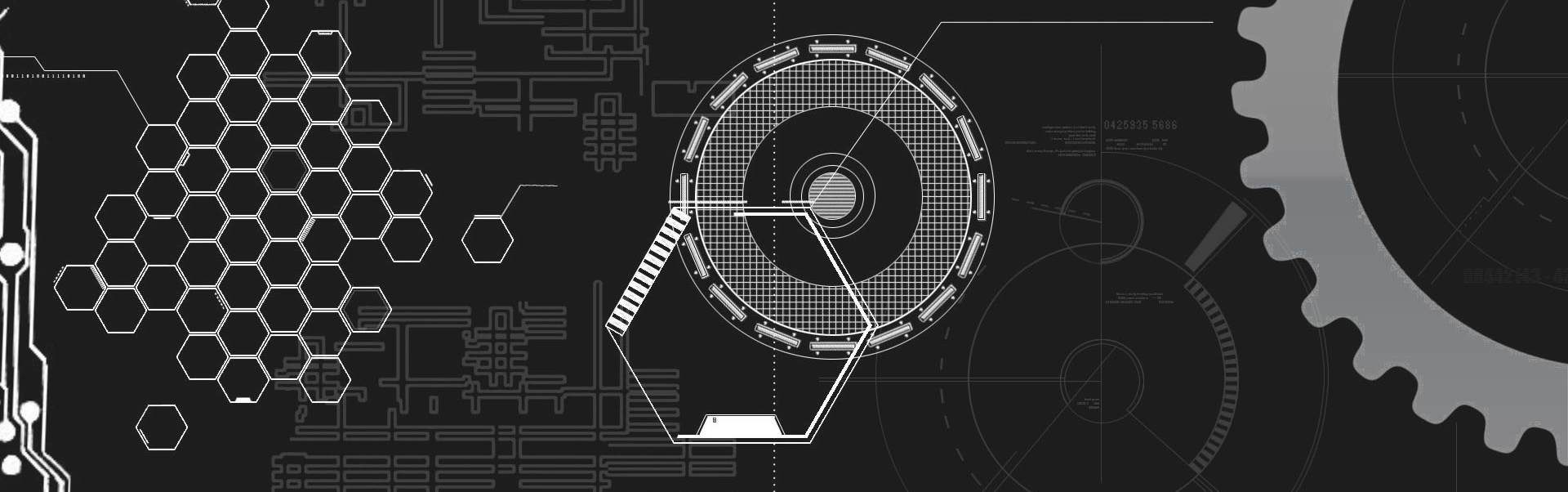John Coltrane. Répétez lentement ces syllabes et laissez quelques notes familières vous envahir. Un son divin monte, l’exaltation des premiers jours. L’impression que l’on touche à l’un de ces génies hors du temps, à l’un de ces bâtisseurs d’émotion qui sont la raison de notre être au monde. Ces notes vous emmèneront ailleurs. Un voyage au bout du jazz, autrement dit ; au bout de la souffrance humaine. La musique noire pour incarner l’Amérique. Un mythe ? La trajectoire de Coltrane prouve le contraire. Un jazz façonné par l’intelligence, sensible, spirituel. Il faut une écoute attentive, celle qui prend son temps, pour saisir la dynamique des sons. Alors le temps – la perception du temps et son ancrage –, usant même les plus résolus d’entre nous, fait son œuvre, rend son verdict, abat sa sentence. Et Coltrane le sait ; c’est pourquoi il accélère. Accélérer l’Amérique, accélérer la réalisation de son idéal d’indifférenciation, et donc d’égalité, dont Sartre, en 1945, voyait les prémisses entre les gratte-ciel de New York.
On a ici un album perdu, ou du moins que l’on croyait tel. The Lost Album, Both Directions at Once. Il sort de l’ombre, comme une nouvelle salle exhumée dans la pyramide de Khéops, selon la formule de Sony Rollins, grâce au label Impulse! et à la famille de Naima (de son vrai nom Juanita Grubbs), première épouse de Coltrane. Enregistré le 6 mars 1963, chez le grand ingénieur du son Rudy Van Gelder, cet album constitue un événement. Entendons-nous sur le sens du terme. Idée immédiate : l’imprévisible, l’inouï, ce qui rompt le devenir du monde, ce qui est extérieur à notre savoir, ce qui abolit toute pensée rétrospective du réel. Ce qui définit l’événement, passons sur le théorique, c’est aussi sa représentation, plus précisément la signification qu’on lui donne. En ce sens, Both Directions at Once bouscule l’histoire du jazz sans qu’on puisse vraiment comprendre comment. La quête du sens s’accomplit souvent dans l’inconnu. Les hasards du XXème siècle, pourtant si réglé sur la mécanique des idéologies, produisent des fulgurances. Parfois, l’une d’elles s’immisce dans nos imaginaires. Elle n’en finit pas d’étonner nos représentations du temps présent, de nous rendre inactuels. Voilà, c’est ça. John Coltrane, fulgurance noire née en Caroline du Nord, nous expose à d’autres vies que les nôtres – et on en redemande. Le jazz n’est pas une passion fixe. C’est une maturation, une révolution des perspectives, tournant sur elles-mêmes à la recherche d’un astre où se fixer. L’astre, c’est le message à exprimer, la souffrance d’un destin scellé à communiquer. Une quête de sens, finalement, dans un monde qui n’en a pas. À la possibilité du jazz correspond souvent une fêlure, un empêchement ou, parfois, une énergie familiale qui se passe entre générations. Ce que je dois à mon père, ainsi, c’est la passion de la liberté, cet élan vital vers le défrichage des nouveaux territoires de la création musicale. Prosaïque, pensez-vous ? Essentiel. Une certaine conscience, celle qui s’adresse à ce que l’être souffrant a de plus profond en lui, s’exprime. La recherche de la vérité des âmes, en somme. On pense aux débuts de Coltrane, en 1957, au cœur de Manhattan, au Cafe Bohemia, aux côtés de Miles Davis. Birth of Cool est déjà loin. Les bars miteux, les rues sales de Philadelphie, l’addiction à l’héroïne aussi. Pourtant, il aiguise sa technique, son style, fabrique sa marque. L’avant-gardisme, c’est cela Coltrane. Le styliste le plus résolu, le plus imperméable aux conventions, ce styliste-là, c’est lui. Car qu’est-ce que le jazz, sinon cette passion irrépressible pour les marges, pour l’extérieur, pour la subversion ? Le jazz n’est pas un dîner de gala. Oubliez Tom Wolfe et son Radical Chic. C’est une révolution permanente, une interrogation, sans cesse renouvelée, des principes qui régissent nos sociétés. En un mot, l’ambition d’élargir nos existences. C’est toute la sève de la souffrance humaine, de ces hommes et de ces femmes humiliés par la réduction de leurs corps à des marchandises, qui remonte des profondeurs pour crier. Le jazz n’est pas un genre musical : c’est un continent d’amertume et de douleur, d’espoir et de rage, d’expérimentation et de retour aux racines. Coltrane en est l’explorateur le plus hardi.
L’album garde une maîtrise qui confine à celle des premiers enregistrements. La bande des quatre, évidemment, ce quartet des audacieux passé à la postérité. McCoy Tyner au piano, Elvin Jones à la batterie, Jimmy Garrison à la contrebasse donnent leur envergure aux envolées saxophoniques de Coltrane. Une harmonie parfaite née du désordre, une forme de symbiose qui, une fois accordée, révèle le génie de chacun. Il y a cette curiosité, pas toujours sûre d’elle-même, cette envie d’explorer les ressources du jazz, d’épuiser tout ce qui s’est fait. L’invention, déjà, d’une Amérique augmentée, débarrassée des errements de l’esprit et de la misère des corps noirs suppliciés. Ces corps noirs, dont James Baldwin, déjà, puis Ta-Nehisi Coates, disent la précarité dans un pays obsédé par la pureté. James Baldwin écrivait dans The Price of the Ticket : «Societies never know it, but the war of an artist with his society is a lover’s war, and he does, at his best, what lovers do, which is to reveal the beloved to himself and, with that revelation, to make freedom real.[1]» Le Rêve américain revu et corrigé par Coltrane, comme une volonté d’en découdre avec la simplicité émotionnelle que l’on cultive dans le pays. Dire cette immaturité originelle, c’est exposer la vérité d’une nation qui peine alors à se penser hors des concepts de séparation.
Le morceau «Nature Boy» désarçonne par sa maîtrise technique. Les mélodies s’enchaînent. Certaines, avortées, illustrent l’urgence d’une parole réinventée. D’autres, quant à elles, vont au bout de leurs propositions. C’est le cas sur «Untitled Original 11386 – Take 1». Il faut comprendre cette passion de l’inabouti, cette rupture dans l’engagement, si l’on veut saisir le sens du jazz. La dissonance des formes, la mélodie qui s’égare, le rythme qui s’accélère servent la cause du jeu, car c’en est un, qui se joue sous nos oreilles. Un jeu qu’on aurait comme faussé, aux dés pipés depuis le départ, dès le crime originel, fondateur ; l’esclavage, cette suspension de la possibilité d’appartenir à la famille humaine. Les règles sont simples ; il n’y en a pas. Le rythme de la vie pour seule boussole. La question fondamentale, celle qui portera à bout de bras Coltrane, est celle de la spiritualité, de la place de l’Homme dans un univers tenaillé par l’absurde. Un questionnement : pourquoi y-a-t-il quelque chose plutôt que rien ? L’Homme a-t-il une mission à accomplir ? Un destin à honorer, peut-être. L’existence du monde l’obsède : l’esprit de système, moins. Il ne croit pas à l’idée d’une existence propre des choses de la vie. Déterminisme fatal, mais aussi liberté radicale, d’un monde qu’il n’imagine pas sans spirituel. La création, l’invention des normes, l’élévation morale en dépendent. Ces choses de la vie, donc, sont mues par des rouages qui les mettent en branle, les ordonnent. Sa musique vise à dévoiler cette limitation du genre humain. Il la célèbre, avant tout, comme la marque de cette marche du monde, chaotique, kafkaïenne, qui est notre condition à tous. Limitation qui, paradoxalement, permet toutes les libertés, tous les élans créateurs. La spiritualité qui se cherche, rejoignant un intérêt sans faille pour les penseurs de son temps, donne à son jazz quelque chose d’un universel en sursis. On a ici quatre-vingt-dix minutes de plongée au cœur de l’avenir qui s’invente, se tisse, se crie, pour le plus grand bonheur des mélomanes. L’intimité d’un cri, pourtant si universel. La promesse de ce qui est à venir. C’est l’histoire de la musique, heurtée, qui s’écrit. L’année 1962 sera celle du confort musical. Coltrane accompagne Duke Ellington, s’éloigne des chemins aventureux avec l’album Ballads, qu’on aurait souhaité plus inspiré. Il se laisse porter : refus du risque de celui qui ne veut pas avoir raison trop tôt. Certes, la facture classique n’est pas à condamner, par essence, mais comment accompagner le changement d’un pays et de sa société sans réinventer l’art, et à plus forte raison son art, le jazz ? Les succès s’accumulent ; ils ne sont jamais suffisants. Il faut autre chose à ces hommes-là. Penser d’une autre façon la musique des temps qui viennent, c’est, au fond, chercher la réponse aux interrogations spirituelles fondamentales. Alors, il accélère. L’homme précaire doit être pensé. Le jazz doit s’y atteler.
The Lost Album, qui n’a rien à envier aux suivants, dit la transition, le basculement vers un âge nouveau que représente l’année 1963. Deux directions en même temps. Le gouverneur George Wallace vocifère «la ségrégation pour toujours» sur les plaines humides de l’Alabama, la police jette les chiens contre les écoliers, Birmingham s’embrase. «I never will go back to Alabama, that is not a place for me, you know they killed my sister and my brother», pleure J.B Lenoir dans un Alabama blues crépusculaire. Le désespoir, la haine du désespoir mais il faut continuer. Life goes on. Coltrane, lui, joue, sans relâche. Il joue pour dire l’absurdité de l’époque, de cette fracture qui n’en finit pas d’abîmer les idéaux américains, de cette Amérique, justement, qui s’égare. Il joue, pour lui, pour les autres, pour nous, surtout, pour la vie et l’idée que l’on s’en fait. La crise intellectuelle, plus exactement morale, que traverse l’Amérique est, au fond, le visage de ce passé trouble qui ne passe pas, de cette impossibilité de faire récit des mémoires des «minorités» afin de leur trouver une place dans le Rêve. Ce Rêve, d’une nation qui réinventerait l’idée même de nation, éclate, se fissure. L’exclusion, la vulgarité, la pruderie, la faillite morale. On distingue, encore aujourd’hui, à bas bruit, l’Amérique de Janis Joplin et de Kennedy. C’est aussi celle de Coltrane, celle dont transpire sa musique. Encore debout, elle végète, entre pétitions, indignations, manifestations, dans l’attente d’un chemin à suivre. Les ruines morales d’une nation blessée sont difficilement praticables. On peine à s’y déplacer. On sent qu’il faut la réinventer, cette Amérique, d’aucuns diraient la régénérer, poétiquement, artistiquement. Mais avec quoi ? Avec ce cri, lancé à la face des hommes et du monde, par exemple. C’est celui d’un artiste traversé par la mort, cerné par ses avatars bruyants, mais dont la pulsion de vie reste la plus forte. Ici, l’on peut connaître l’angoisse d’une misère, celle des corps noirs qui se brisent, contre l’inquiétude des bonnes âmes qui s’émousse. The Lost Album inquiète les catégories classiques, bouscule les conservatismes, plonge dans cette grande mêlée que l’on nomme jazz. À la course à l’excellence, il ravit la première place. On en redemande. La musique se fige. Elle nous déborde. Les dernières notes du titre «One Up, One Down – Take 6» se dissipent. Le free jazz s’impose. Il métamorphose tout ce qu’il touche, à commencer par nous-mêmes. Alors, on pense que, décidément, l’Amérique n’en finit pas de nous étonner. L’ardeur au ralenti, le pays des deux directions en même temps vaut bien un amour contrarié. It’s your time, Coltrane!
[1] «Les sociétés ne le savent pas, mais la guerre entre un artiste et la société est un conflit entre amants, et, quand celui-ci est au meilleur de lui-même, il fait ce que tous les amants font, à savoir révéler l’être aimé à lui-même et, grâce à cette révélation, rendre la liberté réelle.»