Bien des choses me tiennent à distance de Gabriel Matzneff. À commencer, bien entendu, par son indulgence à l’endroit, non de la Russie, mais de ses maîtres. Mais j’ai toujours eu un faible pour sa façon d’écrire ce qu’il vit et de vivre comme il écrit. Et il y a surtout ce côté pestiféré, bouc émissaire des ligues de vertu, pétitions en ligne quand on lui donne un prix littéraire, prince des lettres au nom devenu quasi imprononçable, paria, qui me le rend, en dépit de tout, irrésistiblement sympathique. Là, je tombe sur La jeune Moabite qui doit être, sauf erreur, le quatorzième volume publié de son Journal. Eh bien, c’est très simple. Voilà un écrivain qui nous dit que la littérature n’a de sens que si elle ressuscite les morts. Voilà un diariste qui nous parle des milliers de pages du Journal ésotérique et posthume déposées, «en mains propres», à Antoine Gallimard comme s’il s’agissait d’une source de radiation qu’il fallait coffrer, mettre au secret, tchernobyliser. Voilà un lecteur dont on sent que la grande affaire, dans la présente saison de sa vie comme dans les précédentes, est de s’assurer que l’exultation byronienne l’emporte toujours bien, en lui, sur le taedium vitae de Leopardi. Voilà un diététicien de l’intime qui nous explique comment le De Tranquillitate Animi, de Sénèque, lui fait plus de bien qu’un solide Prévenir l’infarctus du Dr Truc et qui, bouclant sa valise pour l’hôpital, hésite entre Pascal, Feydeau, une anthologie de la poésie italienne – et finit par une lecture alternée de l’Arioste et des «Œuvres intimes», de Stendhal. Et puis Solange Fasquelle, les éditions Vrin, l’exemplaire des Sermons de Bossuet offert par Montherlant, la grâce de Régine Deforges, Philippe de Saint Robert, Jacqueline de Roux, la table de M. Cazes, Jacques Fauvet – ces noms très monde d’hier, très milieu littéraire à l’ancienne et qui semblent, soudain, les débris d’une Atlantide. Face à tous ces signaux de brume ou, parfois, ces vocatifs, je ne peux me retenir de songer au mot de Picasso sur Braque (ou l’inverse) : «Après lui, après nous, il n’y aura plus personne pour comprendre certaines choses.»
Autre bonheur de lecture du week-end. Et même sentiment que «certaines choses» sont en train de devenir imperceptibles : Hespérie, de Bruno Pinchard, paru, dans l’indifférence générale, aux éditions Kimé. L’auteur est un professeur de philosophie passé par la rue d’Ulm. Il est aussi, me dit-on, un haut personnage maçonnique, forcément ésotériste (ce qui, grâce au ciel, ne s’entend pas dans son livre). Mais l’essentiel c’est Dante, dont il nous entretient comme s’il était notre contemporain. C’est sa manière de nous parler des enjeux idéologiques d’aujourd’hui en naviguant, de vague en vague, entre Dante donc et Virgile, ou Dante et Vico, ou Vico et Chateaubriand, ou Chateaubriand et Gracq – avec, à la fin, un envoi en forme de stances lyriques offertes à sa ville du Havre, ouverte sur le large et devenue, sous sa plume, l’autre nom d’un Occident renouant avec sa vocation métaphysique. C’est, encore, cette écriture rythmée, inventive et poétique, constamment tendue dans sa cadence à la fois nerveuse et contemplative, et c’est cette façon de traverser les œuvres d’avant-hier comme si elles étaient les fragments d’un unique poème dont, tel un Petit Poucet perdu dans la forêt obscure, il recueillerait les miettes entre ses doigts artistes. Et puis c’est, bien sûr, la thèse du livre qu’il défend avec la même passion que s’il s’agissait de la dispute de Trump avec le maître de la Corée du Nord ou de Macron avec Erdogan (et, de fait, à le lire, c’est fondamentalement la même chose…) – et qui repose sur l’intuition d’un Occident fils, non de la clarté grecque et du logos, mais du génie latin et de ses ruines vivantes. Stèles. Caveaux. Vers éplorés. Nerval. Le Pausilippe et la mer d’Italie. L’Europe comme une terre du soir, confuse et pourtant lumineuse, et semblable à ce tombeau que contemplent, dans le tableau de Poussin qui figure en couverture du livre, les bergers d’Arcadie. Rome ou Athènes ? Je suis, moi, comme on sait, plutôt du parti de Jérusalem. Mais, quitte à choisir, je dois dire que ne me déplaît pas cette idée de rouvrir les tombeaux pour une renaissance et non pour une exhumation. À l’époque des très grands oublis et des très grands simplismes, ce livre est bienvenu.
Et puis, ma troisième émotion de la semaine. Le petit essai (éditions Galilée) que le philosophe et spécialiste d’esthétique italien Guido Brivio consacre à un artiste, Jacques Martinez, dont le nom n’est pas inconnu, depuis le temps, aux lecteurs de ce «bloc-notes». Y a-t-il vraiment, comme le disait Matisse, des fleurs en toutes choses pour peu que l’on ait des yeux pour savoir les voir ? Est-il exact que la grande différence entre la peinture et la philosophie est, comme le pensait Agamben, que la première possède son objet sans le connaître alors que la seconde le connaît sans le posséder ? Et qu’est-ce qu’un artiste qui accepte d’entendre ce que lui crient les fous sans jamais prendre le risque d’oublier ce que lui ont appris les sages ? Telles sont les questions posées. Et tels sont les enjeux d’une œuvre demeurée, comme il y a quarante ans, modern for ever.


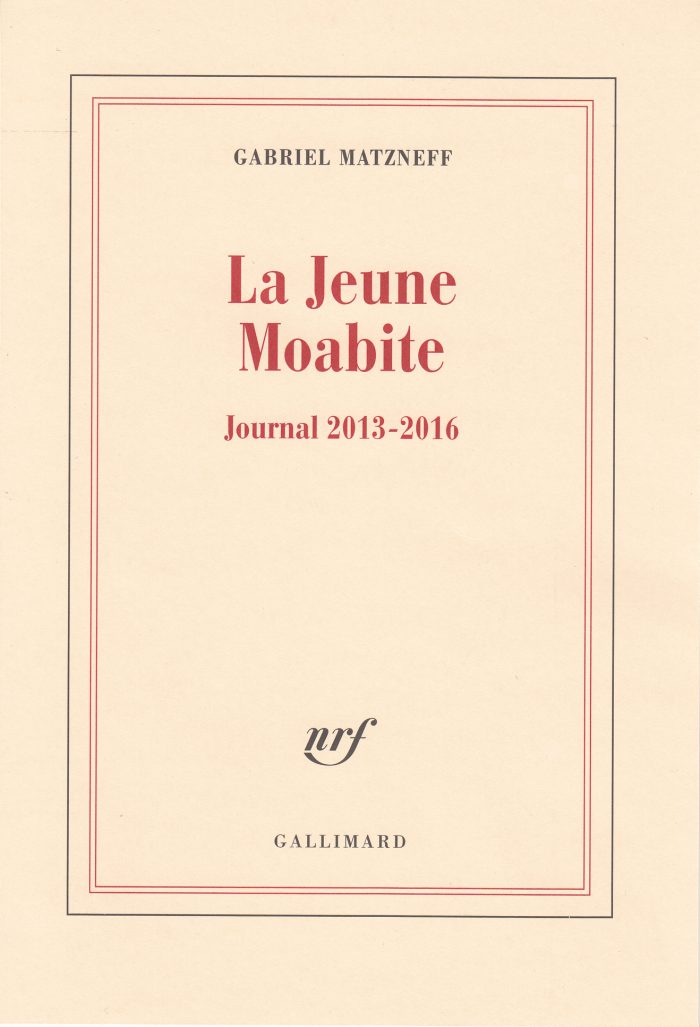
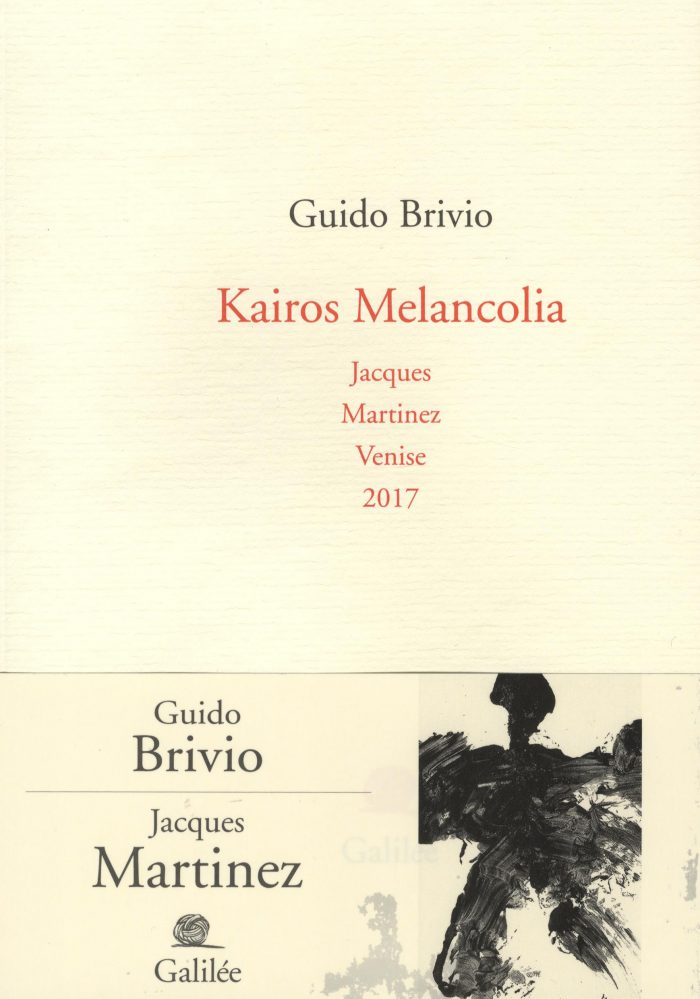
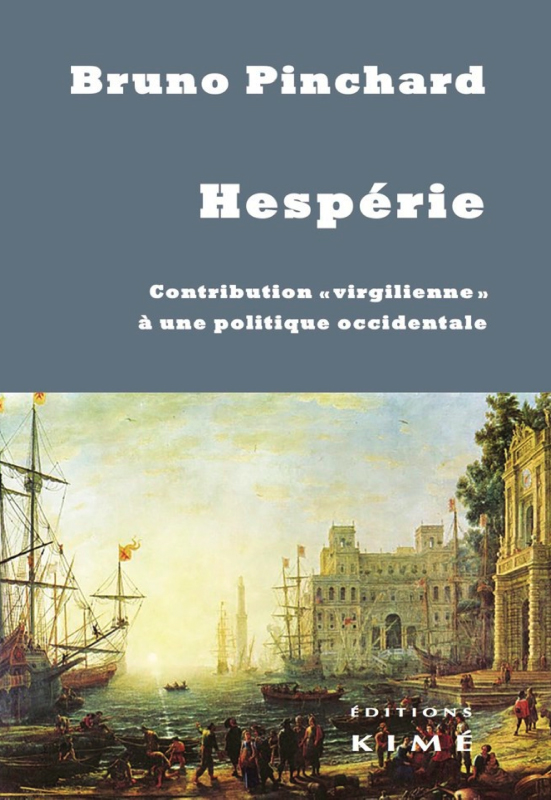






Mélange de couleurs, de clairs et obscurs, de lignes et d’angles, de formes visibles et invisibles, de sons et silences, de mots qui chantent ou hurlent dans la nuit étoilée à Arles, émotion et némesis de l’âme, contemplation au bord de la rivière de la mélancolie.
Le kaïros a oublié le kronos et trouvé une réponse à son questionnement de la vérité, son point de création d’un moment de beauté pour ceux qui savent chercher et voir les fleurs qui sont en toutes choses.
Comment concilier l’idée du sublime, absolument libre, avec les formes du monde, sans tomber dans la reproduction d’œuvres et d’une culture qui a aboutit au pire de l’humanité, à sa falsification même ?
C’est l’amour pour la parole, pour l’art, c’est l’amour pour la vérité, qui ont fait dire à Agamben que les philosophes, comme les poètes, sont avant tout les gardiens du langage, des formes et du style d’expression.
Nous ne comprendrons pas la peinture moderne sans voir dans le rapport de forme et non-forme, de figuration et abstraction, l’image de l’artiste et de sa sensibilité.