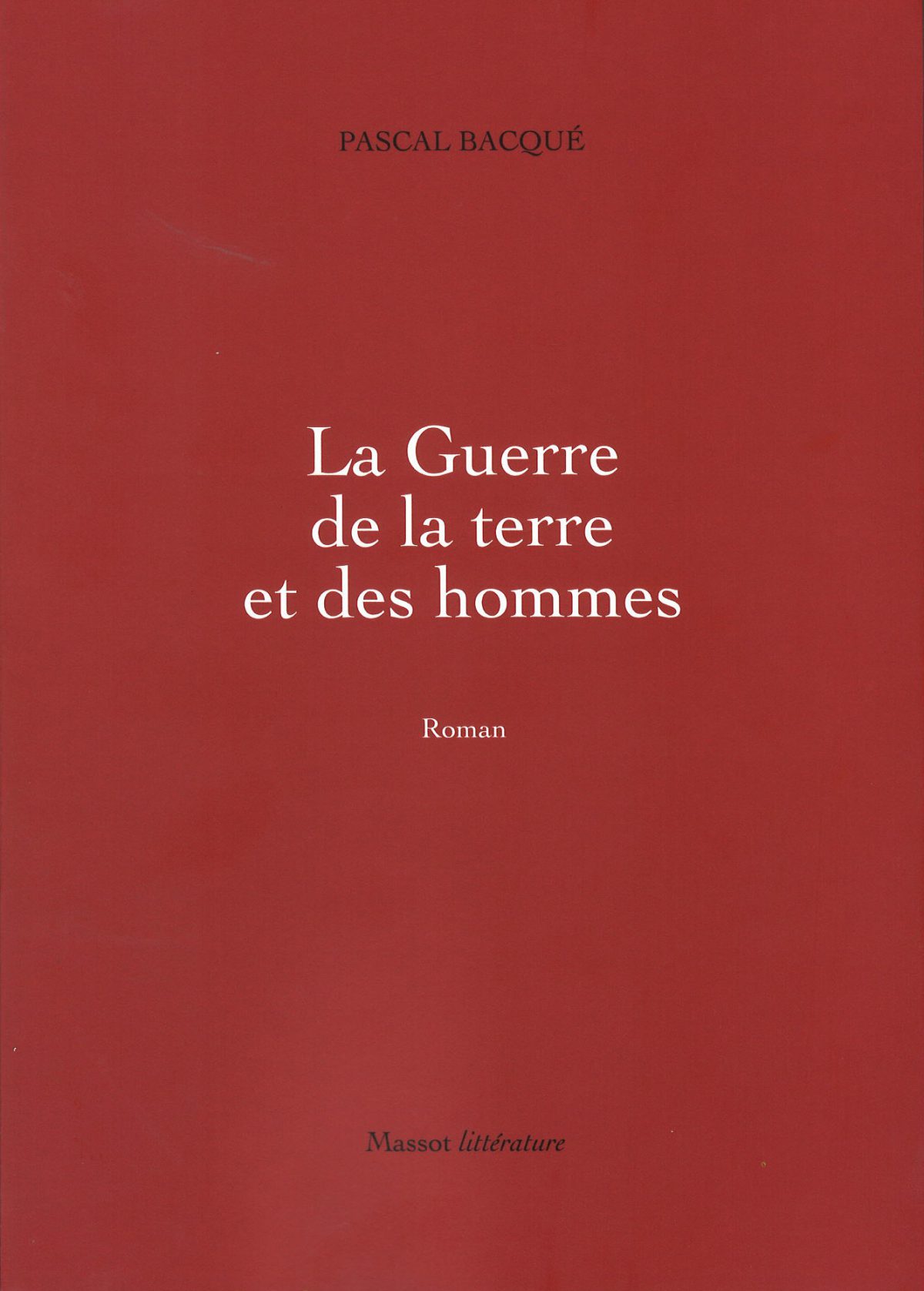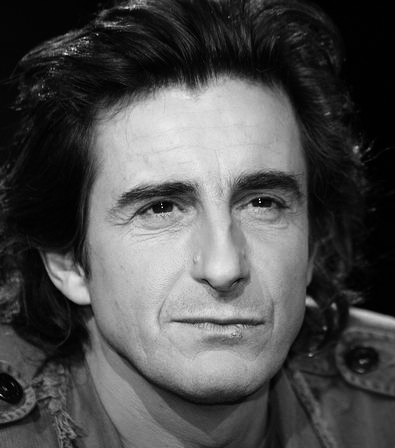«Il n’y a parmi les hommes que les lieux, les temps et les langues. Ces trois choses-là se croisent. Certaines furent si notables, qu’il ne faut pas qu’elles soient oubliées.»
Pascal Bacqué, La guerre de la terre et des hommes, ed. Massot, 2018.
La guerre de la terre et des hommes de Pascal Bacqué, paru aux éditions Massot-littérature, est un roman annoncé en cinq volumes, dont le premier, de plus de quatre cents pages, paraît le 8 février. Son titre : Une histoire et une histoire font une histoire.
Roman fleuve, donc, et qui risque d’en rebuter plus d’un, peu désireux de s’engager dans une aventure dont on pressent qu’elle comptera vraisemblablement près de deux milles pages, sinon plus. Pourtant, ils auront eu bien tort d’être rebutés, car ils seront passés à côté d’une œuvre qui promet d’être, indubitablement, extraordinaire.
J’ai parlé d’un «roman». On peut convenir de l’appeler ainsi, puisque c’est une fiction, avec des personnages, un narrateur, des dialogues et des descriptions. Mais cette fiction comporte deux traits particuliers : le premier, c’est qu’elle mêle des personnages de fiction et des personnages historiques, tels Churchill, Tolkien, Benjamin ou Genet, et bien d’autres ; le second, c’est que son intrigue n’est pas une histoire mais, en quelque sorte, l’Histoire – disons celle de l’Occident, dont la scène se situe pour une part en l’an mille, pour une autre en 1945, et gravite entre la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et la Suisse, plus exactement à Sion, chef-lieu du canton du Valais.
Présomptueux ? Oui et non. Oui, parce qu’en effet l’ambition de ce roman est littéralement démesurée, comme s’il s’agissait de réunir Tolstoï, Rimbaud, Melville, Goethe et Moïse en un seul paquet ; non, parce que c’est merveilleusement mené, c’est-à-dire avec art, légèreté et profondeur, intelligence et rythme, démesure et humour. En un mot : on y trouve la griffe – et le pari – d’un écrivain.
L’intrigue tient en deux phrases, l’une, qui ouvre le Prologue : «Il y a, dans le monde, un objet de plus» ; à quoi fait écho une autre, la dernière phrase du livre (le premier des cinq annoncés) : «Il y a, dans le monde, un homme de plus». Entre cet «objet de plus», qui s’avère être un «bâton», et cet «homme de plus», qui clôt le volume, se déroule le premier livre de l’Histoire.
Histoire d’un «bâton» dont un criminel s’est saisi ; histoire d’un crâne qui roula dans une fosse ; histoire d’une usurpation de la forme humaine. On reconnaît là, outre Shakespeare, un célèbre midrash de la tradition rabbinique, au sujet d’Esaü et de Jacob. Le roman de Bacqué, en effet, puise son inspiration dans le Midrash, sa matière, mais surtout son esprit, à commencer par l’idée que le récit, «haggadah» en hébreu, est une mise en forme du vrai, du mi-dit. De fait, la Torah des Juifs est donnée sous la forme d’une histoire. Et cela n’est pas rien. C’est même peut-être tout, qui sait ?
En exergue à ce premier livre, «Une histoire et une histoire font une histoire», il y a un cours dialogue : «– Il faut savoir ; il faut recommencer à savoir ! – Mais comment ? Le Savoir ne sait plus rien. – Alors il faut s’y prendre autrement». Il est signé et daté : «E. à P. B., novembre 2017». Est-ce une clé ? Que la lettre «E» désigne Emile, Eliezer ou Elise, nul n’en sait rien ; mais P. B., à n’en pas douter, c’est l’auteur, qui s’entendit répondre, après coup : «autrement». Il existe un savoir autrement.
Mais n’allons pas rebuter de potentiels lecteurs par l’usage de mots tels « Torah », «Midrash», «Haggadah» ou «Savoir». Et parlons d’art, de guerre et de paix, de pouvoir, de commandement et de nations. Le 7 mai 1945, quel était l’état des lieux en Occident ? Citons la page 57 :
«La paix allait être déclarée dans quelques heures, l’Angleterre allait vivre l’ultime moment de sa gloire et il allait falloir en goûter le dernier nectar – car la vie, au lendemain de la fête, deviendrait sans nul doute plus amère. L’Amérique, aussitôt après les ultimes crépitements des flashes où les vainqueurs allaient faire semblant de s’immortaliser, dévorerait le monde de son accent simplifié et de ses stars sucrées. Les Russes fermeraient la porte pour une nuit obscure ; combien de temps ? Et l’Europe, piégée dans sa folie d’hier, errerait dans les faubourgs du monde comme une vieille droguée qui n’a pas su mourir…»
L’Europe, «piégée dans sa folie d’hier», paraît surgie du théâtre de Heiner Müller, tout autant que de la philosophie de Jean-Claude Milner. Car il n’y a pas d’idéologie dans le style. Ce pourrait être la leçon de l’écrivain. Et de fait, ce qui vous saisit à la lecture de ce roman, c’est non seulement la pluralité des temps et des lieux, tressés avec un soin à la fois musical et cinématographique, mais aussi, et surtout, les paysages du style, les scènes de la parole : ici, un poème en prose ; là, une scène romanesque ; ailleurs, un dialogue platonicien ; au commencement, un coup de théâtre ; enfin partout, ce silence qui entoure d’un halo de mystère «les mots de la tribu».
Revenons, près de deux cents pages plus loin, au 7 mai 1945, plus exactement au lendemain : «Partout, le 8 mai 1945». C’est le début du chapitre 6, intitulé «Le relais des narrateurs» ; nous sommes à la page 243 :
«Quand le monde change, un certain effet se porte sur les mots, sur la prononciation, même. De Londres à New York, de Berlin à Paris, les hommes pansaient leurs plaies. Les corps étaient encore rouges des contusions des batailles et des tortures de la cruauté. Chacun, empressé d’oublier les slogans et les raisons hurlées de cette guerre, tournait la page. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand, écrirait bientôt un poète – qui ne s’apprêtait nullement à mourir, d’ailleurs. Surtout, reprenant ses esprits (croyait-on), l’avenir seul comptait, et l’incertain brouillard du possible suffisait à les occuper tous, des dernières chaumières du Yorkshire aux taudis moscovites.»
Réunir des accents venus du poème français à d’autres venus de Groucho Marx ou, sinon, d’Oscar Wilde, qui oserait relever ce défi, sur un sujet aussi grave ? C’est qu’en effet l’auteur est convaincu, intimement convaincu, et traversé de fond en comble par cette vérité-là : «Quand le monde change, un certain effet se porte sur les mots, sur la prononciation, même». Dès lors, l’écriture d’un roman ne vise peut-être pas tant à raconter une histoire qu’à faire entendre l’envers de la vérité, à savoir que si un certain effet parvient de soi à se porter sur les mots, le monde peut en être changé, en retour – et donc la vie. C’est pourquoi une histoire, une phrase, un mot, parfois, c’est une promenade de l’esprit, certes, mais au bord du vide. Sans doute, je risque ici une interprétation, à mes risques et périls. Mais c’est bien ainsi que j’entends, ressens, comprends l’écriture de Pascal Bacqué, à qui je rends pour finir la parole, prise déjà trop longtemps :
«Paysage de ronces chargées de mûres vertes, de haies épineuses où poussaient des carottes sauvages, des ajoncs et des bruyères. Douces plages d’herbe dorée en longs cheveux desséchés par le sel, rythmées par les piquets de quelques barrières défoncées. Non que cette herbe valût cher. On n’y traînait même pas les chèvres. Un faux pas, et c’était la chute et la mort.» (Page 150)