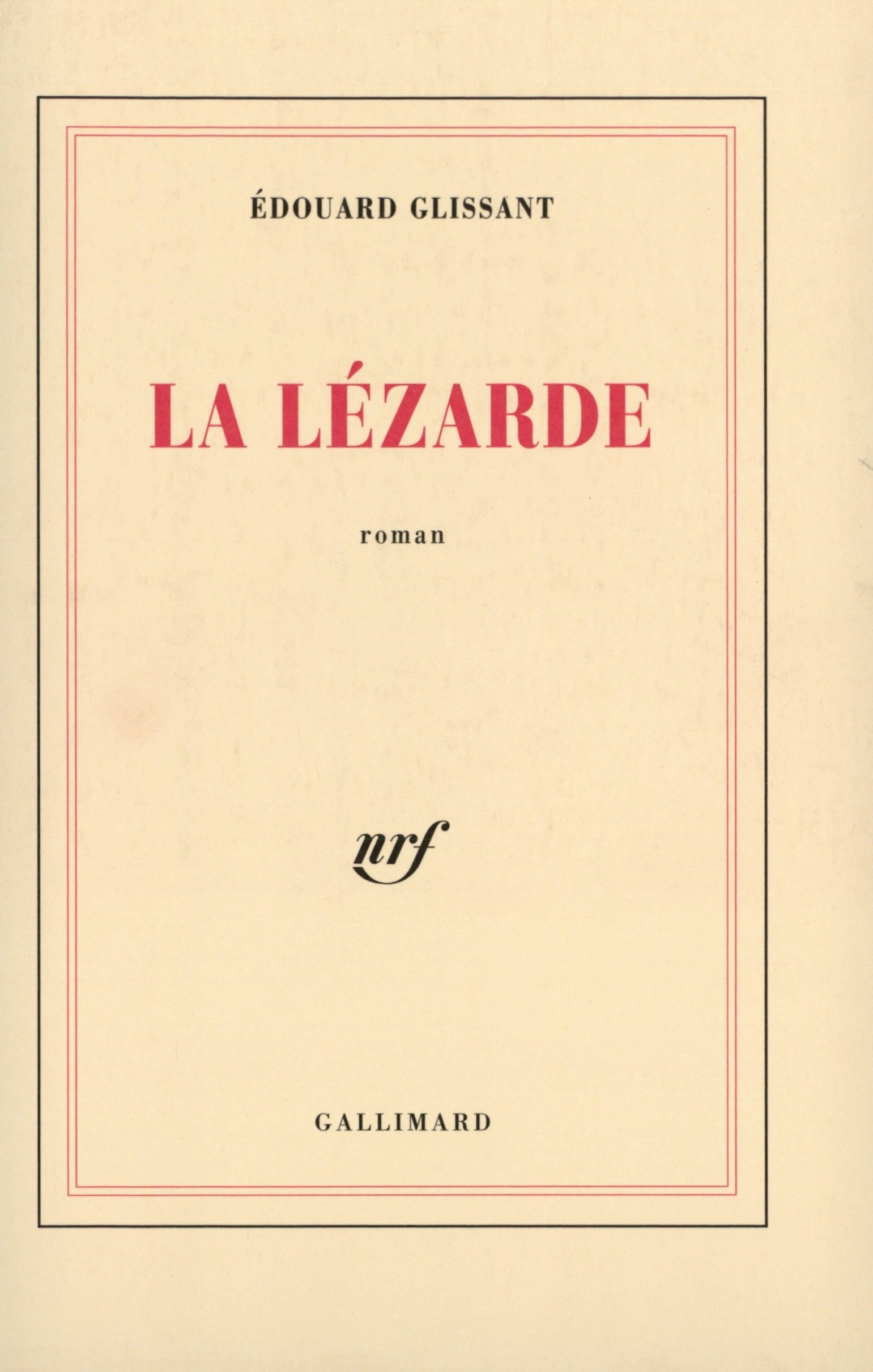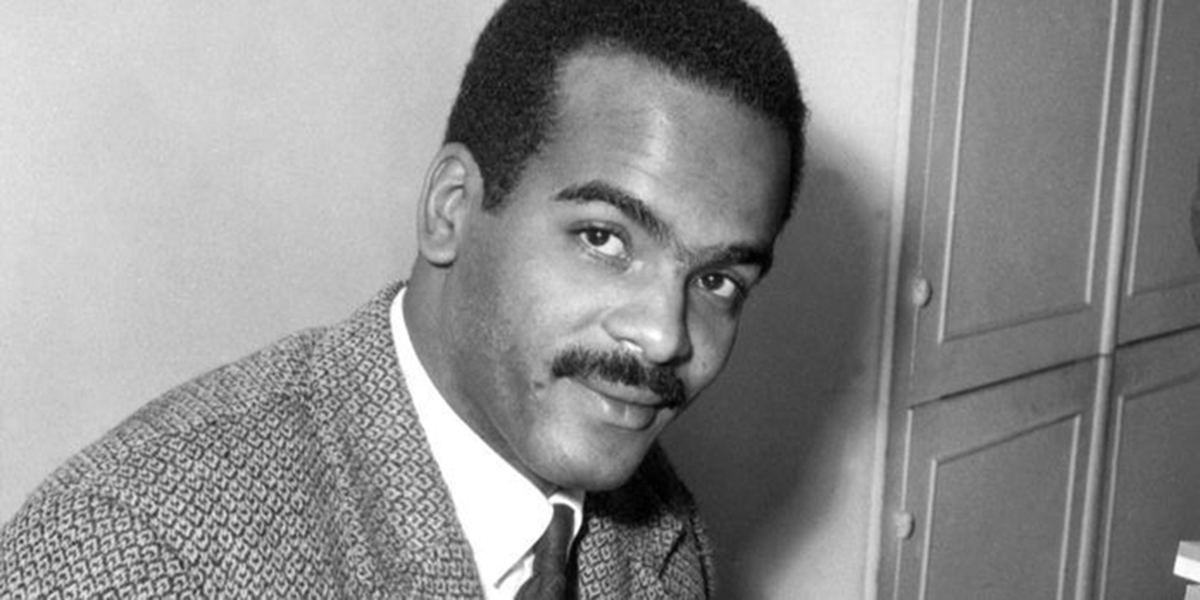Dans son livre de 1995, Faulkner Mississippi, Glissant raconte l’anecdote suivante. En même temps qu’il analyse l’œuvre du romancier américain, il rend compte de la genèse, des préparatifs de son livre. Il se déplace donc sur le territoire de l’oeuvre de Faulkner, le sud des Etats-Unis, et au fil des pages, il est pris d’une sorte d’hallucination, parce que depuis les romans de Faulkner, rien ne semble avoir changé. Dans son esprit, chaque passant est un personnage rescapé. Les champs de coton, les bosquets d’arbre, les silhouettes tout est éminemment faulknérien. La réalité est l’exact calque de ses souvenirs de lecteur. Et donc, il arrive avec ses compagnons de voyage dans une université. Et, puisque tout dans ce décor lui a indiqué être un signe de l’existence de l’œuvre de Faulkner, il demande tout à trac à un étudiant : Que pensez-vous de William Faulkner ? – William qui ? – lui répond le jeune homme, un peu interloqué. Glissant est totalement effondré, très déçu. Oh, ce doit être un étudiant de physique-chimie, lui dit un de ses amis, pour tenter de le consoler.
Alors voilà, si l’on m’avait dit : parle d’Edouard Glissant, je n’aurais pas répondu : Edouard qui ?, car je n’ai pas une monomanie pour la physique-chimie, mais je vais essayer de parler de l’écrivain et de son œuvre avec beaucoup de scrupules. Car, mais c’est vrai pour tous les grands écrivains et philosophes, il faut toujours être scrupuleux, précautionneux quand on parle de personnages aussi complexes, et aussi intelligents. C’est peut-être ce qui frappe quand on lit de près Glissant, c’est à quel point, lui qu’on résume parfois à deux ou trois concepts, à quel point il n’est pas dogmatique, à quel point le scrupule de son intelligence extrême le fait toujours pondérer, hésiter, contrebalancer, d’ailleurs il est un philosophe du contradictoire et du divers. Il cherche toujours à apercevoir le contradictoire, la nuance et l’équivoque. Il est très loin d’être aussi vibrionnant et politique qu’on pourrait le croire – dans ses meilleures pages d’essai, c’est un artiste du contre-jour, de la complexité.
Enfin, il s’agit d’être scrupuleux, puisque j’ai lu ou relu son œuvre à travers le prisme de ce qui nous réunit ici, le Festival des Amériques Insulaires.
Et donc, ce soir, je voulais souligner trois choses que je trouve intéressantes dans cette perspective : Glissant et les Amériques, Glissant et le Sud, et puis enfin, Glissant et le Tout-monde.
Glissant et les Amériques
D’abord, je voudrais parler des Amériques insulaires. Ce qui est remarquable chez Glissant, ainsi que le montre de façon convaincante un essai de Katell Colin, et avec lui, bon nombre d’exégètes de l’œuvre glissantienne, c’est que Glissant s’inscrit de façon très singulière dans un espace qui est la littérature des Antilles.
Il faut ici faire un petit détour par la relation que Glissant entretient avec son ainé glorieux, lui aussi Martiniquais, Aimé Césaire. Ce sont des rapports compliqués, Glissant en quelque sorte, en vient à «tuer» ce père littéraire, avec lequel il diverge, entre autres, sur ce point fondamental du rapport à l’espace.
Si l’on résume à grands traits l’histoire de la littérature des Antilles, c’est peu dire que l’œuvre d’Aimé Césaire, qui est la génération précédant celle de Glissant, a été fondamentale, aussi, bien sûr, dans la littérature francophone et universelle. Or, Césaire, je simplifie, pense la Martinique comme trace de l’Afrique : son geste poétique est celui d’un retour, il cherche une fondation de l’autre côté de l’Atlantique. Glissant ne fait pas du tout cela : il célèbre un espace original, qu’il appelle les Amériques, l’Amérique, et dont les Caraïbes est dit-il «la préface au continent» (dans Introduction au poétique du divers). Je vais justement citer un très émouvant passage de cette Introduction… L’Amérique, dit-il, contrairement à l’Europe, a des paysages ouverts, immenses, où la mesure de l’homme ne se fait pas sentir, il invente le mot «irrué», de ruade, pour dire les soubresauts, la non-servitude du paysage.
«Et il me semble que quand je suis dans les hauteurs de Sainte-Marie au morne Bezaudin, lieu de ma naissance, et que je vois des cultures en espalier, presque verticales dans ces hauteurs de Bezaudin et d’un autre morne qui s’appelle Pérou (…) je retrouve les mêmes sensations que dans un paysage beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, celui de Chavin au Pérou, le berceau des cultures pré- incaïques, où j’ai vu ces mêmes cultures en espalier, où on se demande comment le paysan qui travaille ne dégringole pas… ce paysage américain qu’on retrouve dans une petite île comme sur le continent me paraît toujours aussi irrué».
Je trouve émouvant cette façon de voir du Pérou dans la Martinique, et d’ailleurs, jusqu’au XVIIIe siècle, la mer des Caraïbes s’appelait la mer du Pérou, comme quoi, la poésie a plus de vérité que la géographie, car c’est bien le même tempérament qui irrigue les pays d’Amérique du Sud et les Antilles.
C’est vrai que c’est une sensation qui peut se retrouver dans l’expérience, si vous avez voyagé en Martinique, en Louisiane, en Colombie, à Cuba, en Haïti, il y a comme un air de famille entre tous ces paysages. William Faulkner dit quelque part dans Absalon, Absalon, son roman qui se passe en Haïti, que ce territoire est embaumé par un air, je cite de mémoire, plein de «glycines, de cigares, et d’étoiles par dessus les galeries» – et c’est, résumé en trois mots, toute l’impression poétique que peut procurer la Caraïbe.
Donc, et c’est le premier point, la référence absolue de Glissant c’est les Antilles. Premier clivage avec Césaire.
Plus tard, Chamoiseau et Confiant, avec leur éloge de la Créolité, reprendront cette idée, en essayant de la dépasser. Glissant a dit à Césaire : Oui, la référence c’est l’Afrique, d’accord, mais enfin, les Antillais ont quelque chose en plus, ou de différent : c’est l’Antillanité.
Et vingt ou trente ans plus tard, Chamoiseau et Confiant disent à Glissant : Non, ce n’est pas l’Antillanité, pour beaucoup de raisons, ce qui compte, le vrai mot, le cœur vivant de notre peuple, c’est la Créolité. Et puis, Glissant, du haut de sa somptueuse intelligence, leur dira : Vous avez raison avec vos histoires de créolité, mais cette façon d’être-au-monde que vous me décrivez, ce trait local que vous m’indiquez, eh bien moi je veux l’appliquer partout, sur toute la surface du globe, c’est ce que j’appelle le Tout-monde, la créolisation, la relation. Et Glissant englobe habilement Confiant et Chamoiseau pour les dépasser, et reste ainsi indétrônable dans sa théorie. Je m’étends un peu longuement là-dessus car cela montre deux choses : que Glissant est d’une habileté dialectique absolue, et puis qu’il a toujours voulu théoriser son œuvre, qu’en même temps qu’il écrit des romans, il fait partie de cette sorte d’écrivains qui veulent les inscrire dans une cathédrale philosophique.
Donc, je le disais, la référence de Glissant, c’est, je cite le titre de l’un de ces poèmes, «un champs d’îles non inventées», la Caraïbe. Vous le savez peut-être, Edouard Glissant est l’auteur de romans, on y reviendra, et de beaucoup d’essais, il est, je reprends les mots de Bourdieu à propos de Sartre : «penseur écrivain, romancier métaphysicien et artiste philosophe qui engage dans les luttes politiques du moment toutes ces autorités et compétences réunies dans sa personne», bref, un «intellectuel total».
Alors, voilà, nous avons donc ce jeune homme, Glissant, qui va commencer sa vie littéraire. Il est né en 1928, il fait des études à Paris autour de Bachelard, c’est la même génération d’ailleurs que Bourdieu, on pourrait dire : les enfants de Sartre. Et il publie son premier roman, qui a le Renaudot, quand il a trente ans, La Lézarde. Et puis, il doit se trouver un père en littérature, une figure, uns statue intérieure comme dirait Malraux. Or, il ne choisit pas du tout Césaire, qui à l’époque, règne sur les lettres antillaises. Non, sa curiosité, son cœur, sont attirés par William Faulkner.
Faulkner plutôt que Césaire
C’est l’objet du livre que je citais en introduction, Faulkner Mississippi qui a été écrit bien plus tard, en 1996.
Faulkner, c’est le grand romancier moderne américain, or, il y a à priori, peu de points communs, de lignes de failles semblables entre ce jeune écrivain qu’est à l’époque de La Lézarde Glissant, et le fils d’une famille du Mississippi, Faulkner. Mais Glissant, en lecteur prodigieux et très convaincant, explique que Faulkner, au fond, c’est la grande figure du Sudiste.
Il fait, dans Faulkner Mississippi, plusieurs fois le parallèle, l’analogie avec deux autres écrivains qui le fascinent : Camus et Saint-John Perse. Quoi de commun entre Camus, Saint-John Perse et Faulkner ? Ce n’est pas seulement leur Prix Nobel. Non, plus profondément, ce sont trois hommes qui sont les héritiers de systèmes coloniaux, Perse en Guadeloupe, Camus en Algérie, Faulkner au Mississippi. Or, ces trois artistes sentent bien ce que la situation, au sens philosophique, a de révoltant, mais, d’un autre côté, ils sont des héritiers, ils ne peuvent pas se déprendre de leurs racines. En somme, pour le dire vite, ils ne peuvent, selon les mots de Camus, choisir entre la justice et leur mère, ou plutôt ils choisissent leur mère (et on se souvient par exemple d’Eloges de SJP, que la figure de la mère compte énormément pour ces trois-là, Faulkner a été élevé aussi par sa mère). Ces trois-là sont dans des situations tragiques : tout le monde a des bonnes raisons. Ils regardent en face l’inextricable du destin et de la fatalité. Ils ne peuvent démêler, éclaircir l’équitable entre deux groupes qui s’affrontent, ils sont nés d’un certain côté, mais, puisque ce sont des artistes universels, ils ressentent profondément la douleur de l’autre.
Je vais citer Glissant dans Faulkner Mississippi :
«J’ai rencontré Perse et Faulkner beaucoup plus évidemment que je n’ai rencontré Césaire par exemple… Perse et Faulkner, qui me semblent essentiellement être des écrivains de Plantation, et qui donc ont quelque chose à voir avec nous».
Donc, Glissant choisit Faulkner contre Césaire. Et il choisit donc, de cette façon, le roman contre la poésie. Il pense qu’il faut décrire la violence, et la beauté, de son monde natal, car il est symptomatique d’un conflit qui se pose partout ailleurs ; il pense qu’il faut décrire, objectiver, recenser, énumérer, ressasser, ratiociner, pour faire apparaître le tragique de son paysage, comme Faulkner l’a fait, plutôt que, comme Césaire, s’indigner, user du lyrisme pour inventer un sujet poétique.
Glissant pense que les romanciers, comme Faulkner ou Camus, sont les grands politiques ; il ne veut pas être, au sens propre, un homme politique comme l’est devenu Césaire.
Je n’ai malheureusement pas le temps d’entrer dans le détail des relations entre Glissant et Faulkner, il faut lire ce Faulkner Mississippi, mais ce qu’on peut dire c’est deux choses.
Numéro un : Glissant veut, explicitement, reprendre le projet de Faulkner : même monde clos, même techniques romanesques, avec le retour de La Lézarde à Malemort, des personnages, qui, eux-aussi, comme chez Faulkner, sont polarisés autour de trois ou quatre grandes familles, même ressassement infini, même monologues, même circularité, même visée oblique du mystère, même atmosphère de secret.
Numéro deux : il théorise justement son rapport à Faulkner. En gros, il dit : Faulkner a réussi à nous faire apercevoir, sans le résoudre, la contradiction tragique du Mississippi, les Snopes, et le comté de Yoknapatawpha :
«L’écriture faulknérienne procède de ces trois éléments : une vérité cachée… et qui régit la description du réel… cette description elle-même qui ne peut être que visionnaire (décidée par l’intuition, le pressentiment de la vérité primordiale)… enfin l’assurance inquiète de ce que le secret de la vérité à aucun moment ne s’avouera… le caché, le décrit, l’ineffable».
Donc, pour Glissant, Faulkner a inventé un roman moderne, non seulement dans ses techniques, mais dans sa métaphysique. Il compare l’œuvre de Faulkner aux grands mythes comme Hamlet ou Œdipe : un secret, un vice natal, une faute première et originelle, qui répand la peste, et la tâche du romancier, par delà la beauté du monde, est de la dévoiler peu à peu – sauf que dans ces mythes, la contradiction disparaît, alors que dans le roman moderne, elle persiste. La peste ne s’en va pas, le Roi légitime n’est pas intronisé ou rétabli. Il y a persistance du tragique.
Voilà la première chose importante chez Glissant. Ce choix de Faulkner contre Césaire. Le choix du roman contre la poésie. Le choix de la description du monde plutôt que le poème politique.
Le Sud chez Glissant, Faulkner et Garcia Marquez
J’en viens à mon deuxième point, qui est le Sud. Parce que pour Glissant, c’est une histoire qui se passe au Sud. Son Sud, c’est à la fois le Sud des Etats-Unis, celui de Faulkner, et le Sud du monde, la Caraïbe, c’est-à-dire, une société où il y a au cœur des choses, un manque. Je cite :
«Le pré-supposé de la narration, la condition première, l’établissement impossible, la légitimité déniée du Sud».
En clair, il existe des sociétés sans mythe originel, des sociétés où il existe un vice caché, qui est le mystère ou la blessure des origines. En fait, Glissant, comme Faulkner, comme Garcia Marquez ont un problème avec le passé. La société où ils évoluent est «greffée sur un manque». Je cite Glissant à propos de Faulkner : «L’enjeu, c’ est bien pour lui le fondement absolu de cette communauté du Sud».
Alors pourquoi le Sud, pourquoi cette terre ? Qu’est ce que cette dénomination astronomique recouvre de philosophie ?
Pour Glissant, le Sud de Faulkner est une communauté composite. C’est-à-dire, un endroit où plusieurs peuples, plusieurs langues se mêlent, et où il n’y a pas de mythe fondateur premier, un sacré partagé qui tiendrait ensemble tous les éléments.
Le Sud, c’est un endroit de brassage, où différentes langues et différents peuples se rencontrent, dansent infiniment autour de légendes obscures. «L’irréparable, le Temps, l’ambigu, le vertige, la malédiction, tous lieux faulknériens», nous dit Glissant, et on pourrait dire : l’irréparable, le Temps, l’ambigu, la malédiction, tous lieux du Sud.
Et la tâche du roman, dans ce Sud, c’est de renouer avec une Genèse possible, un mythe fondateur qui tiendrait ensemble chacun de ces sudistes, pour l’heure, abandonnés à leur tragédie intime.
On voit ici le parallèle avec Garcia Marquez. C’est un écrivain, aussi, d’une Genèse ré-inventée : Cent ans de solitude est en ce sens un grand roman du Sud. Il découle de la nécessité, impossible, de fonder une origine. Le temps, chez Garcia Marquez, au moins dans ce roman, est immobile ; il y a circularité, répétition, de la tragédie, comme le symbolise la figure littéraire du fleuve, de l’eau : c’est le Mississippi chez Faulkner, la pluie incessante chez Garcia Marquez, la Lézarde, ce fleuve martiniquais chez Glissant.
Glissant, Garcia Marquez, Faulkner, ce sont trois romans du Sud.
Autrement dit, ce sont des romans-monde, qui tendent à rédimer la violence en la disant, à décrire inlassablement le réel, avec les mêmes techniques : accumulations, répétions et circularité, le monde, leur monde, pour en trouver la beauté et tourner autour d’une Genèse ré-inventée.
Glissant, dans Faulkner Mississippi, rattache d’ailleurs Garcia Marquez à la tradition faulknérienne. Il en parle ainsi :
«L’histoire qui s’exacerbe en histoires qui se joignent et fuse en une circularité vertigineuse et se reforme ou se referme d’elle-même et sur elle-même comme un parchemin calamiteux – et le bateau du temps échoué à des bords de végétation sans fond – c’est Cent Ans de Solitude de Gabriel Garcia Marquez».
Le Sud, c’est aussi le territoire de l’oralité, du conte, de la légende : autant de moyens de trouver encore une source, une fondation, une Genèse. C’est ce que Edouard Glissant appelle les di-genèse, des genèses multiples.
Mais je veux dire que c’est un Sud qui n’est pas un endroit géographique ou un moment historique. C’est le Sud comme métaphysique d’une terre qui est plurielle, une société ouverte selon le terme de Popper, bref, une société moderne.
C’est ce qui rend si intéressant la lecture de Glissant, c’est que sous couvert de décrire un endroit précis du monde, la Caraïbe ou le sud des Etats-Unis, il nous parle de notre monde moderne, connecté, mélangé, ouvert.
Et dans ce monde moderne, la quête sans fin des origines, la tragédie permanente des sociétés et des êtres.
Faulkner ne s’appelle pas Faulkner mais, originellement, Falkner.
Garcia Marquez a eu une enfance très mouvementée, il la raconte merveilleusement dans son auto-biographie, Vivir para contar la. Et Glissant a, jusqu’à ses neuf ans, porté le nom de sa mère, Godard. Chez ces écrivains, la quête intime d’origine a rencontré l’angoisse fondamentale de leur territoire natal : qui sommes nous ?
Je peux citer les premières lignes de La Lézarde, à moitié auto-biographique, et qui montre à travers la figure du héros Thaël, presque christique, cette quête des origines, le Sud, le conflit entre violence et beauté, le divorce de l’homme avec le monde, ce besoin d’une Genèse :
«Thaël quitta sa maison, et le soleil baignait déjà la rosée mariée aux points de rouille du toit. Première chaleur du jour ! Devant l’homme, l’allée des pierres continues vers l’argile du chantier ; un flamboyant à cette place élève sa masse rouge, c’est comme l’argile de l’espace, le lieu où les rêves épars dans l’air se sont rencontrés. Thaël marcha loin de l’allée, s’arracha à la splendeur de l’arbre. Résolument, il s’enfonça dans la boue, et accompagna le soleil».
Vous voyez ici que c’est une ré-écriture à peine dissimulée de la Genèse, la façon dont on fait le monde à partir de la boue, la manière dont le roman crée, dans cet incipit, un nouveau monde, dans cette rosée de l’ouverture de l’intrigue.
C’était mon deuxième point. Comment une terre, le Sud, produit une métaphysique du roman que l’on retrouve chez trois grands romanciers : Glissant, Faulkner, Garcia Marquez. Trois auteurs en quête d’origines. Chacun à sa façon : le réalisme poisseux et halluciné chez Faulkner, le réalisme magique et baroque chez Marquez, le réalisme oblique et poétique chez Glissant.
Le Tout-Monde comme roman moderne
Je voudrais conclure en abordant mon dernier point.
Parce que dans son long processus de théorisation du romanesque moderne, Glissant en vient à ce concept, le Tout-monde et la créolisation.
Je n’ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je voudrais résumer en un mot sa pensée.
En clair, on l’a vu, Faulkner a inventé le roman moderne : un roman où les personnages persistent dans leur mystère, où les êtres sont saisis, comme épinglés, dans leurs tragédies et leurs angoisses métaphysiques.
Et Glissant dit : ce que Faulkner n’a pas résolu, cet espace où les individus mettent de côté cette quête des origines et entrent en relation, c’est le Tout-monde.
Le Tout-monde, c’est un espace où la singularité de chacun est préservée, où la pluralité des points de vue est respectée, pas mélangée, mais coexiste, où l’histoire, pour reprendre un mot de Paul Ricoeur, est «discontinue comme constellation de personnes».
Or, il me semble que cet espace, c’est justement celui du roman.
Dans les grands romans modernes, et je reprends l’analyse de Milan Kundera, ce qui compte, c’est cela : que les personnages vivent librement leur vies, dans leur mouvement brownien, et qu’ils dessinent pour nous, lecteurs, un répertoire de situations, de sentiments : la jalousie, la passion, l’amour, la puissance, l’ambition… Pour Kundera, ce qui compte c’est l’ironie, au sens philosophique : le jeu des personnages les uns contre les autres, et contre l’auteur lui-même : un roman ne délivre pas de message, n’est pas un tract ou un porte-voix, c’est une sorte d’aquarium où les personnages, le texte, jouent infiniment une chorégraphie imprévisible. Kundera dit, en gros : «Les grands romans sont plus intelligents que leurs auteurs». dans la langue de Glissant cela donne : «La créolisation, c’est l’imprédictible des rencontres». Je crois qu’un grand roman c’est cela, contre les clichés, contre les vérités superficielles de la vie, un grand roman illumine d’un jour nouveau ce qu’on croyait connaître : c’est l’imprédictible des rencontres.
Voilà, j’en ai terminé.
Si je me résume, il me paraissait important de dire d’abord comment et pourquoi Glissant choisit Faulkner contre Césaire : pour lui ce sont les romans qui disent quelque chose de la vérité du monde. Et ce sont les Antilles, au sens large, qui disent quelque chose de la métaphysique du monde moderne.
Ensuite, il fallait montrer ce qu’était le Sud de Glissant, de Garcia Marquez, de Faulkner : un espace entre violence et beauté, où la quête des origines, la pluralité des histoires produisent un romanesque nouveau, celui du mystère, de la tragédie immobile.
Et puis enfin, montrer la modernité et l’acuité de la vision de Glissant : il théorise, en fait, quelque chose du roman moderne, dans toute son œuvre.
Encore une fois, cet intellectuel total est vertigineux d’intelligence, d’érudition, il a tout étudié, la philosophie, l’anthropologie et la psychologie, et il est difficile de résumer sa pensée en quelques paragraphes.
Je vais réellement terminer en citant ce passage du Tout-Monde. Vous connaissez peut-être ce qu’en Guadeloupe et en Martinique on appelle les «pacotilleuses». Glissant dit :
«Que font les pacotilleuses ? Elles tissent la Caraïbe et les Amériques, elles encombrent les cartons de cette pagaille de cartons et de paquets… Elles sont la relation. Disons, ce sera pour me vanter, que je suis le pacotilleur de toutes ces histoires ré-assemblées».
Merci, au Festival, d’avoir, toute cette semaine, pacotillé toutes ces histoires et tous ces romans.