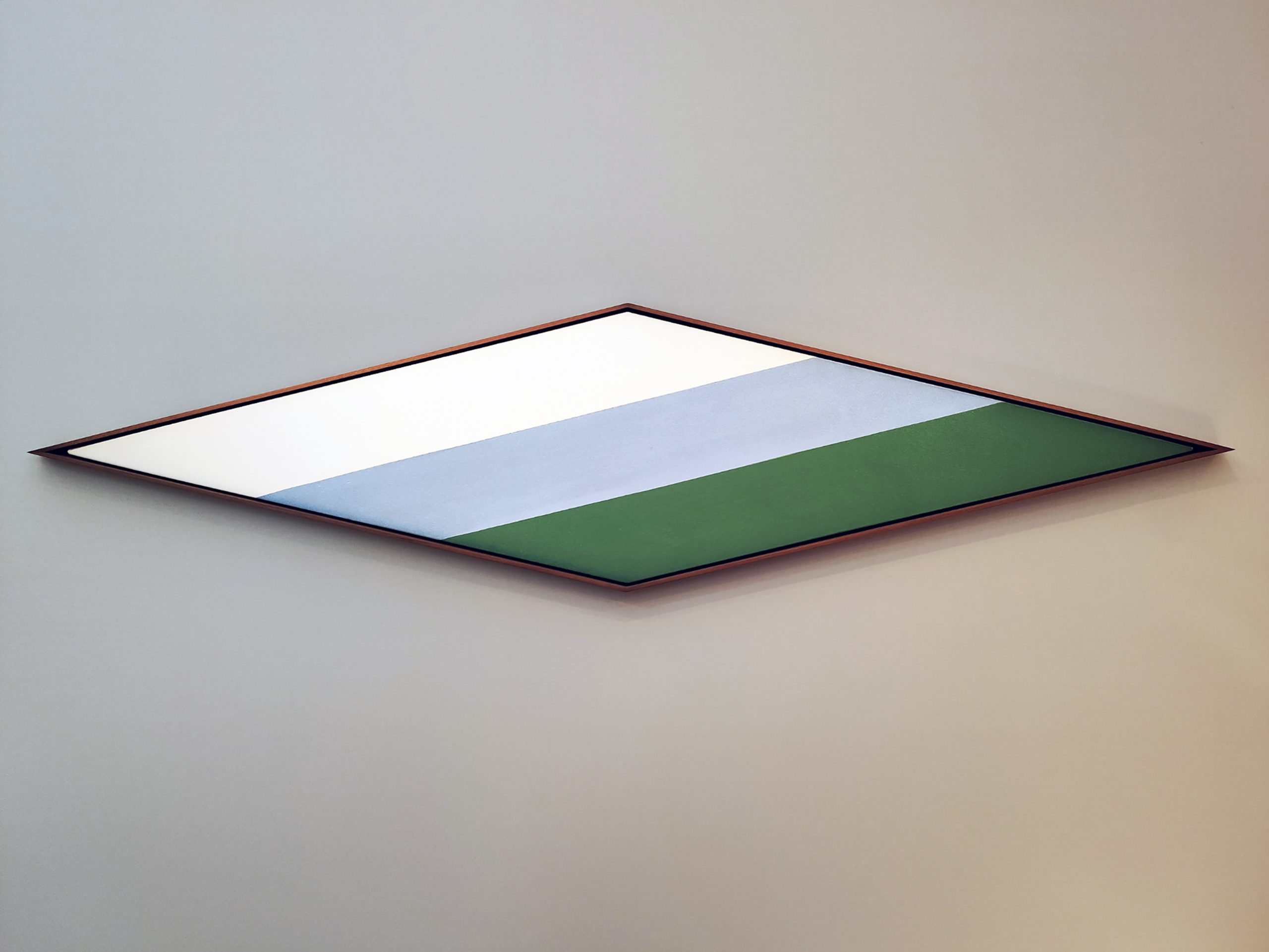Comme du temps du Salon et ses centaines de toiles accumulées sur les murs du Louvre, le critique aguerri qui doit faire la synthèse de l’exposition, repérer ce qu’il y a de meilleur et de pire, déceler et commenter les tendances qui s’affirment ou s’infirment a rarement plus de deux jours pour sillonner les cent voire deux-cent galeries qui se retrouvent pour les foires, ces grandes kermesses artistiques de notre temps. Si l’on compte qu’à Bruxelles chacune des galeries présentes montre bien une centaine, si ce n’est plus, d’objets, la tâche est ardue. Le critique perspicace, tout entier dédié à son noble rôle d’éclaireur, a développé des techniques pour déceler, dans les domaines qu’il lui a été donné de maîtriser, les pièces les plus marquantes, rares, originales ou exceptionnelles. A force de consommer de l’art, son œil identifie, classe et sélectionne rapidement. Il élimine, c’est son goût, certains domaines (les arts d’Afrique par exemple, à son grand regret) car il ne saurait trop quoi en dire si ce n’est des généralités, ou bien, afin de masquer son ignorance, il tenterait des mots d’esprit et des réflexions qui n’ont pas grand intérêt quand ce que l’on veut c’est connaître l’histoire qui se cache sous le masque sombre du Congo et derrière les étranges narines de la statuette Nok.

Le plus triste est que, malgré toute sa bonne volonté, quelques pièces parmi les plus intéressantes lui échappent toujours, même quand elles ressortent de sa spécialité. C’est le cas d’une tête en argent de saint, d’origine napolitaine et datant du tout début du XVIIIe siècle, que nous a signalé un ami heureusement versé dans l’orfèvrerie ancienne et à qui, dans ce domaine, rien n’échappe. Comment l’avoir ratée, cette effigie d’argent éclatante ? Son extrême naturalisme – avec les yeux révulsés vers le ciel, la lèvre supérieure relevée qui révèle les dents et ces mèches virevoltantes soulevées par l’extase – et, surtout, son éclatant miroitement en font difficilement une œuvre discrète. Rattrapons notre oubli car ce genre de portrait métallique est assez rare sur le marché pour qu’il mérite que l’on en dise au moins quelques mots.
Qui a visité la chapelle des reliques de saint Janvier, sise en la cathédrale de Naples, et le Trésor afférant sait de quelles prouesses d’orfèvrerie sont capables, par dévotion autant que superstition, les Napolitains. Les bustes reliquaires en bronze et argent de saints protecteurs (Naples en possède pas moins d’une cinquantaine, ce qui est très utile en cas de peste ou d’éruption de Vésuve) y sont légion. La légende dit que le Trésor de saint Janvier serait le plus précieux au monde, vu la quantité d’or, d’argent et de pierres précieuses employée pour en réaliser les pièces. On veut bien croire la légende quand on se rend sur place : la mitre de saint Janvier compte 3326 diamants, 198 émeraudes et 168 rubis. Où est passée la richesse de Naples ? Là, dans ce délire de dévotion.
Notre tête, appartenant peut-être à saint Sébastien, est attribuée à Lorenzo Vaccaro (1655-1706), sculpteur mais également architecte et peintre de renom, qui œuvra inlassablement dans presque tout ce que Naples compte d’églises baroques à la fin du XVIIe siècle. Son fils, Domenico Antonio est plus célèbre, il fait la transition, à Naples, entre les formes nobles et amples du baroque à celles plus chantournées, légères et compliquées du rococo.
Notre tête est assez simple, elle produit un « effet de portrait », dirait-on, réaliste ; on n’y retrouve pas l’emphase, la complication des courbes et contrecourbes propres à ce type de représentation car il lui manque son buste (le trou au bas du cou servait-il à l’y fixer ou bien était-ce là qu’était fichée la flèche qui fit de saint Sébastien le martyr que l’on sait ?). Les bustes de ces statues de métal étaient des prouesses de technique et d’ornementation : les artistes de Naples prenaient plaisir à reproduire avec tous leurs détails les arabesques infinies des parures liturgiques des saints évêques, leurs amples drapés et l’amoncellement des parures chatoyantes, qu’ils restituaient en variant les textures et les patines, en employant ensemble le bronze, l’or et l’argent pour créer des contrastes colorés. Rien de tout cela ici ; c’est ce qui fait l’intérêt paradoxal de ce saint Sébastien.
On attribue à Lorenzo Vaccaro beaucoup (trop ?) de ce type de pièces d’orfèvrerie. La galerie qui présente notre tête d’argent est prudente et la relie simplement à l’entourage du sculpteur. De tels bustes et chefs de saints ciselés se retrouvent à Naples bien sûr, dans les églises et dans les musées, mais également dans tout l’ancien territoire du royaume de Naples, c’est-à-dire le sud de l’Italie Sicile exceptée, dans les trésors des cathédrales et monastères des grandes villes. Phénomène de réplication, paradigme du centre qui produit et des périphéries qui reprennent les modèles, on imitait ce qui se faisait de mieux dans la capitale, voire, comble du luxe et de l’ostentation, on importait directement les œuvres des meilleurs orfèvres napolitains, tout comme on le faisait pour les tableaux. Qui sait donc si cette tête rutilante était destinée à une église napolitaine ou à quelque sanctuaire des Pouilles, de la Basilicate ou de la Calabre ?
Restons dans la statuaire puisque, en art moderne, les œuvres les plus attrayantes s’observent en ronde-bosse. Eugène Dodeigne, sculpteur français des formes éclatées, est mort en 2015. Il œuvrait entre la Belgique et le nord de la France. La galerie belge Francis Maere lui consacre une petite monographie particulièrement remarquable au milieu des accrochages d’œuvres disparates des murs environnants. Dans une pièce sombre, au milieu de la salle, une file de pleurants de pierre monumentaux, réduits à leur plus pure essence, entreprennent une marche immobile. Un mouvement aussi lent, aussi éternel que le roc est dur et qui semble décomposé entre les différentes figures, cinq, se transposant de gauche à droite. Plus que des pleurants, on oserait affirmer, à leur aspect sépulcral, que ce sont des mourants. Des êtres qui ont déjà abandonné la vie et qui, malgré leur marche, sont déjà voués à l’immobilité et au silence de l’au-delà. Ils marchent dans la mort, leur marche semble une errance sans but, elle n’a pas de fin, elle est infinie. Le sculpteur semble avoir travaillé au marteau piqueur plutôt qu’au ciseau pour exécuter ces grandes statues ; on a l’impression que les blocs minéraux ont été travaillés directement sur leur lieu d’extraction, dans la carrière. Les stries de la pierre forment les plis des manteaux qui transforment ces silhouettes gutturales, brutes et maigres, en des spectres affligés mais qui n’effraient pas. Il y a comme un reliquat d’humanité dans leurs expressions qu’on parvient à deviner à travers leur démarche et leurs courbures. Mais l’art minimal de Dodeigne nous autorise plusieurs points de vue, ne nous en privons pas : on peut aussi les voir, ces cinq menhirs, comme de simples concrétions rocheuses, des anamorphoses involontaires sculptées par mère nature et les outrages du temps ou bien abandonnées là par d’étranges civilisations oubliées dont on ne sait percer les secrets. Voilà, quoiqu’il en soit, de glaçantes et d’efficaces statues de cimetière, qui imposent le recueillement et invitent à méditer solitairement. Le père de Dodeigne, qui lui enseigna le métier, était tailleur de pierres tombales.

Restons décidément dans la statuaire puisque la galerie Fleury, de Paris, a pu acquérir un grand plâtre original (deux mètres dix de haut) d’Ossip Zadkine auprès d’un musée américain. Cela se confirme : avec cette sculpture et après le panneau de Niccolò di Pietro Gerini du musée de Los Angeles vendu par une galerie zurichoise, c’est bien auprès des institutions muséales des Etats-Unis qu’on fait les plus belles affaires. La statue s’appelle Homo Sapiens et représente, massifs et cubifiés, un couple dont l’homme a une tête gravée de profil à la Picasso et la femme une tête ronde et absente qui fait immanquablement signe vers les mannequins de De Chirico. Les deux portent les attributs des arts libéraux – équerre, livre, sorte de sphère armillaire, etc. Ce n’est pas l’homo sapiens au sens premier du terme, le nom scientifique de l’homme, ce n’est pas le couple générique de l’humanité. Il faut, semble-t-il, entendre au sens littéral la signification de la formule latine : homo sapiens, l’homme qui sait. Et qui, en tant qu’animal sachant, sait pratiquer les arts libéraux issus de l’intellect. Ce que nous savons nous, qui ne sommes pas particulièrement sachants en matière d’arts libéraux mais qui, en tant qu’homo sapiens, sommes dotés d’une petite once de bon sens et de discernement, c’est que le musée de Philadelphie vient de commettre une sottise. Une sottise ce n’est pas bien grave quand elle est réparable. Mais quand elle engage une perte irrémédiable c’est plus ennuyeux. Le musée a vendu un plâtre original des années 1930 d’un des grands sculpteurs de l’époque. Nous avons vérifié, il n’a rien de semblable dans ses collections. Le musée Zadkine à Paris possède une version en orme de cette statue. Le musée de Philadelphie, lui, a perdu l’original et n’aura probablement plus jamais l’occasion de le réacquérir, sinon à un prix très élevé. On ne comprend vraiment pas pourquoi l’institution américaine s’en est dessaisi, d’autant plus qu’il s’agissait d’un don de l’artiste en personne et de sa galerie new-yorkaise, la galerie Brummer. Joli pied-de-nez à la générosité (et à la mémoire) du sculpteur ! Espérons qu’un musée européen aura le bon sens d’acheter la statue pour la rapatrier de ce côté de l’Atlantique et permettre au plus grand nombre de continuer à admirer sa belle patine. Et, comme pour le Gerini, nous dirons tant pis pour les Etats-Unis.