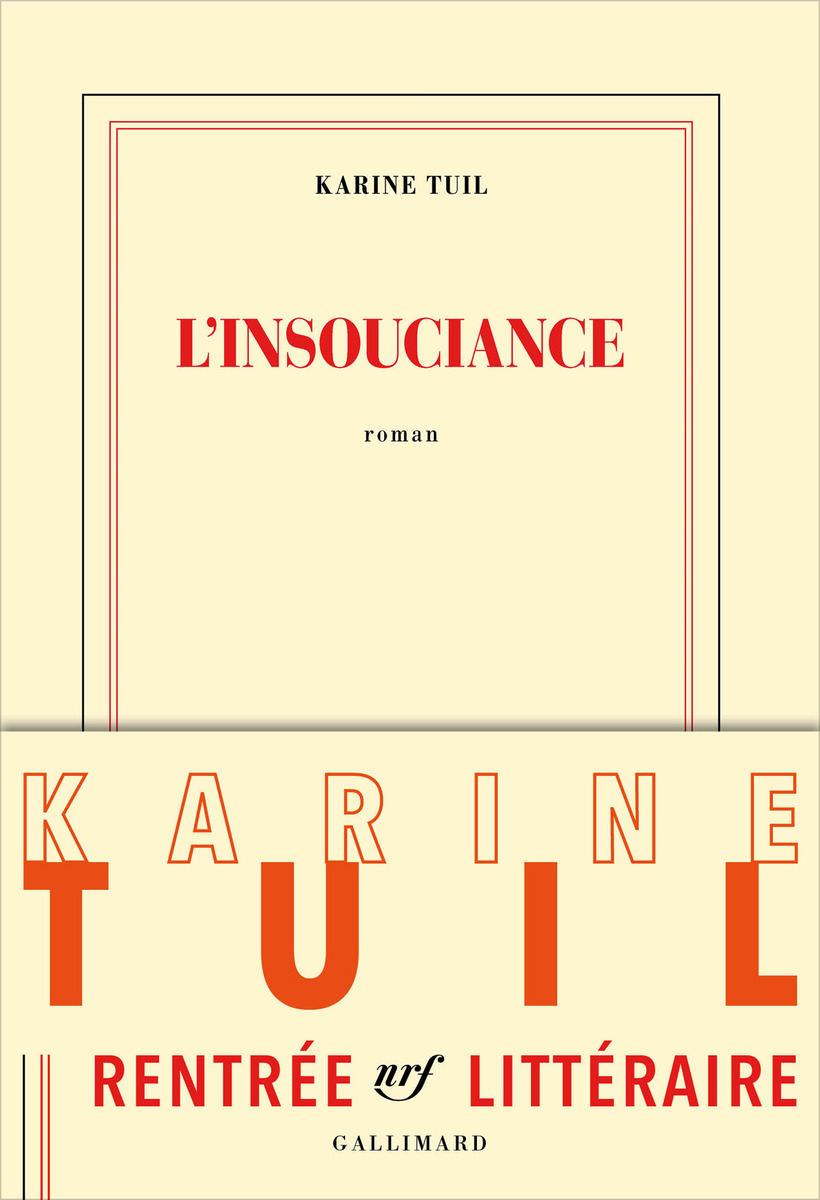Comment entrer, de plein fouet, dans le contemporain ? Comment tordre, littérairement, un réel qui cogne, et cogne fort ? Comment faire d’une actualité immédiate – à laquelle se substitue immédiatement une autre actualité – une matière romanesque d’évidence, et réussir à embarquer le lecteur dans ce qu’il connaît et redoute ? L’actualité n’est pas le contemporain, on le sait – ou, tout au moins, on le perçoit. Entre ces deux notions, le réel s’immisce. Karine Tuil, avec L’Insouciance, nous offre en cette rentrée un roman exceptionnel, qui brasse ce qui nous fait peur, qui montre ce que l’on ne veut pas voir, qui appuie sur des plaies béantes que l’on peine à suturer.
Romain Roller revient d’Afghanistan. Ce jeune lieutenant a perdu sur le terrain plusieurs de ses hommes, un de ces amis d’enfance rentre gravement blessé. Le voyage de retour suppose une escale, un sas de décompression. Ce sera un hôtel multi-étoilé de Chypre. Y naîtra une passion partagée, à la fois charnelle et amoureuse, avec la journaliste Marion Decker. Marion, élevée par une mère gauchiste et irréfléchie, puis ballotée à partir de l’adolescence dans différentes familles d’accueil, est mariée à François Vély, un magnat franco-américain de la téléphonie. Se mettent en place, dès les premières pages du roman, des assises sociales et économiques qui résonnent. Romain Roller est originaire de Clichy-sous-Bois, il y a côtoyé Osman Diboula, un éducateur devenu conseiller du président de la République. Voilà que le politique entre en scène, bouclant le cercle. Mais le social, l’économique et le politique ne suffisent pas à rendre compte de l’état d’une société, malgré ce qu’on nous rabâche. Y manquent l’intime – primordial –, l’artistique et le « communicationnel ». Karine Tuil ne s’y trompe pas, et élargit le cercle de perception. Elle va piocher dans l’actualité des dernières années – comment qualifier ce qui n’est pas encore de l’Histoire, et qui dépasse le simple fait divers, ou de « société » ? – l’affaire de la chaise inspirée d’Allen Jones. On s’en souvient : le jour du Martin Luther King Day de 2014, une mannequin russe, blanche et milliardaire, posait assise sur une chaise représentant une femme noire, ligotée en position érotique, et déclenchait un tollé médiatique. A partir de ce « fait médiatique », Karine Tuil fait coulisser ses engrenages fictionnels et sociétaux.
Elle assoit François Vély sur cette même chaise : reportage flatteur sur un chef d’entreprise en pointe, publié dans le supplément de fin de semaine d’un quotidien à gros tirage. Scandale. Colonialisme pas mort. Misogynie affirmée. Sexualisation. D’ailleurs, François Vély n’a-t-il pas débuté sa carrière de chef d’entreprise dans les sites pornos ? Et puis, Vély, c’est bien le nouveau nom sous lequel officie une famille Lévy, n’est-ce pas ? Le père de ce François Vély, au prénom si français, n’a-t-il pas changé son patronyme à la Libération, pour mieux intégrer les sphères du pouvoir ? François Lévy : pornographe, milliardaire, colonialiste et juif… Voilà, on y est. Le point nodal du roman, c’est le diktat identitaire. Toutes les situations mises en place dans le roman, tous les personnages gravitant autour de l’histoire d’amour de Romain et de Marion – oui, c’est une histoire d’amour, la permutation des lettres de leurs prénoms ne laissant aucune doute, ils sont faits l’un pour l’autre, ils sont l’un ET l’autre, ne signifient rien séparément – ne se définissent plus que par leur socle identitaire.
Ousman Diboula, revenons sur lui. Noir sans diplôme, homme de bonne volonté, adoubé-enrôlé par un président de droite, marié à une métisse sortant de Normale Sup’ qui évolue, elle aussi, à l’Elysée. Ousman se demande, parfois, si son épouse ne regrette pas son choix, si sa pente ne la poussait pas plutôt à se marier avec un blanc. Ousman, qui quitte la table d’un conseil élyséen lorsqu’on fait référence à sa couleur de peau et renoue avec un ami de Clichy. Qui est prêt à se laisser embringuer dans la mouvance des Indigènes de la République, avant de tourner casaque et de s’en remettre à la communication politique, à prendre la défense de François Vély pour des motifs d’ambition personnelle. Thibault, le fils de François Vély, se découvre juif et veut qu’on l’appelle du prénom de son aïeul, alors qu’il a été élevé en catholique dans les établissements les plus chics. Il porte à présent caftan et phylactères, veut étudier dans une yeshiva de Brooklyn, défie son père. Découverte d’une identité, rupture familiale pour cause de drame familial… Ne dévoilons pas tout. Karine Tuil brasse, dans L’Insouciance, quelques-uns des motifs qui déjà apparaissaient dans son précédent roman, L’Invention de nos vies. Mais elle les brasse différemment, donnant toujours à voir une carte mentale et sociétale de notre monde qui sonne vrai et fait frémir. La radicalité du fils de François Vély fait pendant à la conversion de l’ami d’enfance de Romain et d’Osman : Farid, converti radical, se donne pour justification la faillite de son entreprise de sweat-shirts. Conversion dans les cités et au sein des beaux quartiers. Choix de la violence ou de l’étude des textes.
La logique doit aller à son terme. François Vély, catholique d’ascendance juive, est kidnappé en Irak alors qu’il fait partie d’une délégation de chefs d’entreprises menée par Osman Diboula, à présent Secrétaire d’État au commerce extérieur. C’est la guerre. Sur tous les fronts. Au Moyen-Orient, et dans les cœurs. Il y a aussi, par exemple, le front d’Agnès, en marge – mais pas tant que cela – de l’histoire qui se joue sous nos yeux de lecteurs. Agnès, épouse de Romain, met en œuvre une tactique qui tient de Sun Tzu. La guerre, ce n’est pas seulement sur le terrain des conflits au Moyen-Orient, sous les ors de la République et dans les banlieues qu’elle se joue. Elle trouve sa place, aussi, au sein de ce qui fait tourner le monde depuis toujours, violence des violences : l’amour. Ou l’idée que l’on se fait de l’amour. La peur et la rage de n’être pas aimé. La fille de François Vély, autre exemple, tient un blog sur lequel elle s’épanche, sans prendre conscience des dégâts que cela peut engendrer. Communiquer, à l’ère numérique, tient de la théorie du chaos. Le mal-être personnel et familial mis en ligne par une adolescente déclenche des tsunamis. Oui, Karine Tuil s’empare du contemporain le plus immédiat pour tresser une intrigue imparable, mettre en scène des situations en vortex.
Cette lecture ne rend compte que partiellement du talent de Karine Tuil, et du foisonnement de son roman. Ne perdons pas de vue le littéraire : si L’Insouciance nous renvoie, de plein fouet, à notre réel qui cogne, il se place aussi pleinement sur la tradition littéraire de la torsion du fait divers et du fait d’actualité, et celle de l’allusion. François Vély, au plus profond de sa descente aux Enfers, s’interroge sur son mariage – contre-nature-culture ? – avec Marion, renvoyant à Charles Swann et à Odette de Crécy. Agnès, l’épouse de Romain Roller, est de ces femmes qui défendent corps et bien, et bec et ongles, une situation sociale basée sur la cellule familiale. Le compromis auquel aboutissent – mais quelle en est l’issue ? – le noir Osman revenu de disgrâce élyséenne et son épouse métisse renvoyée à ses obligations de grossesse (ne pas bouger du canapé, attendre la délivrance) est d’un bancal qui déconcerte, parfaitement prévisible. Mais où vivons-nous ? Dans quelle société ? Celle qui fait fi de l’âme, ce mot qui devrait signifier à la fois l’union de l’esprit et du corps, et l’idiosyncrasie de tout être humain en dehors de toute considération sociétale ? Celle qui produit de la haine sans le vouloir ? Celle qui tente de faire mais défait ? Celle qui s’en remet à la Communication et aux spins-doctors ? Le roman de Karine Tuil est en cela exemplaire : sur des situations réelles, transfigurées par le romanesque, L’Insouciance dit nos maux sans remèdes. La diffraction des épisodes, sans point de vue narratif à la première personne, fait froid dans le dos. Ce roman est comme un constat anticipé, puisant sa force dans le déjà arrivé ou l’imminent.
L’Insouciance ? Voilà un titre en trompe-l’œil. Soucieux nous sommes, et inquiets. Intranquilles. A quoi sert la littérature ? A nous faire rêver à des mondes meilleurs, à nous transporter au-delà du rêve, mais aussi, pour que le rêve puisse prendre forme, à nous forcer à la lucidité. Karine Tuil peint un monde contemporain et à venir, il ne tient qu’à nous de faire dévier la flèche de cet avenir affolant. L’Insouciance est un jalon incontestable de la littérature contemporaine. Entendons par là – et répétons-nous – un jalon qui enjambe l’actualité et veut cogner contre le réel. Comme un au-delà du réalisme. Un des très grands romans de la rentrée.