Avant de parler avec vous de Rosenzweig et de la réfraction de sa pensée dans la vôtre, nous aimerions savoir la place que tient la philosophie d’une manière générale dans les engagements qui sont les vôtres et dans votre action d’homme public.
Centrale, programmative, informatrice. Aucun de mes engagements n’est dissociable, je crois, de mes choix philosophiques profonds, anciens, articulés et qui sont à l’œuvre, en procès, dans mon travail. Mes combats politiques, autrement dit, sont des moments d’une stratégie philosophique. Ce ne sont pas des « applications » de ma philosophie. Ce ne sont pas je ne sais quels « travaux pratiques ». Ils font partie de l’aventure. Ils s’intègrent, si vous préférez, à ce que Jean-Toussaint Desanti appellerait un « destin philosophique ». Vous connaissez, n’est-ce pas, la théorie blanchottienne de l’intellectuel qui surgit lorsque l’écrivain pose son stylo ou lorsque le philosophe s’arrête, un moment, de philosopher ? Eh bien je n’y crois pas. Je ne pense pas que l’engagement soit le deuil éclatant de la philosophie ou de la littérature. Je ne cesse pas de faire de la philosophie, j’en fais juste autrement, quand je m’engage. Être un homme engagé, ce n’est pas interrompre le travail théorique – c’est lui donner un prolongement.
La pratique théorique se prolonge dans la philosophie et la philosophie inspire la pratique théorique. Il y a eu une bifurcation dans votre vie, c’est la rencontre des textes juifs. « L’Etoile de la Rédemption » a-t-elle joué un rôle actif, dès le début, dans cette conversion du regard ?
Ce qui est sûr c’est que texte juif a été et reste, pour moi, une manière de continuer, d’avancer. Je ne sais pas ce qui se serait passé si, après La Barbarie à visage humain, je n’avais pas rencontré le texte juif. Il y a une hypothèse qui n’est pas totalement exclue, c’est que je me serais peut-être arrêté là. Cela paraît bizarre étant donné le nombre de livres que j’ai produits depuis, mais je ne suis pas loin de penser que la lettre juive a été, vraiment, le carburant qui m’a permis de poursuivre mon questionnement. Alors, quelle place a tenu Rosenzweig dans ce processus ? On va en parler. Mais une chose est certaine. C’est que j’y suis venu très tôt, puisque je suis l’un des premiers, voire le premier, à avoir rendu compte, dès sa parution, de la traduction de « L’Etoile » par Alex Derczansky et Jean-Louis Schlegel.
Votre article s’intitulait « Avez-vous lu Rosenzweig ? » et il est paru dans le Matin de Paris, en I982…
Exact. J’ai compris à ce moment-là deux choses. J’ai compris l’importance, pas toujours dite, que le texte de Rosenzweig avait eu pour Lévinas. Rappelez-vous le « trop présent pour être cité » dans Totalité et Infini. Je vois tout de suite que c’est la pièce manquante dans ma lecture de Lévinas. Je comprends le retentissement de sa pensée sur celle de Lévinas, et que c’est dans le texte rosenzweigien que Lévinas a puisé, par exemple, sa compréhension du totalitarisme comme une propriété, non du politique, mais de l’être. Et, aussi, les outils conceptuels qui lui ont donné ressource pour le combattre.
Vous avez donc été l’un des premiers à faire connaître en France ce nom de Franz Rosenzweig. Son œuvre demeure-t-elle pour vous actuelle ?
Oui, elle demeure actuelle. Si on veut penser contre l’hégélianisme d’abord (ce qui, soit dit en passant, reste l’ardente obligation, la tâche de nos générations), la manière la plus radicale et la plus féconde reste celle que nous enseigne Rosenzweig. Il y a Bataille. Il y a Kierkegaard. Et il y a, donc, Rosenzweig : troisième modalité de l’insurrection contre Hegel, troisième variante de la sécession vis-à-vis de l’idée qu’il n’y a pas d’instance supérieure au tribunal de l’histoire. Et, des trois, c’est la résistance proposée par Rosenzweig qui me semble, j’y insiste, la plus riche et la plus forte. Actualité, donc, en ce sens-là. Actualité brûlante en ce que je ne connais, au fond, que Rosenzweig qui nous donne les moyens de penser un universel qui ne soit plus en dette vis-à-vis des catégories de l’hégélianisme… Et puis vous avez, deuxièmement, la prodigieuse fécondité de sa pensée pour les juifs et dans les débats juifs. Rosenzweig, comme vous savez, se battait sur deux fronts. Celui de l’assimilation qu’il voit poindre et qui l’obsède à partir de la nuit mystique dans la petite synagogue orthodoxe du rabbin Petuchowski à Berlin. Et celui du sionisme auquel il se refuse à réduire le destin juif et dont il débat avec, en particulier, Gershom Scholem. Or qu’est-ce qui se joue dans ce double refus ? Qu’est-ce qui se joue dans cette querelle qu’il cherche à ce qu’il appelle parfois l’assimilasionisme ? En quels termes cela peut-il se penser ? Aujourd’hui, dans ces débats, on peut difficilement faire l’économie de Rosenzweig, même si on prend le parti, comme c’est mon cas, de Gershom Scholem. Mais les termes du problème sont posés là, de manière admirable et définitive. De même que la réponse à la grande question posée par toute la philosophie occidentale et par les penseurs juifs : qu’est-ce qui, dans le judaïsme, a permis à celui-ci de vivre et non seulement de survivre ? Qu’est-ce qui a permis au judaïsme d’étinceler et de briller de mille feux ? Qu’est-ce qui a conjuré le destin de tous les peuples qui est de se résoudre en Etats ? Le seul qui donne une réponse à peu près convaincante à ces questions, c’est Rosenzweig.
Rosenzweig tient à distance tout horizon de normalisation, et fait l’éloge d’un peuple qui, de façon immémoriale, s’est résolu à camper à la marge des nations. N’est-ce pas une vision du judaïsme qui tend d’une manière ou d’une autre vers une forme d’orthodoxie ?
Bien sûr que non. La thèse de Rosenzweig, c’est que le judaïsme est le mot manquant de l’hégélianisme. La preuve que le hégélianisme ne marche pas, c’est la persistance du judaïsme ou, pour parler comme Jean-Claude Milner, du « nom juif ». Si Hegel a raison, le judaïsme doit disparaître. Si le judaïsme ne disparaît pas, c’est que Hegel a tort. Voilà le théorème de Rosenzweig. Qu’est-ce qui fait, à partir de là, que le judaïsme ne disparaît pas ? Qu’est-ce qui fait que, non content de ne pas disparaître, il est beaucoup plus qu’un résidu, une séquelle, un fossile ? C’est le rapport à la loi, le rapport à la langue, le rapport à la terre. Une loi plus importante, plus éminente que l’histoire, cette Weltgeschichte et ses verdicts iniques. Une terre pour une large part imaginaire, ou qui ne peut être aimée concrètement que si elle a aussi un siège dans l’imaginaire. Une langue, enfin, qui garde en elle quelque chose de non profane, car elle renferme une part de sainteté. Tels sont les trois éléments qui, pour Rosenzweig, constituent la singularité juive. Ce triptyque ne définit pas l’orthodoxie, il est la texture même du judaïsme. La résurrection de l’hébreu par Israël, c’est la preuve que Rosenzweig avait raison. L’attachement à Israël des juifs de la Diaspora, qui est quand même incroyable et défie toutes les réprobations, c’est une autre preuve que Rosenzweig avait raison. Et la persistance, dans le monde, de quelques uns qui pensent que l’histoire n’a pas le dernier mot, cela prouve encore que Rosenzweig avait raison – et cela n’a rien à voir avec l’orthodoxie.
Dans un récent colloque au Collège des Bernardins, vous avez fait référence au lien entre judaïsme et christianisme en le qualifiant de « lien de vie ». Qu’entendez-vous par là ?
Longtemps, la vision de la chose par les meilleurs des chrétiens a consisté à dire qu’ils avaient un lien de filiation avec le peuple juif et avec l’Ancien Testament ». C’était la théorie de Mauriac, c’était celle de Maritain, c’était celle des grands convertis des années 30, à la manière de Max Jacob. Or un lien de filiation, c’est quoi ? C’est un lien où il est supposé que le père mourra pour laisser sa place au fils. C’est un lien qui vous fait vouer un respect infini à l’Ancien, l’honorer comme on honore un parent voué à la mort – mais c’est la mort, oui, qui gagne toujours à la fin. Un lien de vie, c’est une chose totalement différente. Et Rosenzweig, justement, est le premier à dire ce que cette inspiration mutuelle contient de miraculeusement vivant. L’Etoile est le livre qui narre comment l’absolu s’est scindé originairement et qui montre que le judaïsme et le christianisme sont comme les deux voies d’accès à cet absolu, égales en dignité et fraternelles. Deux voies fraternelles, oui. Mais une fraternité sauvée. Pas la fraternité d’Abel et Caïn. Pas celle de Romulus et Remus. Pas celle, non plus, de Jacob et Esaü. Une fraternité rédimée, rédemptionnée. Un lien entre deux langues de l’être qui en sont comme la double voie d’entrée. C’est ce que j’appelle un lien de vie.
Pour vous, judaïsme et christianisme sont appelés conjointement à participer à la « réparation du monde », au « Tikkoun olam» ?
Oui, je suis très frappé par la régression de l’antisémitisme chrétien. Je ne dis pas qu’il a disparu. Mais il est, clairement, en voie de marginalisation. Et je suis heureux de voir, en retour, le nombre grandissant de juifs qui, sans la moindre concession sur le fond, sans baisser la garde, sans même céder à la tentation de l’œcuménisme auquel il est arrivé à Lévinas de recourir, cessent de considérer les chrétiens et, en particulier, les catholiques comme leurs ennemis. Je suis conscient de cela. Je pense que, face aux périls d’aujourd’hui, nous sommes profondément alliés.
Et vous partagez aussi la vision Rosenzweigienne de l’islam, qu’il met à part dans son dispositif théorique ?
Il ne connaissait pas l’islam. Le temps lui a manqué pour mener, sur l’islam, le travail de pensée qu’il a conduit sur le christianisme. Et cela, non, je ne le partage pas. Je pense, moi, qu’il y a un islam, dont je ne sais pas s’il est majoritaire ou minoritaire, mais avec lequel le même lien de vie existe, bien sûr.
Pardon d’entrer dans un domaine intime, mais quand vous avez eu des proches qui ont été tentés par la conversion, est-ce qu’il vous est arrivé de ressentir cela comme un échec personnel ?
Pas « des » proches. Une proche, et c’est déjà bien assez. Je l’ai vécu comme un échec personnel, bien sûr. Etant donné le rôle que la vie m’a conduit à jouer chez les miens, dans ma propre famille, je ne pouvais pas ne pas percevoir ainsi l’événement auquel vous faîtes allusion. En revanche, j’ai la grande chance, et je vis comme une grande joie, d’avoir deux enfants dont le rapport au judaïsme aurait pu être compliqué mais qui se sentent et se vivent aussi juifs que vous et moi. Un chagrin, donc, peut-être. Mais aussi des joies, de très très grandes joies.
Lors d’une conférence prononcée à l’Université hébraïque de Jérusalem, vous avez dit que « l’histoire récente du peuple juif est pleine d’hommes et de femmes qui ont cru, profondément cru, que c’était soit l’un soit l’autre, et que l’universalité était le deuil éclatant de l’être juif. » Est-ce Rosenzweig qui vous a permis, et qui a permis à votre génération, de comprendre que l’universalisme n’était justement pas le deuil éclatant de l’être juif ?
En tout cas, cela a nourri puissamment ma réflexion, parce que c’est la vraie question pour un Occidental. Est-ce qu’on peut penser un universel qui ne soit ni paulinien, ni romain, ni grec ? Parce que voilà : les universels meurtriers, pas seulement pour les juifs mais aussi pour les juifs, ce sont ces trois-là. C’est l’universel grec qui pense que tout sentiment, tout acte, et évidemment toute parole, sont réductibles à un logos transparent. C’est l’universel romain qui, sous prétexte de dire qu’on est égal, et traité également, de Carthage, à Lutèce, et de Constantinople à Rome, arase les différences et hâte le triomphe de l’homme quelconque au détriment de tous ceux qui ne sont pas quelconques et des juifs éminemment. Et puis il y a l’universel paulinien qui, lui, radicalise l’universel grec et l’universel romain par le phénomène de la conversion. La question est de savoir s’il y a un moyen de sauver l’universel de ces trois impasses-là, de ces trois calvaires-là. Et oui, je pense qu’on trouve chez Rosenzweig les rudiments de cette sortie, la formule d’une autre conception de l’universel, c’est-à-dire d’une parole qui s’adresse, aussi, à ceux « qui ne sont pas ici, aujourd’hui, avec nous » pour reprendre la parole de l’Exode…
Et sans Rosenzweig, vous n’auriez pas eu cure des peuples suppliciés et expulsés de l’historico-mondiale, vous ne seriez pas allés au fin fond de l’Afghanistan ou dans les Monts Nouba, vous n’auriez pas prêté attention au sort des Libyens confrontés à la folie sanguinaire de Kadhafi, ou aujourd’hui, à celui des Ukrainiens sous la férule poutinienne?
Si, bien sûr, je m’y serais intéressé. Mais pas de la même manière. Et certainement pas en juif. Sans Rosenzweig, au fond, j’aurais été schizophrène. J’aurais, si vous voulez, continué de penser dans la double lignée de mes pairs et de nos pères, de mes maîtres et de nos sages. J’aurais vécu une contradiction tragique entre les deux injonctions d’être juif et de remplir mon devoir d’homme. Pourquoi pas d’ailleurs ? Le sentiment du tragique n’est ni le plus désolant ni le plus deshumanisant. Les Grecs ont vécu toutes les circonstances de la vie en proie à ce sentiment du tragique. Mais bon. Il se trouve que j’y ai échappé. Et que, si j’y ai échappé, si j’ai pu conjurer cette vision tragique de la vie, si j’ai su dépasser le déchirement, l’inconciliabilité des deux registres, si j’ai pu conjoindre ces deux pans de mon être qui auraient été, sans cela, comme les deux lèvres d’une plaie éternelle, c’est grâce à Lévinas et grâce, surtout, oui, à Rosenzweig.
A Francfort, Rosenzweig a fondé une école d’apprentissage, le « Lehrhaus », une « maison d’étude » où il s’est efforcé de mettre le plus concrètement en pratique la dimension fondamentale de la transmission. Le judaïsme, dans la compréhension phénoménologique qu’il en a livré, ce n’est pas une identité biologique, ce n’est pas seulement une identité religieuse et communautaire, ce n’est évidemment pas une identité seulement nationale, c’est une identité qui existe par l’étude et qui procède de l’étude. Comment cette centralité de la transmission innerve-t-elle votre approche du judaïsme?
Pour moi, cela fait plus que l’innerver ! Cela constitue ma conception même du judaïsme ! Je suis juif par ma mère et mon père. Je suis juif par ma mémoire et par un certain nombre de fidélités fondamentales. Mais je crois, d’abord et avant tout, qu’être juif, c’est étudier l’être juif, c’est penser l’être juif, c’est transmettre l’être juif. Et c’est même la vraie grandeur, à mes yeux, du judaïsme : cette étude inlassable, cette vérité jamais atteinte, inachevée, et qui fait corps avec la vision que les juifs ont du messianisme. Il n’y a pas de judaïsme sans étude. C’est la thèse du Gaon de Vilna que je citais déjà dans « Le Testament de Dieu ». En substance : « Je préfère un savant à la foi vacillante à un ignorant à la foi solide comme un roc ». Il faut le rappeler à tous ceux qui ont le judaïsme paresseux et qui croient qu’on est juif par inertie, sur le même mode, une fois pour toutes. En un sens, bien sûr, on est aussi juif une fois pour toutes. Mais il ne faut pas se lasser de rappeler qu’il n’y a pas plus vivant que ce judaïsme. Il faut dire et répéter que, de toutes les formes de spiritualité, c’est la plus vivante ; que, de tous les monothéismes, c’est celui qui s’enrichit le plus constamment, le plus intensément et qui ne se satisfait jamais de ses formes provisoires. La pensée juive, la spiritualité juive, ce n’est jamais la répétition. Ou, si c’est la répétition, celle-ci n’est jamais l’essentiel. Et, à l’inverse, ne mérite d’être répété, redit, que ce qui est aussi creusé, médité, objet de recherche incessante, talmudisé. J’ai beaucoup de respect pour le christianisme. J’ai beaucoup de respect pour l’islam. Mais je ne vois ni chez les uns ni chez les autres, cette propension à éterniser le travail de vitalisation du texte. Là, pour moi, est une part – essentielle – du génie du judaïsme. Ce dialogue inlassable. Cette mise au rouet perpétuelle. Cette dispute âpre, où nul ne feint ni ne joue la concorde, et dont il nous appartient d’aiguiser les angles au lieu de les arrondir. Là, est la vraie force du judaïsme. Là son irremplaçable rôle dans l’économie du monde. Heureusement qu’il y a des juifs pour penser, en même temps, que l’essentiel de la foi repose sur des textes, et que les textes ne valent que s’ils sont, pour reprendre l’expression de Lévinas, « comme les ailes repliées de l’esprit » – l’étude ayant, ensuite, vocation à déplier, déployer ces ailes… Heureusement, oui, qu’il y a les juifs pour penser, dire, prophétiser cela.


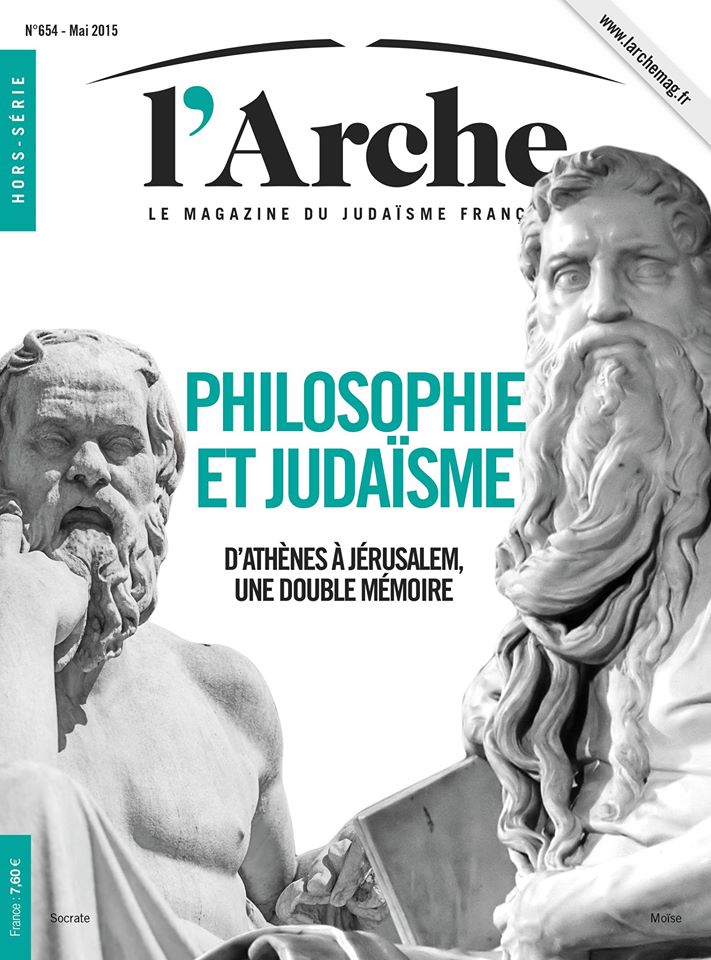






L’importance de Franz Rosenzweig dans l’élaboration d’une pensée israélienne de la relation du judaïsme au monde, aux Nations s’est incarnée sur Gerschom Scholem puis sur David Flusser – à l’origine juif allemand de Prague – dont l’enseignement ne fut traduit en hébreu que récemment alors que paraissant les leçons talmudiques de’Emmanuel Lévinas en Israël et aussi en hébreu. Alex Derczansky a été un érudit important qu’il faut rappeler en raison de son enseignement du yiddish et sa recherche qui enjambe judaïsme et christianisme qu’il connaissait remarquablement. Il y a à Jérusalem des « héritiers ». Je ne crois pas que l’on puisse, même pur des raison éditoriales parler de « l’Etoile », mais en totalité de l’l’Etoile de la Rédemption/Der Stern der Erlösung », livre paru en allemand en 1921. Il faut aussi souligner actuellement le rôle de F. Rosenzweig et Martin Buber dans la traduction de la Bible en allemand. Tous deux, Martin Buber à Jérusalem (Ecce Homo) ont profondément été marqués par une quête existentielle de la jonction judaïsme-christianisme qui a aussi marqué le théologien Hans Urs von Balthasar.