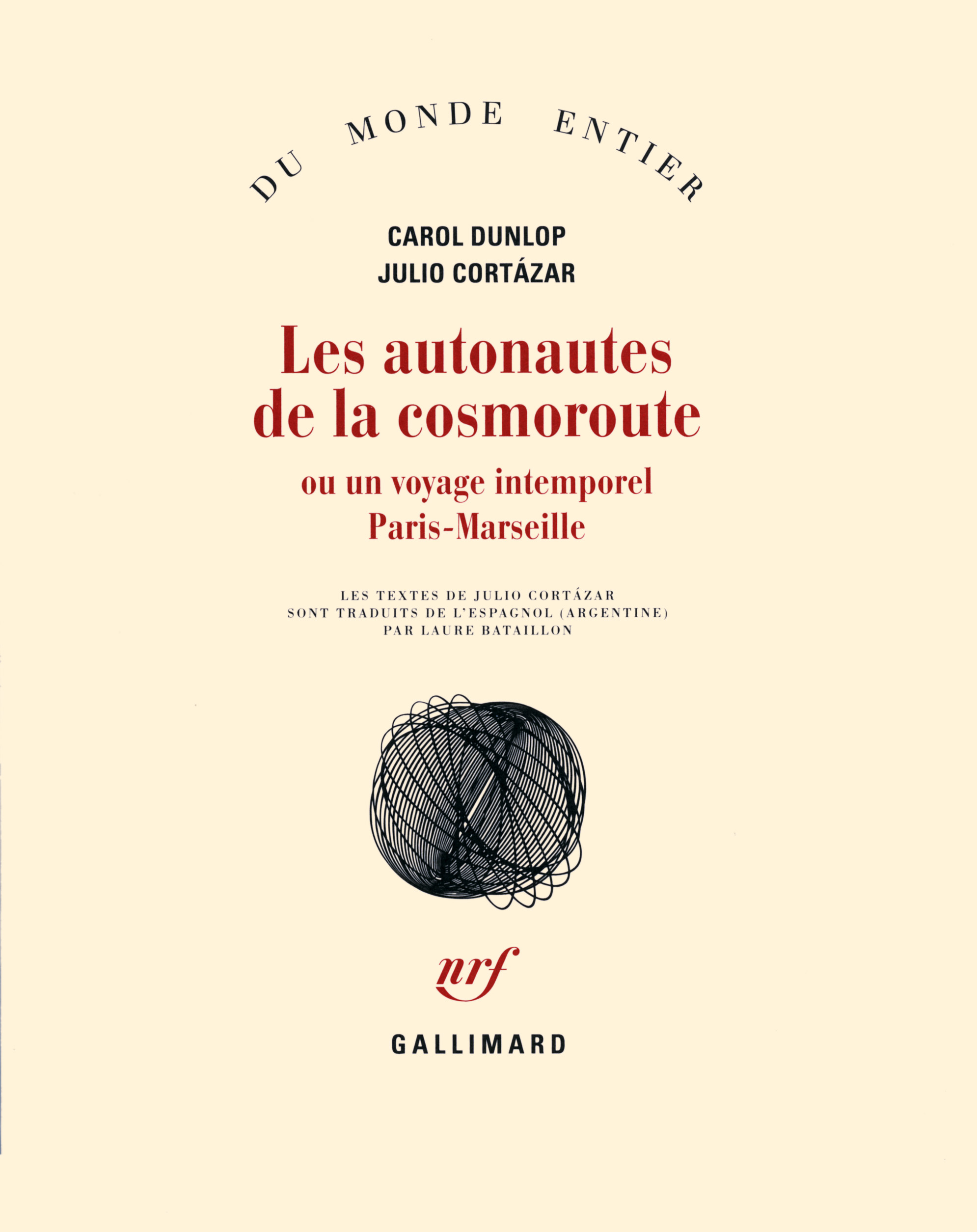Le 23 mai 1982, Julio Cortázar et sa compagne Carol Dunlop partent de Paris à bord d’un combi Volkswagen immatriculé 9369 XE 75. Ils arrivent à Marseille le 23 juin. Durant un mois, ils ont vécu sur l’autoroute du soleil, y ont passé des vacances étranges, en explorateurs de parkings et d’aires de repos. Le projet est né en 1978 et tient en quatre points :
1 – Faire le voyage de Paris à Marseille sans quitter l’autoroute une seule fois.
2 – Prendre connaissance de chaque parking, à raison de deux parkings par jour, en passant toujours la nuit dans le deuxième quel qu’il soit.
3 – Faire des relevés scientifiques de chaque parking, et prendre note de toute observation pertinente.
4 – S’inspirant peut-être des récits de voyages des grands explorateurs du passé, écrire le livre de l’expédition.
Cortázar et Dunlop s’en tiennent exactement à ces modalités. Dans leur journal de bord sont consignés les relevés bi-journaliers de température extérieure, de description des parkings et des boutiques de l’aire s’il y en a ; sont mentionnés également les repas pris par les explorateurs, et l’orientation du combi à l’arrêt. Mais Julio et Carol ne sont pas des voyageurs comme les autres. Ils s’appellent entre eux « le Loup » et « l’Oursine », ont baptisé leur véhicule Fafner comme le dragon wagnérien. Dans les relevés de leur journal de bord on trouve des précisions inattendues. « Première tâche : donner à boire à Fafner (essence ordinaire car c’est un dragon aux goûts simples) ». Le même jour – 28 mai – cet événement : « Nous rencontrons un ver ». Et plus bas sur la même page, une observation scientifique des limaces qui, apprend-on, ont une nationalité avérée : elles sont allemandes.
L’expédition est strictement cadrée dans l’espace et dans le temps, respectueuse du protocole établie. Mais pour ce qui concerne les observations scientifiques et le récit de voyage, c’est la grande imagination cortazaro-dunlopienne qui est à l’œuvre. Cortázar envisage dans toute son œuvre la réalité brute observée comme un terrain plat et vague, sur lequel il faut bâtir du sens. Il a expliqué dans un mico-récit que le miracle se produit non pas quand on fait tomber ses lunettes et qu’elles restent intactes, mais bien au contraire quand ces mêmes lunettes, protégées par un bel étui rembourré, voient leurs verres se briser en mille morceaux lorsque l’étui tombe sur le sol. Dans Les Autonautes de la cosmoroute, la réalité brute observée, plate réalité de béton et d’asphalte, de pluie diluvienne ou de soleil de plomb, de camions et de caravanes, de bruit de trafic incessant, se transforme invariablement en réalité décalée, observée avec minutie mais selon un angle tout personnel, et tout poétique. Un angle créatif. Carol Dunlop, lorsqu’elle photographie les poubelles sur les aires de repos, dit – et montre ! – que ce sont des chevaliers teutons. Une petite fille vêtue de blanc, un peu surprise par les toilettes à la turque et qui demande « tu sais comment on fait pipi, madame ? » devient un ange descendu du ciel : « Pourquoi envoie-t-on des anges si peu au courant des usages terrestres, et pour quelles missions ? ». Julio et Carol, le Loup et l’Oursine, vivent un temps flottant, conduisent un dragon, s’assoient, quand ils font halte, sur des « horreurs fleuries ». Ces fauteuils relax, revêtus d’un tissu aux motifs criards, supportent dans l’oxymore de leur surnom tout le paradoxe de cette odyssée Paris/Marseille. On rit, on écrit, on photographie. On est à la fois en vacances et en suspens. L’autoroute est un territoire à part que l’on fait sien, quand les autres se contentent de le traverser sans le voir. On est sur les marges du ruban d’asphalte, adepte de la lenteur tandis que les autres filent, attentif au paysage et à la diversité alors que l’automobiliste se concentre sur la route et sur son point d’arrivée. On n’est déjà plus de ce monde, peut-être. On sait en tout cas qu’on vit un temps volé à la légalité – il est en effet interdit de demeurer si longtemps sur l’autoroute, Cortázar et sa compagne devront « tricher » à l’arrivée à Marseille, et déclarer qu’ils ont perdu leur ticket de péage. Un temps volé, aussi, à la vie elle-même. Car il s’agit bien du dernier voyage heureux.
Les pages préliminaires du livre sont magnifiques. Tout en élégante sincérité, Cortázar raconte l’horrible année 1978, la maladie de Carol Dunlop, la peur et le soulagement. Le frigo se dérègle, le robinet d’eau froide crache de l’eau brûlante, les cadres voltigent et les couteaux mordent. Forces obscures au travail. « Deux jours plus tard, les forces obscures s’emparèrent de l’Oursine ; deux semaines durant il sembla qu’elles gagneraient la partie. Les diables ignoraient toutefois que les oursines captent la lumière même au milieu de l’obscurité ». La sensibilité s’exprime par le chemin détourné du fantastique quotidien. Il est difficile de dire sa peur quand on se refuse à l’étalage. Le lecteur est admis – invité – dans la confidence par la banalité des mots de tous les jours (« ambulances », par exemple), mais il y entre après la pirouette salvatrice du détournement de la réalité. Peut alors tomber la phrase : « L’expérience laissa nos deux comparses épuisés physiquement, surtout par ce qu’elle avait comporté d’ambulances, de peurs et de nuits de veille pour tous les deux ». Quatre ans après le déchainement des forces obscures de 1978, la promenade autoroutière peut être envisagée. Elle ira jusqu’à son terme : Marseille.
Dès lors, ce voyage dans les marges du ruban d’asphalte, voyage bien réel, entrepris comme une expédition scientifique, prend des allures de combat personnel. Le Loup et l’Oursine voyagent avec – et dans – un dragon protecteur. Ils suivent la route toute tracée mais dérobent à un temps fixé – le trajet autoroutier Paris/Marseille ne prend que quelques heures pour le commun des mortels – des jours et des jours. C’est le dernier voyage, le dernier vrai voyage à deux, projeté et réalisé. Un parcours qui mène à la mer*. L’autoroute surchargée, balisée, droite, à sens unique, Julio et Carol la transforment en itinéraire intime, balisé à leur manière. Pour parvenir au terme du voyage, ils font la semaine des quatre jeudis, sérieux et rieurs, confiants et attentifs.
Ils nous donnent, dans Les Autonautes de la cosmoroute, un récit scientifique, fantastique et engagé. Les avancées de la guerre des Malouines rythment la narration. Les droits du livre ont été versés au « peuple sandiniste du Nicaragua ». Mais ils nous livrent surtout un récit intime où la mort est travestie en figure mythologique à vaincre : « J’ai si souvent chuté dans le gouffre noir que je sais marcher dans l’obscurité. Et couper mille fois, dix mille fois de suite la tête de l’hydre, sans avoir l’illusion de l’empêcher de poursuivre encore et toujours sa sinistre croissance ». Ainsi parle – écrit – l’Oursine. Carol Dunlop meurt le 2 novembre 1982, retour d’un voyage au Nicaragua. Sur l’autoroute du soleil, elle aura passé ses dernières vacances.
Notes
* « Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar / que es el morir » écrivait Jorge Manrique au XVe siècle. (Nos vies sont les fleuves / qui vont se jeter dans la mer / du mourir. Traduction personnelle)