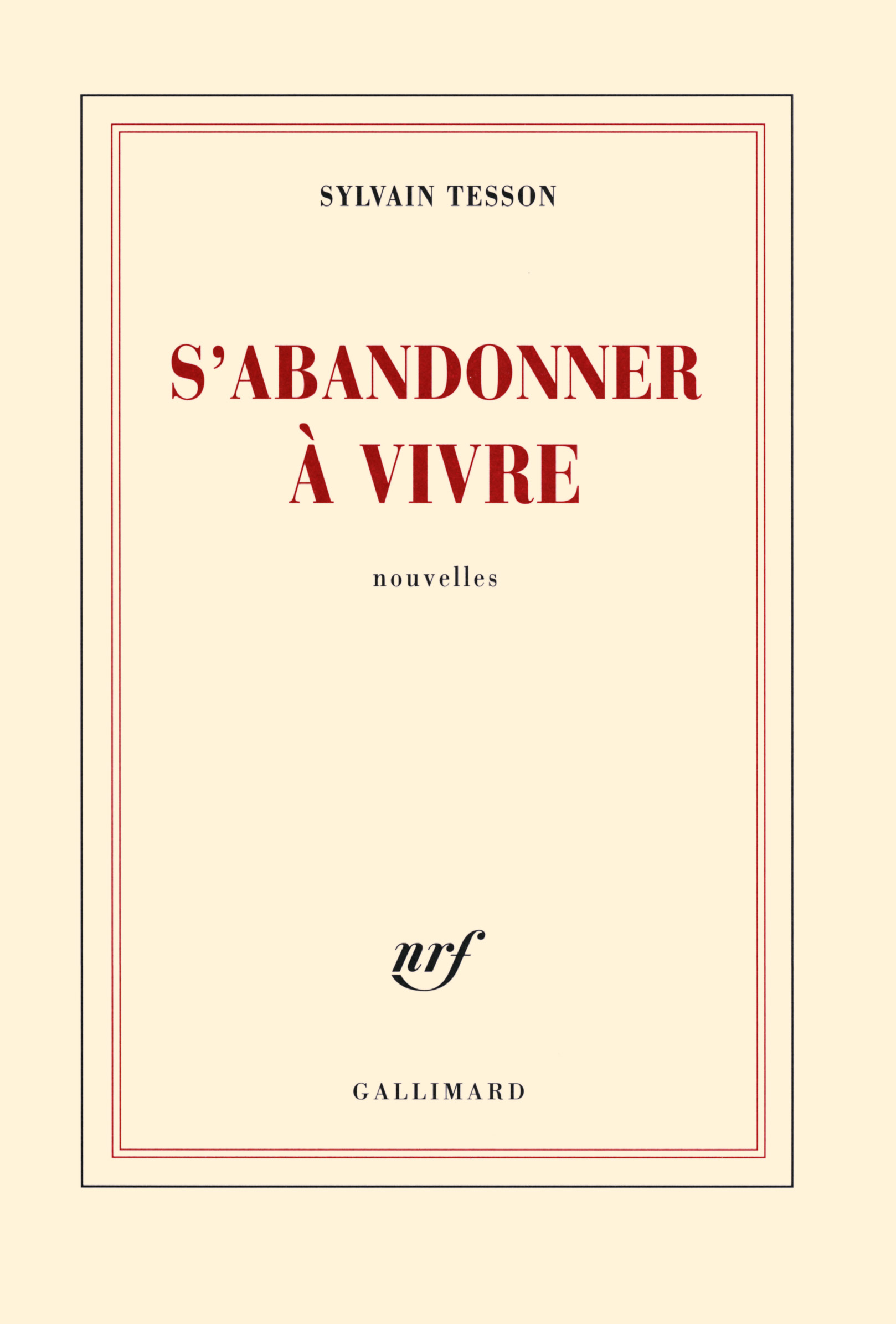La littérature est un art assez simple. Si vous y réfléchissez, un roman, finalement, ce n’est qu’une très bonne idée délayée dans quelques dizaines de pages. Il faut simplement veiller à quelques détails, comme la vérité humaine de vos personnages, et la concordance des temps de vos subjonctifs. La nouvelle ? Pas plus compliqué. Dans l’Après-Midi d’un écrivain, Francis Scott Fitzgerald nous donne ce mode d’emploi formidablement utile : pour lui, il faut tâcher de composer un récit « genre morceau d’anthologie (…) simple antithèse empathique, aussi conventionnel qu’une nouvelle pour magazine populaire, et plus facile à écrire. Ce qui n’empêcherait pas beaucoup de gens de trouver ça excellent, parce que ce serait mélancolique et simple à comprendre. » Avec un sens certain de l’autodérision, au coeur d’un recueil d’une dizaines de nouvelles assez joyeuses et difficiles à expliquer, Sylvain Tesson nous rappelle ce bon conseil. Aussi, faussement convaincu de ce mantra, il propose au lecteur de son « S’abandonner à vivre » une clé de lecture efficace et bienvenue : dans le fond, tous ses personnages, alpinistes ou clandestins du Niger, talibans ou écrivains, amants baladeurs et facteurs poètes, tous seraient donc mus par le « profigisme », un concept aussi typiquement russe que le caviar et les matriochkas, concept commandant à chacun d’accepter son destin et le cours de la vie, d’embrasser l’ordre du monde et jouer loyalement cette intrigue souveraine, écrite par un empereur maître de vous comme de l’univers. Cette slave intellection de la nécessité, discernement du fatal plus grand que soi-même, il s’agirait de les retrouver à chacun des portraits ou tableaux que Sylvain Tesson nous propose, ce qui, je le crois, n’épuise en rien un recueil multiple en dix-neuf récits, où les gens s’embrassent, se tuent, s’évadent, gravissent des montagnes et se précipitent dans des malheurs, escaladent des douleurs et voyagent au pays de leurs amours, parcourant sans cesse des bermudes dans lesquelles brillent parfois les feux d’une amitié silencieuse. Dans son essai très remarqué, et remarquable, Dans les Forêts de Sibérie, cet écrivain ermite, qui racontait six mois d’hibernations dans une cabane de la toundra, s’amusait de son nom, tesson, qui évoque, avec la lumière d’une brisure irrémédiable, la totalité effacée mais en suspens, et l’on ne pourrait dire mieux que cela : ce recueil, bien plus qu’une morale illustrée, c’est la vie dans ses chaos et ses épiphanies, ses annapurnas et ses grands cols, la vie en une constellation d’intrigues, en mille focales et cent tessons.
Ainsi, on pourra lire l’histoire géniale d’un couple improbable où chacun diffère de son double (« cette anomalie leur tenait lieu de mortier »), la description sublime du barrage des Trois Gorges, ou bien encore l’aventure hilarante d’un amant obligé de s’enfuir par le balcon où il s’avance lesté de son habileté de chamois, avant de s’écraser au sol avec la douleur de fêlures innombrables augmentée de celle, plus urticante, de se voir secouru par le mari qui, en fait, était non seulement médecin mais encore de retour de week-end (a-t-on le droit de spoiler ainsi une nouvelle ? Tant pis, il vous en restera dix huit). On assiste aussi au duel ironique et absurde d’un fou de Napoléon et d’un maire soucieux de l’ordre public, où l’on comprend que Sylvain Tesson n’est, dans le fond, pas encore tout-à-fait russe, puisqu’il fait de Borodino une victoire française (Tolstoï n’est pas franchement de cet avis). Vous dénicherez d’ailleurs une typologie éclairante, en cinq espèces, des habitants de la Sibérie, ainsi que cette tirade, parfaite pour séduire une russe sans se ruiner en vodka, tirade où il est question de « la fesse orthodoxe : un bulbe arrogant, durement galbé et haut perché ». On croise au fil des pages où l’on s’abandonne à lire, des employés de poste formidables (« les facteurs sont les messagers du destin. Ils ne distribuent pas le courrier, ils battent les cartes de l’existence »), des prostituées, pour le coup, mélancoliques, des djihadistes crétins, des camarades de cordées, qui, sans un mot, cisèlent des apothéoses, car, on le sait, entre certains êtres les mots ne comptent pas, puisque « la distance est l’ingrédient des amitiés vraies ». On pense, avec ces historiettes ironiques et élégantes, vives et touchantes, au Jim Jarmusch de Night On Earth, au portraitiste amusé mais amical de Coffee and Cigarettes. Cela pourrait être faussement gai, écrit avec le petit doigt levé et la litote ricaneuse, mais, c’est toujours profond, comme, au hasard, ce départ d’un clandestin pour Lampedusa : « Personne ne lui cria bonne chance », personne n’avait jamais assisté à un départ. On ne savait pas faire les adieux. Les mouchoirs qu’on agite sur le bord des chemins, c’est pour les gens qui possèdent du linge ». C’est que Sylvain Tesson détient sans conteste un supplément d’âme qui fait la différence. L’énergie des steppes donne du sang au raffinement parisien, car chez tout autre d’un peu habile, de hussardement goguenard, cela sonnerait insupportablement affecté, façon homme pressé, panama, orient express et gants crème, mais ici, cette déambulation tout autour du monde ne souffre d’aucun snobisme ni d’aucune grimace de cocktail d’après le safari. Tous les personnages, sont, comme leur auteur, à une autre altitude, et, de la même façon que les gens de la montagne nous semblent toujours, avec leur souffle large et leurs joues vives, étonnamment plus nets, plus colorés, plus vivants, cette littérature d’un alpiniste trouve une authenticité supérieure, un teint pur et rubicond digne des neiges éternelles. Tout sonne vrai, avec allégresse. Au final, donc, on referme ce livre, pamphlet contre tout esprit de pesanteur et apologie subtile de l’amor fati, en se souvenant du Raskolnikov des dernières lignes qui « était incapable de réfléchir longuement, de concentrer sa pensée sur un objet quelconque, de résoudre une question en connaissance de cause ; il n’avait que des sensations. La vie s’était substituée chez lui au raisonnement ».