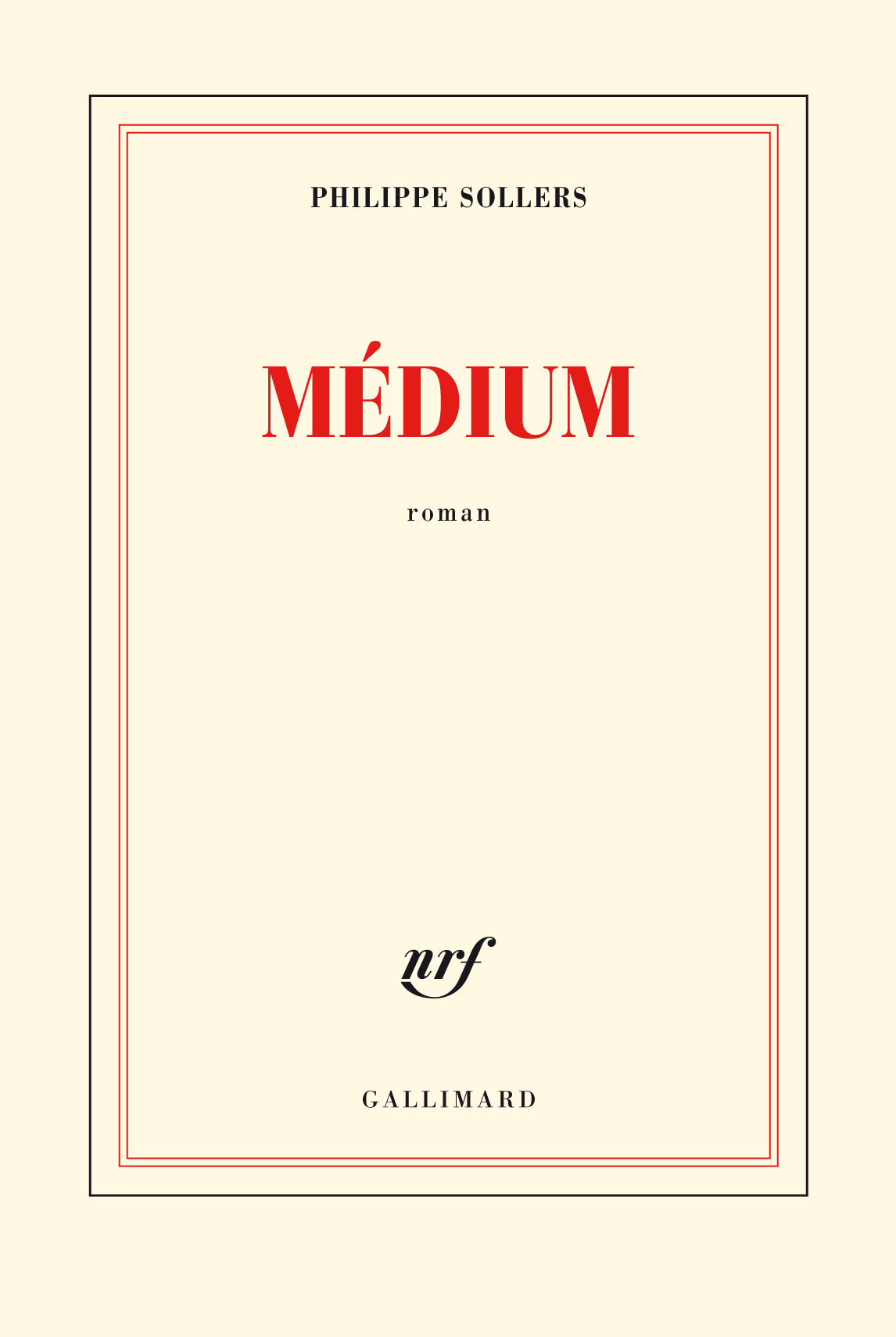« Eh bien, la magie continue ». Ainsi commence le Médium de Philippe Sollers, que Gallimard nous propose sous l’appellation « roman ». Oui, un roman, avec une dramaturgie et quelques péripéties, un avant et un après, des personnages et des décors, un narrateur et un point de vue. Prenons Médium comme un roman. Comme le roman de Loretta, la « vive jeune fille qui aide son grand-père veuf à ranger les chaises et les tables » du restaurant La Riviera, à Venise. À La Riviera, on donne au narrateur du professore, ils sont comme ça les Italiens, ironiquement révérencieux mais sincères dans la déférence. Professore, dottore, le titre dont on vous affuble est une vérité cachée sous le masque. Après tout, nous sommes à Venise. Sous le masque du professore se cache le narrateur qui dévoile l’écrivain.
Cet écrivain-là rédige à l’encre bleue et à la plume d’or. Dans l’appartement qu’il loue à Venise dans un quartier que les touristes ne hantent pas, et qu’il rejoint en fin de semaine après avoir fait ses devoirs parisiens, il écrit la nuit, dort tout l’après-midi, se fait masser par Ada. Ada, la quarantaine flamboyante, nue sous sa jupe les jours de plaisir donné, murmurant des « je t’aime » au client écrivain, le parsemant de baisers pointus après avoir malaxé plantes de pieds et colonne vertébrale. Ada l’ardente. Deux femmes dans le roman, inconciliables et complémentaires, Loretta et Ada. Loretta, qui suit une trajectoire romanesque à peine effleurée – libre, fiancée, mariée, mère – et Ada, immuablement dispensatrice de plaisir monnayé. La magie continue du désir. La fête. La seule façon d’envisager la vie.
Car la vie est folle. À cette folie du temps – rendue sur le mode grinçant et railleur, il y en a pour tout le monde : ouvriers, modestes, petits-bourgeois ; enseignants, universitaires, psychanalystes ; journalistes, confrères écrivains – le professore oppose et propose une contre-folie. La contre-folie est une manière de lucidité allègre, de joie noire et scintillante. Qui passe par la drogue, son acmé et sa redescente. Qui passe par l’écriture du monde, celui que l’on observe et que l’on fréquente, celui que l’on rêve, qui est enfui ou à venir. Et par quelques exercices « spirituels », comme lire Saint-Simon en pleine nuit. Le monde contemporain manque d’un Saint-Simon à sa (dé)mesure. La Venise du narrateur est une ville de liberté libertine, cernée par les paquebots déversant leurs flots de touristes et leurs pourvoyeurs de paradis artificiels. Saint-Simon, dont nous entendons la voix en citations aiguës, presque en divagation mais prestement recentrées sur l’essentiel du professore – la magie, celle de la langue française, que l’on savoure et cisèle à Venise – rythme un temps qui n’est pas le quotidien ambiant, mais qui le dénonce.
Dans Médium, on n’entend pas que Saint-Simon. On y croise Proust, aussi, bien sûr. Mais on revient au duc, toujours, et à son descendant affirmé. Sollers, brillantissime en la sérénissime, met à jour le sillon manquant entre le XVIIe et le XXe/XXIe, entre le duc et lui : Lautréamont. Duc, Ducasse. Balancement de la phrase et glissement ordonné du « fond ». Regardons et lisons : « ‟Les perturbations, les anxiétés, les dépravations, les envies, les trahisons, les tyrannies, les impiétés, les irritations, les acrimonies, les incartades agressives, les remords, les hypocrisies, les impuissances, les blasphèmes, les asphyxies, les étouffements, les rages…” Le médium Lautréamont, ayant repris son identité d’Isidore Ducasse, trace des mots que Saint-Simon lui dicte ». Le médium. Pas le voyant rimbaldien, non. Le médium. Le voyant anticipe et crée à partir de rien, ou presque. Le médium s’appuie sur l’existant, comme Ducasse, selon Sollers, continue l’œuvre saint-simonienne. Le médium a à voir avec la mort, donne à voir à partir des morts. Ce mot, « médium », est singulièrement présent en cette rentrée de janvier, sur deux plans littéraires radicalement différents [1]. Chez Sollers, le « médium est massage » – allusion aux prestations d’Ada la masseuse sensuelle – et aussi passation. De pouvoirs, celui des mots et celui de l’observation, celui du détachement et de l’implication. Le professore, client du restaurant La Riviera, penche vers le détachement impliqué. L’âge est une donnée qui force à l’ironie et Venise une ville qui pousse à l’engagement léger. Le jeu de mots extirpé de la sentence-titre de McLuhan renvoie à une erreur typographique, paraît-il (« message », « massage », erreur que McLuhan aurait approuvée pour son allusion à « mass age»). Sans doute Sollers s’amuse-t-il de tout cela, de la théorie des médias comme de la marche du monde. Car le « médium », c’est aussi – surtout ? – ce liant indispensable à toute bonne peinture à l’huile. Ce qui lie et dilue, ce qui modifie la consistance de la pâte…
La pâte, c’est la vie même : l’individuelle – l’égoïste – et la globale. À Venise, la notion même de « globalité » semble inepte. Pas de théorie fermée à la terrasse de La Riviera. Simplement un homme prônant une contre-folie malicieuse. À opposer à une folie collective et aveugle. Mais, peut-être que la contre-folie se contrefout de tout cela, au fond. Le vieux grand-père de Loretta est mort, ses obsèques sont tout juste évoquées. Ne reste du vieil homme que son leitmotiv « c’est la vie ». Pour Sollers, la vie est vénitienne, l’écriture salubre, le salut taoïste : « il est 5 heures du matin, et j’écoute Radio-Shanghai, à Venise, sur ondes ultra-courtes. L’émission, en français, est hyperclassique, et s’appelle Médium ». Il s’agit, sans doute, de trouver la Voie, de différencier le vide du néant ; d’entendre la voix de Saint-Simon sous celle d’Isidore. De combler les vides – les lacunes – de la transmission et du rendu du monde aux rives de la lagune.
Que Loretta, la figure vive du livre – du roman – soit qualifiée parfois de « squelette » est un pied-de-nez de plus à la mort ambiante. Morts le Grand Siècle et son train, mort sans doute ce qui nous cerne et que l’on côtoie. Restent nos restes mortels que l’on entretient par la lecture, la drogue et la jouissance. Nous durons, semble nous dire Sollers. Nous sommes là vivants, malgré tout. Et nous aimons. La chair, les livres, l’amour et l’idée de l’amour. Que l’on se souvienne de – ou se reporte à – la délicieuse conversation sur quatre vers des Deux Pigeons de La Fontaine entre Philippe Sollers et Dominique Rolin : « Voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines ». La rive est celle de la lagune, et de la vie. Voyageons. Et posons-nous, en pigeons vénitiens. Annotons Saint-Simon, citons-le. Et jouissons. Tant que faire se peut.
Le Médium de Sollers est une manière d’invitation sauvage et cultivée à la résistance allègre. La contre-folie prônée nous sauvera – peut-être – du « sac de chaos ». On nous le souhaite.
[1] Hubert Haddad publie chez Zulma, le 2 janvier 2014, un roman intitulé Théorie de la vilaine petite fille, qui retrace – à sa manière, somnambulique et révélatrice – l’histoire des sœurs Fox, les deux Américaines qui les premières ont affirmé être entrées en contact avec les esprits. C’est dans l’Amérique de la deuxième moitié du XIXe qu’apparaît le terme « médium » lié à la communication avec les morts.
Médium de Sollers : la résistance allègre
par Christine Bini
7 janvier 2014
A propos du dernier roman de Philippe Sollers