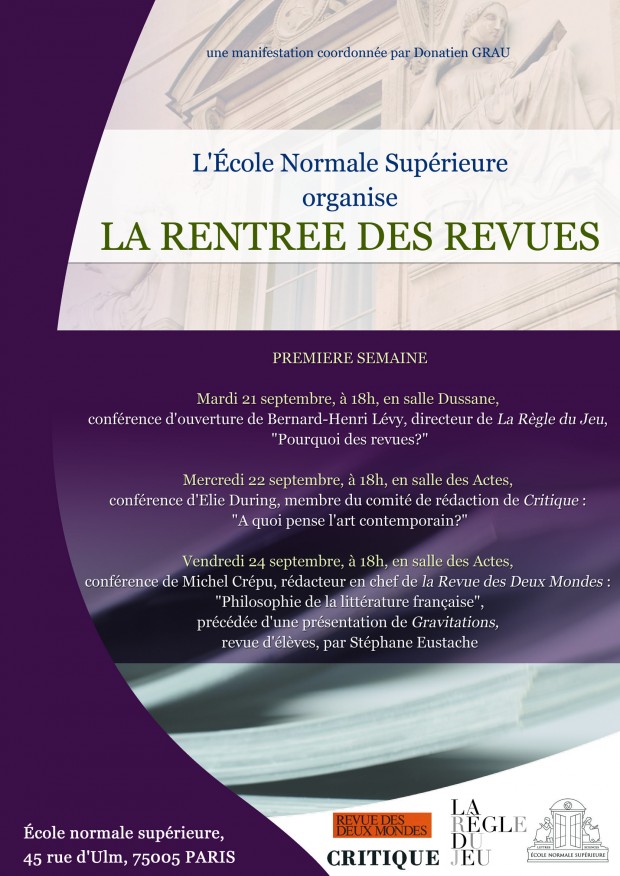Qui conteste, aujourd’hui, que la philosophie est un art? Et, parmi les arts, sûrement l’art le plus remarquable? Pourtant, qu’on puisse réduire la pensée à un art, autrement dit à une tékhnê – à une technique – n’allait pas de soi jadis : thèse révoltante que, seuls, des sophistes pouvaient soutenir, et justement pas des philosophes. Platon chassait les techniciens de sa République comme Dieu chassait Adam et Eve du jardin d’Eden. Sophistes, peintres, poètes, pêle-mêle. Et voilà que les philosophes se comparent aux artistes que Platon assimilait à des ignorants, au mieux, à des charlatans, au pire. Quelle ironie! Et quelle horreur! – du point de vue de Platon.
C’est ce déplacement que Bernard-Henri Lévy met en jeu dans les Aventures de la vérité. Platon quitte l’histoire de la philosophie pour gagner l’histoire de l’art. Changer d’histoire, ce n’est pas rien. Platon croyait avoir programmé La République ; il n’a écrit qu’un roman. Socrate n’est qu’un personnage. La République où le Vrai coïncide avec le Beau et le Bien ne s’est pas édifiée. Platon pariait qu’il accomplissait une performance. Il ne révèle que sa défaillance. Or, précisément, c’est sa défaillance qui fait de La République un admirable roman – une admirable peinture.
La vérité n’est pas forcément belle. Elle n’est pas, non plus, forcément bonne. Peu importe, Platon ne se plaçait pas dans l’actualité. Il peignait un monde. Il créait une œuvre. Puisque la différence essentielle a disparu entre une peinture et une œuvre philosophique, pourquoi ne pas organiser un espace où l’on pourrait les exposer ensemble? Mais est-il si sûr qu’elle ait disparu? Voilà l’expérience que fait Lévy dans Les Aventures de la vérité, pour voir si elle a disparu vraiment.
La nécessité de l’allégorie
Le lieu où les philosophes se retrouvent prisonniers du monde de l’art, ce lieu, précisément, c’est la Caverne allégorique dont il s’agit de sortir pour fonder la République ; mais la Caverne où éprouver, aussi, la présence d’un instrument dont Platon ne dit rien.
Pourquoi n’en dit-il rien ? Cet instrument, Lévy ne suggère pas moins sa présence, pourtant lui non plus n’en prononce jamais le nom. Cet instrument, peut-on vraiment en parler? Ou faut-il nécessairement passer par une allégorie?
Quittez la Caverne pour passer dans la salle suivante, vous ne fonderez évidemment pas la République. Vous fonderez l’Église. Or l’instrument est toujours là. Invisible, mais là. L’Église ne peut se passer du mode allégorique qui conditionne la pensée selon Platon, ni de l’instrument qu’elle met en jeu.
Ce dispositif que Lévy restitue à la fondation Maeght n’est pas qu’un dispositif historique. C’est un sentiment. Voilà Vera Icon, littéralement «la véritable image», Véronique – en l’espèce une jeune femme, une sainte.
Une figure mythique découle de la nature. Or, la nature, c’est purement et simplement l’ignorance, selon Platon. Une figure allégorique procède d’un raisonnement, elle enseigne un savoir, elle représente une idée.
Formée, semble-t-il, par un théologien nommé Gervais de Tilbury au début du XIIIe siècle, l’allégorie de Véronique ne produit pas moins une hérésie au regard de Platon. Une image matérielle ne peut pas être vraie.
Un peintre qui représente un charpentier ne se fait pas la moindre idée de ce qu’est réellement un charpentier. Le portrait du charpentier sera ressemblant. La ressemblance ne vous apprendra strictement rien. Vous pourriez aussi bien voir le charpentier. Et alors? Qu’est-ce que vous saurez? Toujours rien. Vous n’aurez toujours pas la moindre idée de ce qu’est réellement un charpentier [1].
Regardez Véronique. Elle tient le linge où s’est impressionné et révélé le visage de Dieu. – Qu’est-ce ça change? L’image de Dieu ne vous apprend rien, non plus, sur ce qu’est réellement Dieu. – Oui, mais il ne s’agit pas que d’une image. Il s’agit de l’instrument dont il vaut mieux ne pas parler. Véronique délivre un savoir. Vous commencez à vous faire l’idée de ce que en quoi consistent l’instrument et sa fonction. L’instrument ne sert pas qu’à fabriquer une image, il laisse entrevoir comment se fabrique une idée.
«Pourquoi, lors d’une éclipse de soleil, si l’on regarde à travers un tamis, un feuillage ou à travers deux mains entrelacées, les rayons se projettent-ils sous la forme d’un croissant lorsqu’ils atteignent le sol?» demandait Aristote. – «L’explication est la suivante : il y a deux cônes de lumière, le premier entre le soleil et le trou, le second entre le trou et le sol, dont les sommets se rejoignent.» Et d’énoncer le principe de construction d’une chambre noire. Mais n’édifie-t-il pas l’Eglise? «Est-ce pour la même raison, demandait encore Aristote, que la lumière forme une tache circulaire lorsqu’elle passe par un trou rectangulaire? [2]»
Supposez qu’un architecte ait fait percer une fente dans la voûte d’un temple, et que son ouverture épouse une forme rectiligne, la voûte devrait logiquement renvoyer sur le sol un rectangle de lumière de même forme que la fente. Or, si vous observez un disque de lumière sur le sol, c’est que s’est opérée une réfraction cinématographique dans la fente et qu’elle renvoie maintenant sur le marbre à vos pieds l’image arrondie du bleu du ciel.
Approchez-vous, penchez-vous sur ce disque, vous y distinguerez, dans un flou sublime, des oiseaux, des nuages, le soleil, voire le visage même des dieux. Rien n’est plus facile que d’obtenir ce genre d’effets dans une pièce obscure, et à un illusionniste un tant soit peu habile de les sophistiquer.
L’allégorie de la Caverne nous ramène devant l’écran d’une salle de cinéma, d’un téléviseur ou d’un ordinateur. L’écran de projection, les anciens Grecs en profitaient déjà. La vue était aussi aliénante pour Platon qu’il le sera pour Debord. Penser, c’est se libérer de la vue – du moins de la vue matérielle, quitte à requérir une vision, mais une vision virtuelle, purement mentale, d’une tout autre sorte que la vision actuelle.
Mais qu’est-ce qui prouve que ce soit vrai? Pourquoi la pensée ne procèderait-elle pas de la même opération que la vue? Opération physique, quand elle sollicite l’oeil ; opération métaphysique, quand elle sollicite le mental ; mais qui exigent toutes deux le même processus : réfraction, impression, révélation. Appelez cela comme vous voudrez. Saisissement, illumination, extase. Penser, c’est comme voir – même si, évidemment, c’est mieux que voir : c’est voir véritablement.
Voilà ce qu’enseigne Véronique en déroulant l’écran où se projette le visage du Christ. Si on ne se limite pas à admirer la ressemblance de la peinture avec la nature, si on comprend également à quelle cause elle est due, alors l’art n’est pas forcément le support de la mythologie. L’art peut servir de vecteur à la théologie, à condition encore que le théologiencontrôle la validité de l’allégorie.
Voir et savoir ne sont plus sans rapport. Véronique «photographie» la vérité ; ni tout à fait peintre, puisqu’elle ne peint pas d’image, au sens propre, elle la recueille sans pour autant agir sur cette image ; ni tout à fait philosophe non plus, puisqu’elle ne conçoit pas la vérité, elle ne la crée pas, elle la saisit.
Voir appartient aux hommes. Savoir appartient à Dieu. Mais, entre les deux, une réfraction est possible. N’y a-t-il pas deux cônes de lumière : le premier entre Dieu et la vérité, le second entre la vérité et les hommes, dont les deux sommets se rejoignent pour former l’allégorie vraie ? L’allégorie pure : non plus l’idée de l’idée ; mais l’allégorie de l’allégorie.
Si Voir n’est pas Savoir, Voir ressemble à Savoir. Alors pourquoi craindre de faire de la publicité à Dieu? Véronique n’aliène pas son public. Elle ne profite pas de la tékhnê pour le maintenir dans l’ignorance. Au contraire, elle met la tékhnê au service du savoir.
Position stratégique, dont Lévy repère l’émergence avec l’âge catholique. Toutefois, cet âge n’a pas d’âge. Ou, s’il en a un, il est toujours aussi présent. Ce n’est pas un temps, c’est un aspect des choses.
Platon songeait qu’il suffisait d’éliminer l’ignorance pour faire fusionner le Vrai, le Bien et le Beau. Le monde actuel n’était pas destiné à durer. Quelle erreur! – Et alors? Reste le monde virtuel. Ce n’est pas rien.
La position platonicienne, lorsqu’elle se cabre pour devenir radicale, Lévy rappelle qu’elle est la position du taliban.
Véronique prévoit qu’on ne pourra jamais éliminer le mal. Le mal ne se confond pas avec l’ignorance. Le mal, ça peut être le savoir – le savoir mauvais quand, précisément, il ne coïncide qu’avec le virtuel. La distance qui sépare Véronique de l’image qu’elle présente, cette distance met en rapport l’actuel et le virtuel. Si ce rapport ne s’effectue pas, alors le savoir ne sert qu’à faire du mal.
«Il m’est apparu que le temps n’est rien d’autre qu’une distance», écrivait saint Augustin [3]. Entre l’actuel et le virtuel – c’est-à-dire entre l’homme et Dieu –, la distance ne s’abolit jamais. Mis en rapport, l’actuel ne fusionne pas pour autant avec le virtuel. Si Véronique peut saisir la vérité, elle ne peut pas la coproduire avec Dieu. Véronique prend la position augustinienne. Position intéressante ; en tout cas, c’est celle qui intéresse le plus Lévy dans les Aventures de la vérité. Seulement, elle implique une confession.
La nécessité de l’autoportrait
«Il se peut bien, songeait Foucault, que Le Déjeuner sur l’herbe et l’Olympia de Manet aient été les premières peintures «de musée» : pour la première fois dans l’art européen, des toiles ont été peintes – non pas exactement pour répliquer à Giorgione, à Raphaël et à Vélasquez, mais pour témoigner, à l’abri de ce rapport singulier et visible, au-dessous de la déchiffrable référence, d’un rapport nouveau et substantiel de la peinture à elle-même, pour manifester l’existence des musées, et le mode d’être et de parenté qu’y acquièrent les tableaux.» Révolution dans l’histoire de la peinture, mais également dans l’histoire de la littérature. «Flaubert est à la bibliothèque ce que Manet au musée», concluait Foucault [4] .
Pourquoi Manet ? – Parce qu’au Louvre, à l’époque de Manet, on classait les œuvres chronologiquement, et par écoles, selon les impératifs que l’histoire de l’art assignait au musée. Pour se situer dans un musée, il fallait déjà que le musée existe.
Seulement, ce n’est pas au Louvre qu’on a commencé à classer les oeuvres. Ce n’est pas, non plus, au XIXe siècle. C’est à Florence, au milieu du XVIe siècle, dans la fameuse galerie qui relie les Offices au palais Pitti.
La galerie des autoportraits – où retrouver la présence de l’instrument dont il vaut mieux ne pas parler, mais dont les peintres se souciaient plus que jamais quand Giorgio Vasari organisa la galerie en inventant, et le Musée, et l’histoire d’art. Vous quittez l’Église pour entrer au Musée. Et l’instrument vous lance toujours son défi.
En 1620, Henry Wotton, un diplomate anglais en ambassade en Allemagne, rendit visite Johannes Kepler, l’astronome. Kepler l’initia à ses observations au télescope et à sa science du ciel, mais il lui montra également d’admirables dessins. Wotton ne se doutait pas que Kepler était un artiste.
«Kepler finit par me raconter le comment de la chose», rapporte Wotton. «Il a une petite tente noire qu’il peut planter où il le veut. Bien fermée et sombre, elle ne présente qu’un trou, d’environ quatre centimètres de diamètre, auquel il applique un long tube muni d’une lentille convexe fixée au trou, et d’une concave à l’autre bout. Tendu jusqu’au milieu de la tente, il capte les radiations visibles de tous les objets situés à l’extérieur, qui tombent ensuite sur un papier disposé pour les recevoir.»
Nul ne sait quand les peintres commencèrent à utiliser des chambres noires. Léonard de Vinci fut le premier à l’évoquer. Les premiers traités où la technique de la caméra est exposée parurent à Venise à la fin du XVIe siècle. Technique déjà très élaborée. Toutefois, en observant Kepler dans sa chambre noire, Wotton remarquait : «Exécuter des paysages de cette manière ne laisse pas de place à la liberté.[5]»
Wotton retrouvait les mêmes accents de Platon : le peintre n’est qu’un copieur, il ne pense pas, il n’est pas libre, il reste prisonnier de sa technique comme les esclaves de la Caverne.
Alors pourquoi collectionner des autoportraits? – Parce que vous pouvez peindre tout ce que vous voulez dans une chambre noire, sauf un autoportrait. Il faut que vous vous libériez de la technique de la caméra pour vous peindre vous-même et révéler vos défaillances. Sans ces défaillances, il est impossible à un expert de déterminer ce qui fait la singularité d’un peintre, sa manière, son style, sa touche.
Les Médicis sont les plus grands acheteurs de peintures au monde quand ils constituent la galerie de Florence. Les oeuvres affluent de partout.
Comment distinguer une oeuvre originale d’une copie ou d’un faux?
Comment conjurer les copieurs et les faussaires? Le Musée de Vasari implique les mêmes enjeux que la République de Platon et l’Eglise d’Augustin. Comment faire la vérité? Seulement, la réponse, ce n’est plus l’allégorie. C’est l’autoportrait.
Le peintre ne se confesse pas moins en faisant son autoportrait. Oui, mais il ne se confesse plus à Dieu. Il se confesse aux peintres, en tout cas d’abord aux peintres, ceux qui sont déjà passés par là et éprouvent la même nécessité que lui.
Lévy n’a retenu qu’un autoportrait dans son exposition. Pourtant, vous ne le trouverez pas dans la troisième salle et les suivantes, celles qu’ouvre la révolution vasarienne. L’autoportrait demeure dans la salle augustinienne. C’est l’une des oeuvres les plus stupéfiantes que j’ai jamais vue. C’est un autoportrait de Gérard Garouste. Qu’est-ce qu’il fait là?
Autour de lui, il n’y a que des allégories de Véronique. Eh bien, oui, Garouste s’est représenté en Véronique, à ceci près qu’il n’expose pas la photographie de Dieu, mais le miroir qui reflète son sexe, détaché de son corps, auquel répond le sexe de Véronique, substitué au sien.
Quand il remarquait que l’autoportrait de Vélasquez se substituait aux figures du couple royal dans les Ménines, et que le peintre occupait désormais la place centrale de la peinture, Foucault livrait son autoportrait.
Le philosophe, comme Vélasquez, se substituait au théologien. Il occupait désormais la place centrale dans une histoire de la pensée qui se confondait avec l’atelier du peintre de la pensée.
Lévy livre son autoportrait dans Les Aventures de la vérité. Mais ce qu’il considère, ce sont les attitudes présentes, des postures offensives, les positions stratégiques que l’atelier implique, et la manière dont elles construisent l’actualité, dans un espace qui n’est plus historique. De la Caverne à l’Eglise, de l’Eglise au Musée, vous ne quittez jamais une exposition. C’est toujours le même lieu. S’il change de nature, ce n’est qu’à cause des regards que vous lui portez et des aspects qu’il vous renvoie. Mais le lieu, lui, ne change pas. L’instrument qu’il met en jeu, non plus.
«Garouste sait ce qu’il fait, songe Lévy. Il a été assez catholique pour prendre la mesure de l’énormité de la provocation.» Le peintre n’oublie jamais l’exigence d’avoir à prouver qu’il n’est ni un copieur, ni un faussaire, ni un charlatan. Mais il ne peut le prouver qu’à condition d’entrevoir la distance qui le sépare de la vérité. C’est à ce prix que l’autoportrait reste une allégorie.
Faire la vérité
Poussin se servait d’un théâtre miniature pour mettre en place la scène qu’il comptait peindre. Il modelait des figurines, il les confrontait les unes aux autres, il installait des décors, mais surtout il «faisait» la lumière, comme

un directeur de la photographie. La technique de la caméra ne produisait pas seulement les objectifs qui réalisaient la réfraction d’une image, elle formait les loupes qui, installées sur des lanternes, fabriquaient des projecteurs, avec les volets qui dirigeaient la lumière, et les filtres qui la coloraient, comme dans un studio de cinéma actuel.
La beauté, c’est d’abord le temps qu’il fait. Regardez comme il fait beau aujourd’hui. Le climat renvoie à une régie de la lumière que le peintre pouvait désormais manier en agissant sur les sentiments et sur les raisonnements.
L’allégorie délivre un savoir conditionné par l’intelligence. C’est une scène que l’on observe lorsqu’on contemple une allégorie. Cette scène, il s’agit de l’interpréter et de la comprendre, alors qu’un autoportrait n’expose pas une scène, mais un metteur en scène.
Véronique opérait la réfraction la lumière. Elle saisissait la vérité.
Elle la révélait. Elle en témoignait. Elle ne la faisait pas. Le metteur en scène fait la lumière. Il constitue le temps. Il crée la vérité. Quand Deleuze comparait les trois genres de connaissance que concevait Spinoza, à des degrés d’intensité de lumière, il assimilait le philosophe à un directeur de la photographie. Naissait l’art de penser. Mais date-t-il seulement du XVIIe siècle ? Cet art, en son temps, on le concédait déjà à Platon. Il n’est pas sûr que ça le révoltait tant ça, du moins que ça l’ait toujours autant révolté. Cette manière d’envisager la philosophie traverse son actualité depuis toujours. Sans doute prend-elle une position dominante avec l’émergence des Lumières, mais cette position n’a pas un âge plus récent ni plus ancien que l’âge augustinien ou l’âge platonicien.
Pourquoi ne pas créer la vérité comme Poussin créait la lumière?
Pourquoi ne pas la photographier comme Véronique? Pourquoi ne pas y accéder en se révoltant comme Socrate contre les images? Ces questions, si elles créent le temps, ne créent pas moins l’espace stratégique où Lévy observe que la philosophie et l’art ne cessent de mener des offensives l’une contre l’autre pour absorber leur domaine propre.
Il suffirait de se débarrasser de l’actualité pour établir la vérité dans la République qui, parce qu’elle est virtuelle, constitue purement et simplement l’universel. Position contemporaine, pour Lévy. Position sur un terrain où ne s’affrontent pas seulement l’art et la philosophie, mais réellement les peuples.
Et si l’on ne peut pas se débarrasser de l’actuel, pourquoi ne pas le faire fusionner avec le virtuel ? Autre position stratégique, toujours aussi contemporaine. C’est la position des artistes de la pensée, Hegel, Marx ou Bergson, chacun à sa manière, où s’abolit la distance entre l’être et le désir.
À tout prendre, Lévy préfère la position augustinienne. La performance qui consiste à faire coïncider l’être et le désir reste hors de portée des hommes. S’il est un artiste de la pensée capable d’accomplir une telle performance, ça ne peut être que Dieu. Tenter de se substituer à lui, c’est reconnaître sa défaillance. Les hommes ne créent pas la vérité. Ils ne peuvent que l’admettre.
La chambre claire
Les figures qui émanent des songes d’un peintre ne demeurent pas virtuelles. Leur présence matérielle à la surface des choses leur permet de prendre prise sur l’actualité, d’agir sur les sentiments, de conditionner les comportements, de commander les opinions, bref de détenir le pouvoir.
Pouvoir de l’ignorance, selon Platon ; pouvoir de la publicité, selon Heidegger ; pouvoir du spectacle, selon Debord : toujours la même prison façonnée par une caméra décidément démoniaque.
Comment Dieu pourrait-il se laisser photographier? Comment l’Eglise pourrait-elle prendre la forme de la chambre noire où opérer la réfraction de la vérité? – Oui, mais imaginez une chambre claire.
L’instrument date du début du XIXe siècle. Ingres s’en est beaucoup servi. C’est un prisme optique, une sorte de petit cristal serti sur une tige. Il réalise une réfraction sans nécessiter aucun autre appareillage. Il suffit de fixer la tige sur un carton à dessin et de vous mettre devant une chose. Le prisme projettera l’image virtuelle de la chose sur la page. Vous n’aurez plus qu’à reporter ses traits sur le papier pour la rendre actuelle.
Qu’est-ce que ça change? C’est toujours le même principe qu’une chambre noire. – Sauf qu’elle n’est plus noire. Ça change tout. La réfraction n’exige plus le travail du négatif. L’opération se fait en pleine lumière, d’une manière purement positive. Elle renvoie à une tout autre allégorie que Véronique.
Regardez, l’image bouge sur le papier. Vous la dessinez, mais bientôt vous la filmerez. Véronique exposait un «arrêt sur image». Quelle idée! Les images ne sont pas faites pour être arrêtées. Arrêtée, l’image meurt. Mouvante, l’image vit. Image-mouvement. Image-temps. Ce discours tenu par Bergson, prolongé par Deleuze, s’il ne résume pas à lui seul l’art de penser au XXe siècle, y tient tout de même une place considérable.
La vraie image ne tient pas en place. La vérité ne cesse de devenir autre que ce qu’elle est. L’être? – Du désir figé. Du désir mort. Du désir de mort. Mais si l’image bouge, si l’image va de plus en plus vite, c’est que, précisément, elle abolit la distance que la sépare de la chose, au point de fusion du désir entre actuel et virtuel. Si savoir, c’était mieux voir ; désirer, c’est encore mieux que savoir. L’image coïncide avec la chose. Les images sont les choses. Bougez avec elles.
L’art de penser ne tient pas moins une «station» sur le terrain où se joue l’actualité pour Lévy, pas seulement une position stratégique, une «station». Pourquoi s’arrêter devant l’image? Pourquoi convier des visiteurs à s’arrêter devant des images fixes, alors que l’art de penser n’apprécie que le mouvement du temps et le temps du mouvement?
«Depuis Kant, remarquait Foucault à la fin de sa vie, ce qui pour le philosophe est à penser, c’est le temps, Hegel, Bergson, Heidegger. Avec une disqualification corrélative de l’espace qui apparaît du côté de l’entendement, de l’analytique, du conceptuel, du mort, du figé, de l’inerte. Je me souviens, il y a une dizaine d’années, avoir parlé de ces problèmes d’une politique des espaces, et m’être fait répondre que c’était bien réactionnaire de tant insister sur l’espace, que le temps, le projet, c’était la vie et le progrès.[6] »
Lévy n’oublie pas Foucault. Au musée de la philosophie, Foucault occupe une place aussi considérable que Bergson ou Deleuze. Foucault construisait ce musée, du moins il lui donnait sa forme la plus élégante, la plus «stylée», quand, à la fin de sa vie, il commença à se méfier de l’art de penser. Aux Mots et les Choses, succédait La grande colère des faits.
«L’épreuve décisive pour les philosophies de l’Antiquité, c’était leur capacité à produire des sages ; au Moyen Âge, à rationaliser le dogme ; à l’âge classique, à fonder la science ; à l’époque moderne, c’est leur aptitude à rendre raison des massacres», affirmait alors Foucault[7]. Voilà l’horizon où apparaît Lévy. Nous sommes en 1977. «Vous le savez bien, disait Foucault à Lévy, c’est la désirabilité même de la révolution qui fait aujourd’hui problème.[8] »
Nous quittons le Musée pour passer dans l’actualité. Mais le lieu ne change toujours pas. Nous sommes toujours dans une exposition. Lévy est un philosophe de l’espace – de l’espace comme contre-temps, comme contre-désir, comme contre-fusion. Pour autant, l’espace n’est pas non plus l’être, c’est le contre-être, ce qui nous sépare, la séparation des choses : les tensions, les résistances, les oppositions, les affrontements, les offensives, des contre-offensives qui séparent les choses jusqu’au coeur de la chose.
La création
Peut-on se passer de l’art de penser? À l’âge industriel, la tékhnê n’est plus la technique. Ou, si elle le reste, la tékhnê assure qu’elle est la véritable technique : l’art de créer la vérité.
L’art se constitue comme origine de la vérité. A l’objet manufacturé, produit en série, l’objet d’art oppose l’authenticité de la pièce unique, prototype de la série industrielle, et des contrefaçons et simulations de toutes natures. L’art, ainsi conçu, réclame nécessairement une expertise, selon la méthode mise au point à Florence.
La vérité prend l’aspect d’un objet d’art enfoui ou jeté, en tout cas maltraité, et nécessairement oublié à l’âge industriel, auquel l’expert rend sa valeur originaire, proprement créative.
L’expert n’est pas le créateur de l’objet d’art. Toutefois, il détermine la création de la vérité. Sans lui, impossible de distinguer le vrai du faux.
L’expert saisit la qualité véritable en reconnaissant l’énergie créatrice ou la différence essentielle que l’objet d’art met en jeu, mais dont son créateur peut être inconscient.
L’artiste ne crée que la matière de l’objet d’art. L’expert décide de sa vérité, sans agir sur son support, mais sur ce qui préside à sa constitution.
Comment pourrait-il y parvenir, sans solliciter l’art de penser?
Un penseur produit un concept qui, à son tour, réclamera l’expertise qui décidera si ce concept est un objet d’art, un concept réellement créateur, parce qu’on y aura reconnu la même sorte de qualité de vérité que dans un objet d’art classique. Mais de qui dépend la création de la vérité? – De celui qui la produit? Ou celui qui l’authentifie?
Si on admet que la vérité est reconnaissable à une qualité sensible, alors seul celui qui l’authentifie la crée, même s’il ne la produit pas. Sans cette reconnaissance, le producteur ignore s’il a créé ou non la vérité. Faut-il encore que se dégage l’instance incontestable où en décider. Cette instance, elle découle des consommateurs des concepts, seuls habilités à les vérifier en prenant en compte leurs effets sur soi.
Athènes fut le premier grand centre de consommation de concepts.
Elle requérait déjà les critères où entrent en jeu les différents aspects d’une performance philosophique : sa nouveauté, son ingéniosité, son élégance, son style, ses influences, et, en définitive, sa portée stupéfiante – celle qui active les illuminations, les éblouissements, les flashs véritables.
Qu’est-ce que c’est qu’un expert en concepts, sinon qu’un super consommateur de vérités, une sorte de fashion victim de l’art de penser, comme l’est Phèdre dans le dialogue de Platon qui porte son nom. Cette conception de la vérité, basée sur un ressort énergétique ou extatique, et pratiquement pharmaceutique, ne date pas que du XXe siècle. Elle se situe au début de l’histoire de la philosophie. Elle la traverse de part en part. Mais pourquoi ne déterminerait-elle pas ce que Lévy appelle une «station»?
De la Caverne à l’Eglise, de l’Eglise au Musée, du Musée à l’actualité, l’exposition rappelle que la pensée, au-delà du temps, réclame un lieu. Ce lieu, s’il se voue à l’art et lui rend un culte, ne cesse-il pas d’être celui de la philosophie?
La vérité, pour Platon, ne dépend que du raisonnement. Si elle dépend des sens, alors elle se réduit à une espèce de drogue. Pourtant Platon reconnaissait volontiers que la vérité était nécessairement belle. Mais pourquoi ne pourrait-elle pas être laide?
L’idée que la vérité implique la reconnaissance d’un terrain horrible, où le mal persiste quoi qu’on fasse, c’est une idée proprement juive, pour Lévy. Les Juifs ne pensent pas par concepts, ils pensent par noms. Les concepts renvoient à une unité dynamique et fusionnelle de la pensée. Les noms renvoient à un lexique où les idées se séparent les unes des autres pour constituer les singularités auxquelles seules leurs limites donnent une unité abstraite, parfois accablante, mais pas toujours accablante, en tout cas nécessaire à la vigilance sans quoi la pensée n’est plus la pensée.
Les concepts se reconnaissent une origine commune dont la qualité, sensible ou purement mentale, reste substantielle. Les noms se reconnaissent à leur tranchant, ils découpent et isolent des abstractions dont les substances n’ont rien en commun. Ce que les noms partagent, c’est l’espace grammatical qui crée sa grille d’intelligibilité à la pensée. Ce sont les distances qui assurent son fonctionnement. Sans ces distances, sans cette distanciation, les idées fusionneraient, mais fusionnant elles aboliraient la pensée. Et alors? Est-ce que ce ne serait pas désirable ? Est-ce que ce ne serait pas beau ? Est-ce que ce ne serait pas sublime ? – Abolie, la pensée abolirait la souffrance.
Si penser est un art, c’est-à-dire un moyen, alors penser suppose une fin : un but, un achèvement, un accomplissement, un passage à une chose qui serait mieux que penser. Cette chose demeure un songe, mais pour peu qu’elle trouve un peintre ou un poète pour lui créer une image, cette chose devient adorable.
Cette chose constitue l’idolâtrie à un regard juif, mais pour autant cette chose conserve sa beauté à ce même regard. Pourquoi la détruire? – Un objet d’art ne provoquerait pas un éblouissement s’il ne détenait pas un pouvoir créateur. Seulement, il ne crée pas la vérité. Il crée la beauté.
Voilà la position juive. Entre la vérité et la beauté, s’étend une distance qui ne disparaîtra jamais. La vérité ne sera jamais forcément belle.
La beauté ne sera jamais forcément vraie (au sens propre), la beauté ne sera jamais forcément non-illusoire.
La beauté appartient au champ des songes, des désirs, des plaisirs, elle ne prend prise sur l’actualité que pour l’embellir. Mais, en embellissant la vérité, ne change-t-elle pas la vérité en chimère?
La vérité appartient au champ du réel. Sa prise sur l’actualité reste douloureuse à admettre. Elle s’accorde rarement aux désirs, aux plaisirs et aux songes. La fonction de la vérité n’est pas d’embellir. La fonction de la beauté n’est pas de vérifier.
Penser dans le paysage du Talmud, c’est séparer ces champs comme on sépare des couleurs et des formes. Regardez cette peinture de Rothko. Il y a que des champs colorés qui s’étagent comme pour créer l’espace abstrait où Lévy reconnaît la beauté de la pensée juive.
Beauté grammaticale, en quelque sorte. Untitled (Red, Yellow, Blue, Black and Withe) : «Un tableau pensée. Un tableau messie. Un tableau où la pensée juive apparaît pour ce qu’elle est.»
Un peintre juif agit comme un philosophe de l’espace. Mais quel peintre n’agit pas comme un philosophe de l’espace ? Organiser un espace, c’est le principe même de la peinture. Oui, mais tous ne sont pas aussi abstraits que Rothko, ou Mondrian, ou Piero della Francesca, là où le champ de la beauté rejoint le champ de la pensée pour Lévy, sur la ligne d’horizon où le côté de Guermantes rejoignait le côté de Méséglise pour Proust, hors de portée de soi, pourtant toujours à l’horizon.
Si la vérité n’est pas forcément belle, elle n’est pas non plus forcément laide. Il y a bien un endroit où les deux côtés se rejoignent dans les Aventures de la vérité, comme deux couleurs sur la ligne d’une peinture de Rothko. Seulement elles sont séparées – sinon elles ne seraient pas aussi belles, sinon on n’y verrait rien.
Ce sentiment, Lévy admet que c’est le sentiment de la vérité. La vérité possède bien une qualité sensible. Les champs de la beauté et de la vérité agissent l’un sur l’autre, mais pour agir faut-il encore qu’on ne les confonde pas. Il n’y a aucune raison qui empêche la beauté d’embellir la vérité. Il n’y aucune raison, non plus, qui empêche la vérité de vérifier si la beauté ne la trompe pas. L’horizon où les deux côtés se rejoignent appelle la vigilance. Vigilance du philosophe, vigilance du peintre, vigilance du consommateur de vérités et de beautés.
1. Platon, La République, X, 598c.
2. Aristote. Problematica, XV,10.
3. Augustin d’Hippone, Confessions,
4. Michel Foucault, Dits et Ecrits I, Gallimard, pp. 326-327.
5. Henry Wotton, Reliquiae Wottonianae — cité par David Hockney, Savoirs secrets, Seuil, p. 210.
6. Michel Foucault, Dits et écrits II, Gallimard, p. 193
7. Michel Foucault, La grande colère des faits, Le Nouvel Observateur 9 mai 1977
8. Michel Foucault, Non au sexe roi, entretien avec Bernard-Henri Lévy, Dits et écrits II, 1976-1988, Gallimard,
p.266