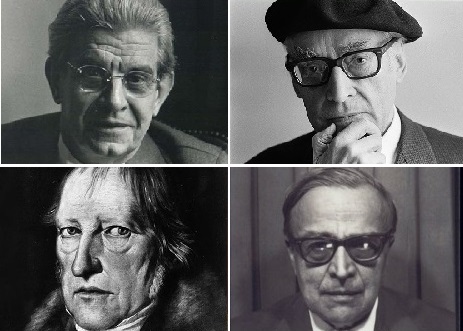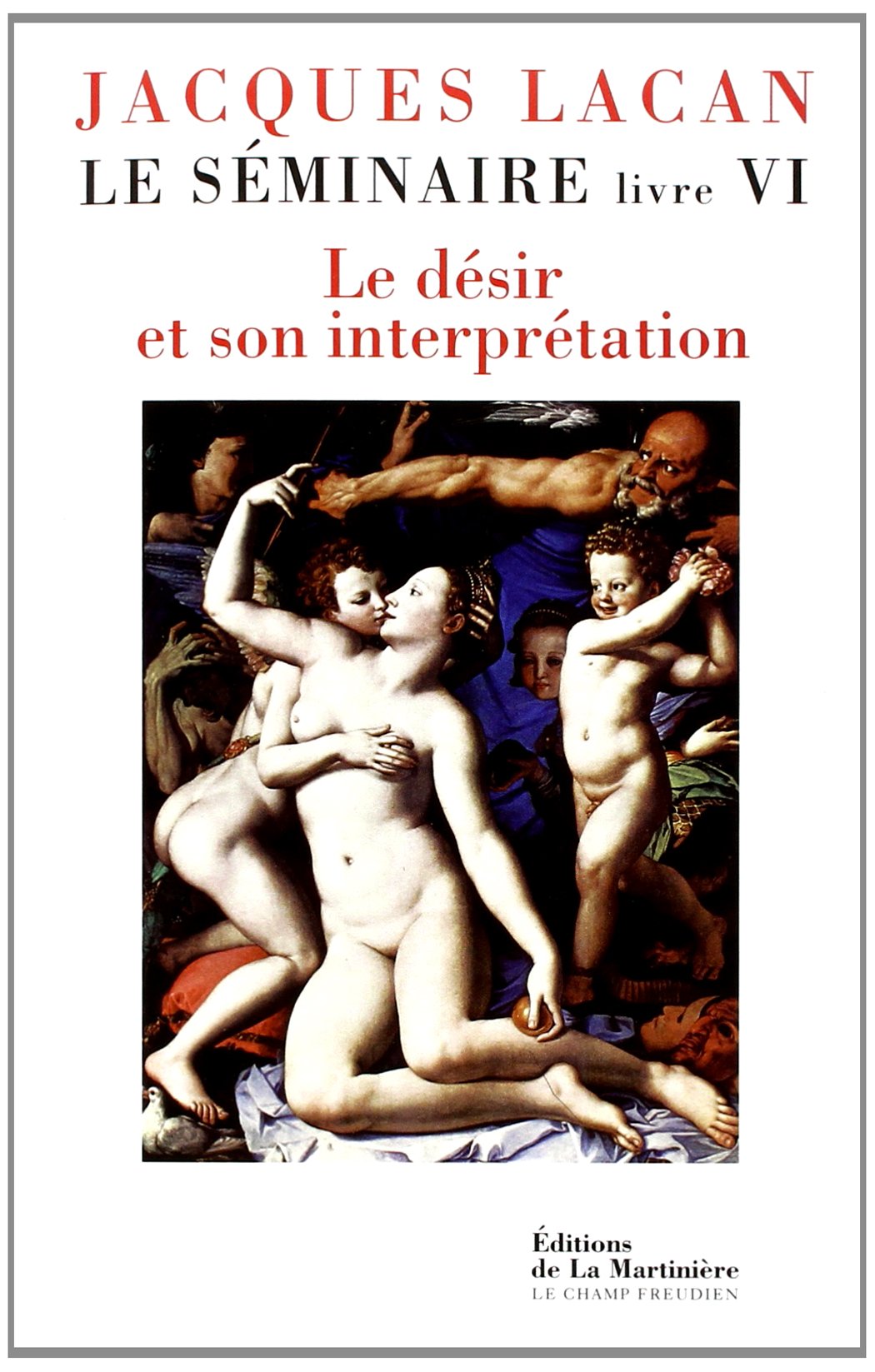Paris, le 10 mars 2013
Je cravache pour peaufiner les notes « et associations » du Séminaire VI. Donc, pas de bla-bla. Je vous donne deux de ces notes, qui étaient achevées avant l’affaire Kadivar. La première injection forcée m’a fait lever la plume.
En donnant la première de ces notes, j’espère encore que quelqu’un m’apportera une solution meilleure ; la mienne n’est qu’un pis-aller. La seconde est la plus longue du livre : elle m’a poussé comme ça, agacé que j’étais par les sempiternelles références approximatives à Queneau, à Hegel, à Kojève, à Lacan. Je me suis aperçu que moi-même je n’avais pas une idée claire et distincte du thème. C’est fait.
Du penem devoret au Dimanche de la vie, je me suis permis un dans le titre de ce blog, daté d’un dimanche où je ne me la coule pas douce, pas du tout.
Femina penem devoret
La sténographie donne [femina curam et penem devoret], leçon évidemment fautive. A faire varier la forme de ces termes, et à les associer de diverses manières, je n’ai trouvé par Google aucune maxime littéraire ou médicale. C’est en vain que j’ai interrogé la patrologie latine, la Psychopathia Sexualis, The Latin sexual Vocabulary (James Noel Adam, Baltimore, 1982), et plusieurs recueils de sentences. Cependant, Google livre une occurrence et une seule des deux mots contigus penem devoret : elle se rencontre dans le passage d’une édition allemande du Kamasutra (II, 9, 19) qui traite du « congrès de la bouche », auparishtaka, sous la forme ultime dite sangara (en latin, devoratio),où la personne partenaire introduit entièrement le membre viril dans sa bouche pour le stimuler jusqu’à éjaculation.
En tout état de cause, l’ancienne tradition médicale voulait le latin quand étaient évoqués le sexuel, le salace, le scabreux. En l’occasion, la formule choisie par Lacan renvoie sans aucun doute à la fellation, qu’il associe fugitivement au to get my penis avant de rejeter cette lecture. Il est possible qu’il ne s’agisse pas ici d’une citation en bonne et due forme, mais d’une allusion approximative.
J’ai préféré donner dans le texte une leçon qui, à défaut d’être complète, est correcte ; elle signifie que la femme avale ou gobe le pénis.
Voir Raymond Queneau
Lacan s’est référé plusieurs fois au roman de Queneau, Le Dimanche de la vie (Gallimard, 1952), y voyant l’illustration de ce qui attend l’homme qui serait parvenu au « savoir absolu » s’il existait, das absolute Wissen, étape terminale du parcours de la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel (1807).
Il ne fait pas de doute que le roman de Queneau est truffé d’indices et d’allusions renvoyant à cet ouvrage, dont la présence est constante dans l’enseignement de Lacan — spécialement sous les espèces de la fameuse dialectique dite du maître et l’esclave dont Kojève a fait la matrice de l’ensemble. Il est bien connu que Lacan et Queneau suivirent le séminaire que Kojève consacra à la Phénoménologie de 1933 à 1936. Queneau en fut l’éditeur, sous le titre Introduction à la lecture de Hegel (Gallimard, 1947). Quant à Lacan, qui n’était pas prodigue de telles reconnaissances, il disait de Kojève « mon maître » (Le Transfert, p. ). Je ne vois à vrai dire que Clérambault qu’il ait ainsi honoré, quand il l’appelle dans les appelant Ecrits « mon seul maître en psychiatrie » (p. ).
Selon Lacan, le roman de Queneau tournerait donc en dérision l’homme du savoir absolu. Il évoque à ce propos « l’avènement du fainéant et du vaurien, montrant dans une paresse absolue le savoir propre à satisfaire l’animal », et aussi « le repos repu d’une sorte de septième jour colossal en ce dimanche de la vie où l’animal humain enfin pourra s’enfoncer le museau dans l’herbe, la grande machine étant désormais réglée au dernier carat de ce néant matérialisé qu’est la conception du savoir. »
Cette interprétation n’est pas originale. Elle procède en ligne droite de Kojève. Pour celui-ci, l’accession au savoir absolu et l’apparition concomitante du « Sage » impliquent la disparition de ce qu’il appelle « l’Homme », la fin de l’histoire, et le retour à l’animalité. A ses yeux, le roman de son élève Queneau décrivait cet état « post-historique » de l’humanité, et il l’a fait savoir dans un article écrit peu après la sortie du roman (« Les Romans de la sagesse », in Critique, LX, 1952). Cet texte a marqué.
Or, cette doctrine du savoir absolu est toute kojèvienne. Hegel n’entendait nullement clore sa Phénoménologie sur cette ubuesque « fin de l’histoire » qui devait inspirer à un chercheur alors néo-conservateur un bestseller, The End of History and the Last Man, The Free Press, 1992, aussitôt traduit en français chez Flammarion. Enthousiasmé par la chute du mur de Berlin et la disparition de l’Union soviétique, Francis Fukuyama avait alors prophétisé « the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government ».
A la fin de la Phénoménologie comme science de la conscience, « se dégage le savoir pur, comme la vérité dernière et absolue de cette conscience », laquelle « se libère de son immédiateté et de sa concrétude », écrit Hegel dans La Science de la logique. Comme le soulignent Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labarrière, dont je suis ici la précieuse analyse, le savoir absolu est plutôt un « niveau d’intelligibilité » où la conscience surmonte son dualisme, ce qui permet à la contingence de trouver sa place dans l’élément du concept (De Kojève à Hegel, Albin Michel, 1996, p. 221, et l’ensemble de la conclusion).
D’autre part, si Le Dimanche de la vie se réfère à la Phénoménologie de l’Esprit, l’expression même figure dans l’Esthétique de Hegel, à la fin du chapitre consacré à la peinture (p. 317 du tome II dans l’édition du Livre de poche, 1997), auquel est emprunté l’exergue du livre : « … c’est le dimanche de la vie, qui nivelle tout et éloigne tout ce qui est mauvais ; des hommes doués d’une aussi bonne humeur ne peuvent être foncièrement mauvais ou vils. »
Ce passage est prélevé sur les éloges solidement étayés que Hegel prodigue aux Hollandais protestants, vainqueurs du « despotisme clérical et monarchique de l’Espagne ». Il s’agit selon lui d’un peuple à la fois héroïque, probe et modeste, qui se dressa « sans crainte en face des monstrueuses prétentions de la domination espagnole sur la moitié du monde ». Par la peinture, cette population « veut jouir une seconde fois de cette existence, aussi forte qu’honnête, satisfaite et joyeuse. » L’expression « le dimanche de la vie » figure également dans l’introduction aux Leçons sur la philosophie de l’histoire : c’est le jour du Seigneur, qui nous permet de « nous consacrer à ce qui est Vrai, et à le porter à la conscience » (cité dans l’édition de la Pléiade des Œuvres complètes de Queneau, tome III, 2006, p. 1678).
La sympathie de Hegel pour l’institution du dimanche de la vie et pour la bourgeoisie hollandaise, industrieuse, courageuse, sans orgueil, ne fait donc aucun doute, non plus que celle de Queneau pour ses personnages, « des petites gens, mais pas des imbéciles », dit-il dans une interview (citée dans la Pléiade, p. 1674). Dans L’œil écoute, Claudel a lui aussi parlé de la peinture hollandaise dans des termes chaleureux, et Roland Barthes y a lu « toute l’histoire amenée à son propre mystère » (in Essais critiques, Seuil, 1964, p. 28).
Ces sentiments positifs contrastent avec le mépris dont Kojève et Lacan accablent les personnages du Dimanche de la vie. Faut-il y voir une réaction aristocratique à l’endroit de ces « petites gens » dont Queneau s’est fait le romancier, et dont il parle avec tendresse ? La chose est plus compliquée, et il faut ici disjoindre les trois compères.
Kojève ne pouvait se sentir avec le peuple rebelle que décrivait Hegel dans l’Esthétique. Il était, si je puis dire, un Impérial. L’admiration qu’il portait au maréchal Staline est bien documentée, et il rêvait pour la France d’un Empire latin. Les ambitions des Habsbourg ne lui paraissaient certainement pas, comme à Hegel, monstrueuses.
Queneau, et non pas Kojève, que je sache, est celui qui a malicieusement opéré une symphyse entre dimanche de la vie de et savoir absolu, entre le chapitre « peinture » de l’Esthétique et le chapitre VIII de la Phénoménologie. Il a par ce biais inscrit le petit peuple de ses romans dans la geste grandiose de son maître sardonique, devenu membre de la haute administration du Marché commun.
Quant à Lacan, la notion de sagesse, promue par Kojève dans Critique comme un état de « parfaite satisfaction (…) accompagnée d’une plénitude de la conscience de soi » ne pouvait que lui répugner. L’absence de division, que ce soit dans le sujet, le savoir, ou la satisfaction, était contraire à ses vues les plus constantes. Le présent Séminaire en témoigne de façon éminente : Hamlet, fils de roi qui fait le fou, est à l’opposé de Valentin Brû, Valentin « consacre ses vastes loisirs, dit plaisamment Kojève, à l’identification du néant de sa certitude-subjective avec le Néantissement de l’Être-en-soi temporel ». Hamlet, l’affairement où le précipite son incertitude se déploie dans la dimension du langage, et le temps avec lequel il est aux prises n’est pas « en-soi », mais « pour-autrui », réglé sur l’heure des autres, dit Lacan. Avec Hamlet, Shakespeare renouvelle le héros tragique, tandis que Queneau a incarné le Sage kojévien dans le soldat Brû.
Hommage au maître ? Ou sa dérision ? La question aurait depuis longtemps été posée si Kojève, qui publiait peu, ne s’était précipité à bénir l’œuvre. Mais ce Sage était déjà une dérision de Hegel par son commentateur.
Lacan a reparlé plus tard du Dimanche à son séminaire. Mais j’ai assez dit.