J’ai de la sympathie pour Arnaud Montebourg.
J’aime son verbe kouchnérien, haut perché, précipité, qui donne toujours le sentiment de courir après son objet perdu.
J’aime sa gouaille, son culot et, quand il décide de nous la jouer (surjouer ?) éloquence de Salut public, cette façon de descendre dans les graves qui le fait ressembler à mon vieil ami (qui fut son mentor) l’avocat Thierry Lévy.
Je me souviens de ce jour où il était venu, seul de son espèce, discrètement, dans un cinéma de quartier où se tenait un rassemblement de soutien au cinéaste iranien Jafar Panahi.
Je me souviens d’un autre jour, veille des primaires socialistes, où il m’avait invité à déjeuner pour, avec son enthousiasme presque communicatif de grand plaideur capable de changer en or le plomb d’une idée fausse, m’exposer ses thèses sur la démondialisation.
Et le fait est qu’il y a, chez lui, une ardeur, une flamme, une sincérité tantôt volcanique et tantôt candide qui changent du cynisme, quand ce n’est pas de la vulgarité, que dégorge, ces temps-ci, toute une part de la classe politique.
Sur l’affaire de Florange, pourtant, il se trompe.
Et, quoi qu’il en dise aujourd’hui, quoi qu’il nous explique, ou tente de nous expliquer, de ses vraies intentions qui étaient de vouloir la nationalisation sans la vouloir tout en la voulant et en voulant surtout tordre le bras d’un Mittal ne comprenant que les rapports de force, il a même commis ce que l’on appelait, jadis, une erreur théorique et politique.
Nationalisation n’est pas un gros mot, évidemment.
Elle se justifie – c’était le grand exemple que donnait toujours Raymond Aron dans ses leçons au Collège de France – quand il s’agit, en 1937 par exemple, de donner à une France tout juste sortie du monde rural un réseau de voies ferrées dont la moitié seront, on le sait d’avance, structurellement déficitaires.
Elle se justifie – c’était le grand argument du CNR et ce sera, après la Libération, encore celui d’Albert Camus – dans la France en ruine de l’après-Vichy qui se retrouve avec des élites, patronales mais pas seulement, déshonorées par leur consentement au pire et mal placées, par conséquent, pour prétendre reconstruire.
Elle se justifie encore quand on décide, comme aux Etats-Unis, dans les premiers mois de la première présidence Obama, d’empêcher la crise systémique (en bon français, apocalyptique) qu’aurait impliquée une deuxième faillite du type Lehman Brothers ou quand on entreprend, en nationalisant General Motors, de faire le travail de redressement (en clair, de restructuration – et, en encore plus clair, de licenciement, de fermeture de sites non compétitifs, de suppression de marques mortes) qu’aucun capitaliste privé n’aurait eu le courage d’engager.
Mais à Florange ?
Ou, comme cela se murmure, sur le site de Rio Tinto, à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie ?
Eh bien, c’est le contraire.
On aurait, non redressé, mais préservé et, aux frais du contribuable, muséifié des hauts-fourneaux obsolètes dont une gauche type Obama se serait précisément employée à recycler ailleurs, autrement, le potentiel et la culture.
On aurait, comme dans la fable de Malaparte sur les cadavres de soldats ligotés à des vivants, pris le risque de voir le mort saisir le vif et toute notre sidérurgie (production, transformation ; filière froide, filière chaude) se laisser gangrener par des dispositifs industriels fantômes maintenus artificiellement.
On aurait créé un précédent, pour ne pas dire une jurisprudence, entendus comme tels par tous les Petroplus, PSA Aulnay et autres chantiers navals de Saint-Nazaire qui sont dans une situation analogue et n’auraient pas compris pourquoi ce qui valait pour Florange ne vaudrait soudain plus pour eux.
On aurait, par parenthèse, adressé un bien mauvais message à ces fameux marchés financiers dont on peut penser ce que l’on veut mais qui ont, que cela plaise ou non, le pouvoir de coter la dette française, donc de décider à quel taux la France empruntera le prix de son redressement et d’aider, donc, ou de freiner, le cours de sa convalescence.
Et puis il y avait dans tout cela, enfin, des accents de haine anti-patrons et, plus précisément, anti-patrons mondialisés qui n’est pas le son le plus subtil à faire entendre aux investisseurs étrangers dont la France a bien besoin pour compenser le manque à gagner généré par le départ de ceux de ses investisseurs tricolores qu’effraie la politique fiscale de M. Hollande.
Que la mondialisation ne soit pas la panacée, j’en suis le premier persuadé.
Que la situation qu’elle crée appelle des régulations nouvelles, je l’ai dit ; je le redirai ; et, de le dire précisément, de le traduire en mesures concrètes proposées à l’Europe et au monde, serait, pour une France se voulant exemplaire, une tâche autrement plus exaltante, et utile, que la remise au goût du jour des vieilles lunes de cette gauche guesdiste, bêtement étatiste, sourdement souverainiste, qui est une de nos plaies nationales et fut le grand péché du mitterrandisme première manière.
Démondialiser, en revanche, jouer de ces réflexes et de ces méthodes souverainistes, s’affranchir de la réalité comme d’autres, autrefois, quand il s’avisait de mal voter, rêvaient de dissoudre le peuple, c’est la pire des solutions : celle où, pensant faire l’ange, on fait la bête – et où, croyant sauver 630 emplois, on en détruit, à terme, davantage et on crée les conditions d’une durable régression.




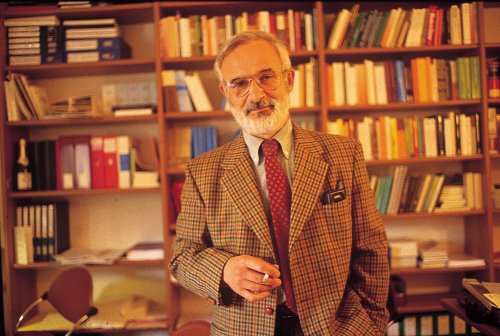



[…] Ce qui ne va pas avec Montebourg […]
La mondialisation est un cheval de Troie. Les plus paranoïaques y voient farcir le dernier entrisme à la mode. Ils oublient que les constructeurs d’un tel monument attendent bien au chaud chacun des petits stratèges qui en découvriront la trappe nécessairement après eux. Un Ulysse n’oublie pas son texte. Tremblant sans peur, lui et ses frères d’armes ne doivent pas perdre de vue l’assaut auquel ils se laissent transporter, le système du monde sur l’estomac duquel ils restent, ceux pour lesquels roule leur ruse. Le libre échangisme à l’échelle internationale, c’est fait pour permettre aux droits de l’homme de descendre entre les hautes murailles où un esprit captif d’une triade démoniaque a justifié son rapt faussement philhélène par la désertion impromptue d’un époux moliéresque débilement confiant qui laissa derrière lui son hôte avec sa belle. Il ne faut pas s’estimer dépossédé de ce qu’on abandonne à qui voudra le prendre.
Le libéralisme est mis en demeure d’appliquer ses propres valeurs jusqu’au bout du monde, autrement dit, chez lui. Le mérite individuel, il le presse comme un klaxon en roulant dans la rigole d’évacuation longeant la file d’attente du RSA, croyant ainsi se dédouaner de tous ses engagements. Mais comment appelle-t-on dix, vingt, trente années à se casser le dos, à se brûler les bronches, messieurs les méritants? Les ouvriers sont allés au casse-pipe pour sauver la nation du froid, de la famine, de la guerre, de la barbarie. Vaillamment, ils ont livré bataille, combattu les matériaux toxiques, certains sont morts au champ d’honneur. Leur mérite individuel se prend en gueuse considération. Il vaut bien lui aussi son pesant d’air. Un argenté si vous n’avez plus de paille d’or en stock. En tout cas, un plié dans les règles, avec poignée d’ouverture métallique due au sidérurgiste des pays émergeants puisqu’il n’y a plus d’autre moyen pour l’empereur mondialiste de se maintenir au niveau de cette ahurissante gigantomachie qu’est devenue l’économie mondiale. Le plus important, maintenant qu’on a sauté, va être de conserver sa flexibilité tout le long de la chute. Évidemment, il suffit à Édouard Martin d’ouvrir Le ventre de Paris pour qu’il se remémore les journées de treize heures de 1873 où la vendeuse des grands magasins se faisait traiter par son adjudant chef de rayon comme un shit bag de Full Metal Jacket. Mais les pas en avant masquent éhontément ceux qui honteusement rentrent dedans à reculons.
Une femme d’une cinquantaine d’années, natte blonde en accordéon, lissée à la manière d’une parfumeuse aux Galeries Lafayette, elle est assise sur une énorme valise rembourrée, une seconde valise à la verticale fait la tête de lit, on se croirait au bord du parking d’un aéroport en train d’attendre ensemble ceux qui selon toute vraisemblance ont dû au même moment oublier leur portable et s’en rendre compte l’un dans le cul de l’autre au milieu d’un périph embouteillé. Les amis. La famille. Mais la famille n’arrive pas. Et ce n’est pas un aéroport, mais le boulevard Haussmann, et cette femme moderne au profil stoïque, aux formes soulignées par la veste d’un tailleur cintré, a posé une pancarte devant ses pieds de petite dame foutue à la porte de la société. Elle est là. Et une semaine après, elle y est toujours. Légèrement plus grise. Sensiblement plus raide. Imperceptiblement plus morte.
Je ne suis pas Bette Midler, et la dame du boulevard Haussmann n’a pas la politesse d’être sortie d’une caravane de Touchstone Films. Sa clochardise n’est pas démaquillable, pas davantage que le crime qui nous atteint, elle qui se montre à moi, moi qui me sens montré du doigt par celle que je n’ose regarder de haut. Jadis, un chef de famille lui aurait assuré le toit et le couvert en échange d’un devoir conjugal. Mais le patriarcat n’est plus, au grand dam des dames que leurs abîmes abîment. Celui qui a vu dans la phrase précédente un éloge du patriarcat est sommé de tout reprendre depuis le début.
Florange est-t-il compétitif ou suit-il le déclin progressif de l’ère industrielle? Il doit être ceci d’un certain point de vue et faire cela d’un autre. Arcelor-Mittal se résume-t-il à Lakshmi Mittal? À cela, je réponds en Normand. Mais sans verser dans la démagogie du trotskiste qui s’est fait un bobo sur la bio, je dis que sans Mittal, plus d’Arcelor et là encore, sous l’arsenal, il y a des bras d’ouvriers comme des ventres de femmes dont je ne m’interdis pas de me rappeler que ce sont leurs articulations désacralisées qui, malades malgré elles, ont accouché du sacre de Lakshmi. Les Che tartinables en dulce, j’en ai soupé. Lorsque l’on prône le socialisme nord-coréen, on se prend un aller simple, on s’encarte, on se déshumanise comme il faut. L’État de droit comprend les libertés individuelles, celles-ci se posent indubitablement sur le principe d’égalité, celui-là conserve son politique et son naturel sans verser dans la dyslexie. Ceci posé, Arcelor justifie-t-il que l’homme et la femme indispensables au bon fonctionnement de la machine à civiliser soient, à ce stade avancé de leur évolution, répliqués par un homme jetable et une femme jetable?
La nationalisation de Florange en tant qu’arme nucléaire a relativement fonctionné. Montebourg ne savait pas que la France n’avait jamais eu l’intention de se racheter. Un avocat, c’est fait comme un acteur. Ça n’a pas l’esprit de synthèse. Ça comprend mieux que personne les personnages qu’il laisse entrer dans sa personne. Ça souffre juste. Ça éclate de rire juste. Ça se met l’État dans tout ses états. Un metteur en scène ne boude pas les Strad. Le nôtre en possède quelques uns dans son orchestre de double chambre. Qui se mettent à vibrer tout seuls quand gronde la jacquerie. On écoute le prophète si on ne peut pas le voir, savoir voir ce qu’il voit. Il fixe l’idéal. Il fixe l’horizon. Il fixe le hors d’atteinte. Non, l’arme de dissuasion socialiste se limitait à rappeler à Lakshmi le Grand que son néo-empire économique n’avait pas le pouvoir de soumettre un État-nation. La France dominera donc le néo-empereur d’Arcelor, un souverain transnational sommé de respecter les lois des pays où il vient investir comme n’importe quel citoyen étranger n’arrive pas comme un Hun vandalisant les territoires lointains sans distinguer les frontières qu’il écrase ni les langues qu’il arrache.
Nous avons le cheval et nous sommes définitivement au cœur du Village fortifié. La mondialisation est une Hélène irrésistible à ceux qui n’ont pas encore pris conscience de ce qu’elle n’éclaire plus rien si au lieu de se lever au-dessus de tous elle se couche sous un seul, rien alors qu’incarnant ce qu’il y a de commun à Troie et aux Achéens, elle fait décimer l’une au prix du sacrifice des autres.
Nous ne cessons pas de parler régulation. Pour les flux migratoires. Pour les flux financiers. Comment réguler le capitalisme? La tâche semble irréalisable. Et pourtant. Tout revient toujours à la même chose. Être capable de voir les personnes qui sont autour de soi. Cessons immédiatement de chercher à tout réguler par les mêmes méthodes qui dérégulent tout. Il faut humaniser le capitalisme. Il faut humaniser l’immigration. Connaître les hommes, leurs racines, leur canopée. L’étage le plus haut de la jungle économique dépérirait si on lui sciait la base du tronc. L’ouvrier d’Arcelor-Mittal est allé à l’école. Il est capable de comprendre que le monde est en train de changer. Que rien ne sera jamais plus comme avant après que les robots auront délivré les humains de leurs travaux d’esclaves. Ce que l’ouvrier devenu inutile ne peut pas encaisser, en revanche, c’est que le patron inauthentique de la multinationale inauthentique digérant son usine inauthentique ne connaisse pas son prénom. Nous ne retournerons pas aux stades d’évolution anciens, mais la capacité à se voir soi-même dans l’autre demeurera un identifiant indépassable de l’espèce humaine. Que l’empereur n’oublie pas qu’il fut un jour un homme! Au moment où un homme tombe, il n’a pas envie de croiser le regard de celui que sa chute fait rire. Le grand roi savait communiquer avec ses sujets. Quel est ce monde où un seul homme peut vous mettre à la rue en gardant le sourire? Non. Non, non et non. Pas question d’accepter cela. Nous n’avons pas amélioré nos cœurs pour nous retrouver aujourd’hui dans les étaux d’une métacivilisation émettant un cluster continu pour seule polyphonie. Le chant de l’égalité ne tolère pas qu’on le massacre. Arrêtons le massacre! Reprenons depuis le début, pupitre par pupitre. Dédoublons le tempo, imprégnons-nous d’une partition ne souffrant pas qu’un petit prétentieux la corrige. Respectons la symphonie mondiale. N’en faisons pas un pot-pourri populiste. Prenons l’orchestre au sérieux, et ah! Ça ira de soi.
DE RETOUR PARMI NOUS … BernHARD!!