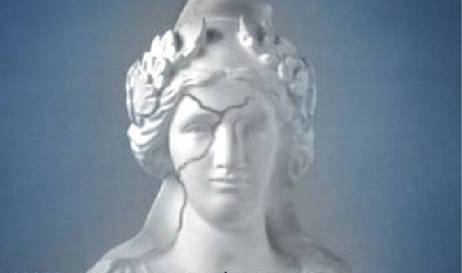Jean-François Copé ne voit pas pourquoi il « s’excuserait de dire une réalité ». Nous avons été abreuvés, ces cinq dernières années, de ce genre de fausses évidences, et M. Copé est, par cette phrase au moins (sans parler de la tactique politique qu’elle sous-tend), le digne héritier de Nicolas Sarkozy. Mais, si personne ne doit s’interdire de parler de la, ou d’une, réalité, il convient de réfléchir à la réalité qu’on invoque et d’en définir précisément les termes. Et cela, de préférence avant d’en parler. Il en va ainsi, tout particulièrement, de ce que certains appellent, sans trop de précaution, le « racisme anti-blancs ». Il faut d’abord avoir conscience que ce type de concept choc, qui prétendent courageusement « briser un tabou » (lequel ?), dévoient le débat public, et ce qu’en reçoit la société française, bien au-delà de la question des idées empruntées au FN. Et il faut se garder de réduire la condamnation à cela. La préférence nationale, et donc la dénonciation de tout ce qui, toujours très fantasmé, la menace, n’est pas une surprise dans le discours des responsables du parti d’extrême droite. C’est un passage obligé. Il en va autrement, bien sûr, lorsqu’un ténor de la droite dite républicaine s’en empare, sans prendre la peine, pour autant, de poser le problème différemment, mais en instrumentalisant au contraire, avec un cynisme déconcertant, un prétendu concept, au risque de lui donner toute légitimité, et cela pour sembler reprendre la main sur une élection interne qui lui échappe inéluctablement. Malheureusement, l’UMP nous a habitués à ces débordements depuis maintenant plusieurs années, et les modérés en son sein sont de plus en plus inaudibles. La défaite n’a rien arrangé.
Le « racisme anti-blancs » est un paralyseur de la pensée, et c’est cela qui le rend véritablement dangereux. Poser en ces termes les problèmes identitaires, bien réels, auxquels est confrontée la société française aujourd’hui est le moyen le plus sûr de ne jamais les comprendre en profondeur. En un sens, il procède d’un renversement sophistiqué assez génial, qui n’est au fond que le dernier, et peut-être le plus osé, avatar d’une inversion constante des paradigmes dans le discours de certains hétérosexuels blancs qui s’aperçoivent avec effroi qu’ils ne détiennent plus tous les ressorts de domination dans la société. Plus exactement, qui s’aperçoivent que leur domination jusque-là admise de droit quasi divin est désormais remise en cause par des minorités que l’on pensait définitivement reléguées à la marge, leur juste place. De cette lente révolution en marche naissent des tensions profondes, sans doute inévitables, que le surgissement intempestif de fausses vérités telles le « racisme anti-blancs » n’aident en rien à résoudre, mais entretiennent au contraire, dans un effort désespéré pour assurer sa légitimité à représenter, de toute éternité, ce que doit être un « véritable français », l’âme même du pays.
Donc, pour contourner la discrimination réelle qui mine la société française, aussi bien dans les actes que dans les esprits, contre laquelle rien de vraiment convaincant n’a été engagé ces dix dernières années, on parle de « racisme anti-blancs », comme si être blanc en France rendait plus difficile l’accès à l’emploi, au logement et à une éducation de qualité. Le sophisme est une insulte à l’intelligence et à l’éthique politique. Dans le même mouvement, diaboliquement efficace, on évite de se poser la seule question qui vaille en la matière : pourquoi de jeunes français aujourd’hui ne se reconnaissent pas partie prenante de notre destinée commune ? Serait-ce parce que, avec le poison des contrôles d’identité « au faciès », eux bien réels, on ne cesse de leur demander, chaque jour, de prouver leur appartenance à leur pays ? Serait-ce parce que, relégués depuis toujours dans des quartiers ghettoïsés qu’on ne peut que rêver de quitter au plus vite, là où le chômage atteint des records à chaque mesure plus inquiétants, là où l’on envoie les enseignants les plus inexpérimentés, là où la pauvreté de tous sautent aux yeux, on les contraint de facto à se replier sur eux-mêmes ? Serait-ce parce que ceux qui détiennent, contrairement à eux, les arcanes de la parole et de l’audience publiques se complaisent à décrire leur religion, plus ou moins explicitement, comme un danger, comme un corps étranger qui n’a pas sa place en France ? Serait-ce parce que, enfin, pris au piège d’un rejet si constant et si profond qu’il a fini par devenir une part d’eux-mêmes, ils n’ont trouvé d’autre remède à leur humiliation que de retourner la tache à l’envoyeur ? L’argument est connu ; il est régulièrement taxé de « bien pensance », arme suprême des négateurs du réel, comme si bien penser était devenu une tare et une insulte. Alors préférons la « bien pensance » aux arguments simplistes.
Car la réalité que devrait plutôt considérer M. Copé est bien celle-ci : un certain nombre, difficile à évaluer, de jeunes Arabes et de jeunes Noirs en France assimilent tragiquement être français et être blanc. Sans penser à mal le plus souvent, lorsqu’ils disent « un Français », ils entendent « un Blanc ». C’est un réflexe inconscient qu’il ne leur viendrait même pas à l’esprit de questionner. Voilà ce que nous avons appris à nos enfants dont les parents viennent d’ailleurs. Voilà le vrai tabou qu’il est grand temps de briser. L’unité indivisible de la République française n’est plus aujourd’hui qu’un paravent miteux que l’on brandit pour tenter de cacher les aspects les plus sombres de notre société, pour cacher ce racisme ordinaire que l’on ne saurait voir. Il est un peu facile de le retourner contre ceux qui en sont victimes et de dire : Voyez, ils ne veulent pas être français. La vraie question est plutôt : voulez-vous, voulons-nous qu’ils le soient ? Nombreuses sont les raisons d’en douter.
*
On nous ressasse les oreilles, depuis des années, du devoir d’intégration que sont censés accomplir nos jeunes issus des minorités dites « visibles ». Commençons par considérer que, dès lors qu’ils ont la nationalité française, ils sont, par définition, intégrés à notre société. Rappelons-nous que le mot « intégration » vient du latin integer, qui signifie « intact, non touché » et cessons de fantasmer la pureté d’une identité nationale passée qui n’a jamais existé et qui n’a d’autre objet que d’en exclure tous ceux qui ne répondent pas, par malchance, à ses critères arbitraires. Souvenons-nous que la France est une ancienne puissance coloniale qui n’a jamais eu le courage de régler définitivement ses comptes avec cette part sombre de son histoire, et songeons que nous ne pouvons décemment demander à de jeunes gens déjà déchirés entre l’origine de leurs parents, souvent venus de pays anciennement colonisés, et leur appartenance à notre société, de les régler pour nous. Là encore, danger de « bien pensance » et de repentance pathologique, comme si reconnaître sereinement nos erreurs et nos crimes passés nous menait immanquablement à la haine de nous-mêmes. C’est l’inverse qui est plus probablement vrai. Les squelettes dans le placard sont une voie bien plus sûre vers la psychose et la perte d’identité.
Au lieu de cette reconnaissance, on assiste à l’émergence de raisonnements boiteux qui sont autant de tentatives de renversement de la réalité. Issus de commentateurs qui ne sont autorisés que d’eux-mêmes, qu’on a appelés récemment les « nouveaux réactionnaires » (parmi eux, Élisabeth Lévy, Richard Millet, Denis Tillinac ou Renaud Camus), ils infusent depuis plusieurs années le discours politique d’une certaine droite qui se revendique jusqu’à nouvel ordre modérée, ou « non extrême ». Des raisonnements qui, parce qu’ils dépassent la seule question des « minorités visibles », leur point d’ancrage, est le signe d’une posture défensive identitaire profonde et complexe, qu’il conviendrait d’interroger en détail. Il y a entre ces « nouveaux réactionnaires » des différences aussi bien sur le fond que sur la forme, mais un point commun les réunit : ils se placent tous dans une position de victimes, comme s’ils étaient passés soudainement, et par on ne sait quel phénomène étrange, d’un état majoritaire à celui de minorité opprimée. Ils décrivent alors, parfois en creux, parfois très explicitement, une France menacée par un double danger, à la fois extérieur (l’immigration massive) et intérieur (les minorités de tous ordres). Denis Tillinac, par exemple, ne craint pas d’affirmer que la France n’a jamais été une puissance coloniale, mais qu’elle est aujourd’hui en bonne voie d’être colonisée elle-même. Richard Millet, lui, se dit vivre dans une situation « d’apartheid volontaire ». L’habile oxymore ne doit pas nous tromper : ce qui tourmente Richard Millet, et le pousse à s’exclure lui-même, est le fait de se retrouver le seul Blanc dans le RER. Richard Millet tend donc à suggérer que notre capitale et sa banlieue, ce n’est pas rien, sont aujourd’hui, au choix, désertées par les Blancs ou envahies par les Noirs et les Arabes. Cette question des transports parisiens est en elle-même un cas d’école et l’on pourrait sur une carte de métro dessiner celle des fractures qui minent la société française. Ou les traverser en restant dans la même rame. Prenez la ligne 4 : vous serez probablement l’un des seuls Noirs si vous montez à Saint-Germain des prés, et l’un des seuls Blancs si vous montez à Barbès ou Château-Rouge. On se demande pourquoi, et quel est le vrai problème, ici… Prenez le RER D vers le Nord : très tôt le matin, oui, votre wagon accueillera surtout des travailleurs immigrés, très probablement ouvriers ou hommes et femmes de ménage ; les rares Blancs seront des enseignants. Où allez-vous ? en Seine-Saint-Denis. Un peu plus tard, à l’heure où ouvrent les bureaux, beaucoup plus de Blancs. Où s’arrêtent-ils ? à la Plaine-Saint-Denis. Richard Millet, avant de tenir des discours d’assiégé, devrait se pencher d’un peu plus près sur la géographie des inégalités sociales, qui, en l’espèce, recouvrent exactement, et c’est le seul scandale à dénoncer, celle des différences d’origine.
Élisabeth Lévy, elle, est souvent un peu plus subtile et verse un peu moins dans la provocation pure. Néanmoins, elle semble cultiver ce qu’il convient d’appeler le « complexe du dissident » ; elle se rêve en dissidence dans un pays en proie au totalitarisme des minorités. « Moi je trouve que les minorités, dit-elle, sont devenues des minorités qui nous persécutent parfois parce qu’elle se servent de l’oppression passée pour justifier leur pouvoir présent. »[1] Dans ces minorités, tout y passe : les minorités ethniques, cela va sans dire, mais aussi les homosexuels, qui sont pour Élisabeth Lévy une véritable force d’oppression dont elle est la première victime. Élisabeth Lévy sait-elle que le grand mathématicien britannique Alan Turing, à qui l’on doit l’émergence de la programmation informatique, s’est suicidé en 1954, à l’âge de 42 ans, après avoir « choisi » la castration chimique, qu’on n’ose pas imposer même au pédophile le plus récidiviste, parce que, poursuivi par la justice pour son homosexualité, il ne voulait pas subir le même sort qu’Oscar Wilde ? Voilà pour l’oppression passée, qui ne remonte pas non plus au Moyen-Âge. Élisabeth Lévy connaît-elle un seul fait divers récent où des homosexuels auraient lynché un hétérosexuel pour le punir de son orientation sexuelle ? Voilà pour le pouvoir présent.
Au-delà de leur (apparente) absurdité, au-delà de leur redoutable pouvoir simplificateur, ces discours sont les révélateurs d’un renversement profond, qui dépasse, il faut s’en persuader, les provocations de nos « nouveaux réactionnaires ». Il est, ce renversement, la réaction épidermique à un changement que tout vrai démocrate, que tout vrai défenseur de la justice, devrait considérer salutaire. L’homme, et dans une moindre mesure, la femme, hétérosexuels blancs ne détiennent plus, en France, le pouvoir absolu. Ou, plus modestement, la contestation de ce pouvoir absolu, ce qu’Elisabeth Lévy appelle la persécution par les minorités, est aujourd’hui globalement regardée comme légitime. Là est le nœud gordien de la crise identitaire de ceux qui croient entrer en résistance et qui vont dénonçant la moindre différence comme une insupportable aliénation. Ils découvrent ahuris qu’ils n’ont plus tout à fait le monopole du bien-fondé à exister, à s’exprimer, à s’imposer. Incapables d’accepter cette remise en cause qui les relativise, ils se posent en victimes, manière, peut-être un peu désespérée, car la ficelle est grosse, mais finalement assez efficace, de reprendre la main.
Pour finir, l’injonction d’intégration, quand elle se dévoile vraiment pour ce qu’elle est, n’est pas la demande, elle parfaitement légitime et indispensable, de respecter les valeurs de la République, mais l’exigence totalitaire : Sois comme moi, deviens ce que je suis. Revenons encore un instant sur les propos de Richard Millet : « Quelqu’un qui, à la troisième génération, continue de s’appeler Mohammed Quelque chose, pour moi, ne peut pas être français. On ne peut pas s’intégrer, encore moins s’assimiler, si on continue de s’appeler Mohammed. » Bien sûr, Richard Millet est connu pour sa recherche pathologique du scandale. Néanmoins, posons-nous la question : combien de Français qui, disons, ne s’appellent pas Mohammed mais François ou Martin, quand ils entendent « Mohammed » voient un Maghrébin avant, et sans doute à la place d’un autre Français ? Par ailleurs, remplaçons Mohammed par Jacob, et voyons ce qui se passe. Enfin, si l’on considère que la laïcité est une des valeurs fondatrices de la République française, en quoi le prénom Mohammed remet-il davantage en question la légitimité d’appartenance de son porteur que Rachel ou Mathieu ?
Si l’on veut bien admettre que le mouvement d’intégration est indispensable à la constitution d’une société harmonieuse, alors il doit traverser toutes ses parties sans discrimination. Autrement dit, c’est aussi au Français dit « de souche » pour éviter de dire « blanc », d’intégrer les aspects changeants, différents de lui, de l’espace social dans lequel il vit. Car ils en sont aujourd’hui une composante irréductible. Les « nouveaux réactionnaires », Jean-François Copé et ses séides dans leur sillage, voudraient nous faire croire à demi-mot qu’accepter que Mohammed soit un Français à part entière, sans réticence ni réserve d’aucune sorte, équivaudrait à faire de la France un état islamiste. Sachons raison garder, voyons que de tels fantasmes ne font qu’aggraver la situation et qu’au repli sur soi répondra toujours le repli sur soi. Continuons de dénoncer le fanatisme où qu’il émerge, mais faisons-le ensemble. Peut-être verrons-nous enfin que ce qui nous unit sera toujours plus fort que ce qui nous sépare : le fondement même de la dynamique démocratique, le seul mouvement d’intégration qui doit nous occuper, car à travers lui les différences, sans disparaître, coexistent, s’entremêlent et s’enrichissent mutuellement.
[1] Tous les propos ici rapportés sont tirés de différentes émissions Répliques, d’Alain Finkielkraut (lui-même grand pourfendeur du « racisme anti-blancs »), sur France Culture.