Avec Jacob’s Room, son troisième roman publié en 1922, Virginia Woolf a basculé. Plus exactement, elle est advenue. Il est bouleversant d’assister à ce spectacle, un écrivain qui accède, véritablement et complètement, à lui-même, qui devient sous nos yeux une singularité parfaite. Ce partage des âmes qu’est l’expérience de lecture acquiert une dimension nouvelle, ici encore compliquée par le dire sous-jacent du texte, qui court tout au long de l’œuvre, en constitue la chair paradoxale : l’insaisissable des profondeurs humaines. Woolf se détache de la psychologie romanesque classique, descend, non sans ironie parfois, de l’Olympe des narrateurs divins et divinatoires, travaille, inlassablement, la question de l’être au monde. Et c’est la forme même du récit qui en sort, inévitablement, transfigurée. Première pierre d’une œuvre qui trouve là sa structure, son visage et dont la clef de voûte sera sans doute, dix ans plus tard, The Waves.
Dans sa remise en cause des canons posés par le roman du XIXe siècle, Woolf n’a pas suivi la voie de Proust et James. Celle d’une écriture spirale qui creuse, au rythme d’un phrasé à la fois langoureusement musical et essentiellement littéraire, la démoniaque précision des sensations pour révéler les strates infinies qui les composent. Non, l’expérience scripturale chez Woolf est une expérience de l’éclatement. Le récit dessine une courbe fractale. Objet fascinant, pure création de l’esprit semble-t-il, qui ne se contente plus de reproduire le réel, depuis un extérieur mal situé, mais émerge, de l’intérieur, l’invente, comme on invente un site archéologique, en posant le puzzle de son apparent chaos. Au lecteur, alors, d’y plonger, d’ajouter la pièce de sa propre conscience dans ce flux incessant, et d’aider, par ce geste initiatique, à tendre vers sa résolution, aussi inaccessible fût-elle.
Le flux de conscience(s), magistralement mis en scène dans The Waves, est le cœur de l’œuvre de Woolf. Il a d’ailleurs deux faces, indispensables l’une à l’autre ; flux de la conscience dans le monde, qui le perçoit et cherche à l’entendre ; flux du monde dans la conscience. L’écriture advient au point de rencontre de ces deux flux, parallèles sans doute, mais non euclidiens. La folie aussi, cette crainte terrible qui hanta Woolf toute sa vie, émergeant avec une violence renouvelée après chaque temps de création intense, jusqu’au suicide – acte de résistance ultime, où l’on préfère disparaître volontairement dans les flots, qu’involontairement dans l’absence de conscience.
Si les deux mouvements s’entrechoquent au moment où la conscience n’est pas préparée pour ce séisme, le monde se manifeste sous une forme aberrante où l’on continue, pourtant, de chercher le sens. Septimus, dans Mrs Dalloway, entend les oiseaux chanter pour lui, en grec ancien, et lui laisser entrevoir, dans un éclair de démence pythique, la grandeur et la beauté de cet infini au fond duquel il est en train de sombrer. Woolf a prêté à son personnage une expérience qu’elle a elle-même connue et qu’on imagine à la fois terrifiante et exaltante. Septimus se jettera d’une fenêtre. Tragique préscience du moi de l’écrivain qui trace sa mort à venir ; collision des temps et des dimensions du réel.
Septimus est un voyant.
« Septimus regardait. (…) Et la voiture restait là, les stores tirés, et dessus une curieuse figure, comme un arbre, pensa Septimus, et cette convergence progressive de toutes choses vers un unique centre, sous ses yeux, comme si quelque épouvante affleurait, prête à jaillir au milieu des flammes. »
Septimus est un voyant submergé, emporté bientôt par le flux de conscience qui sans répit s’abat sur son malheureux esprit coupable, un voyant ébranlé par le choc tectonique d’un monde qui offre au regard interdit son impossible révélation.
« Une merveilleuse découverte, en effet – que la voix humaine puisse, dans certaines conditions atmosphériques (car il faut être scientifique, par-dessus tout scientifique) faire couler la vie dans les arbres ! Heureusement Rezia fit peser sa main d’un poids énorme sur le genou de son mari pour le maintenir immobilisé, fixé, sans quoi l’agitation des ormes qui montaient et retombaient, montaient et retombaient, toutes feuilles en feu, et leur couleur tour à tour plus ténue, ou plus dense, passant du bleu au vert d’un creux de vague, comme des plumets sur la tête des chevaux, comme des plumes sur celle des dames, à monter, si fiers, à retomber, si superbes, l’aurait rendu fou. Mais il ne voulait pas devenir fou. Il fermerait les yeux, il ne verrait plus.
Mais ils faisaient signe ; les feuilles étaient vivantes ; les arbres étaient vivants. Et les feuilles, parce qu’elles étaient reliées par des millions de fibres à son propre corps, là sur le banc, l’éventaient ; lorsque la branche s’étirait, il faisait de même. Les moineaux qui voletaient, montant et retombant en jets dentelés, faisaient partie de la figure ; le blanc et le bleu, barrés de branches noires. Des sons formaient des harmonies préméditées ; les intervalles avaient autant de sens que les sons eux-mêmes. Un enfant cria. Au même moment une trompe sonna au loin. Tout cela, pris ensemble, annonçait la naissance d’une nouvelle religion. »
Septimus est un prophète – condamné car sans voix. Or seule l’écriture, seule la composition du récit – et celle de Mrs Dalloway est d’une précision redoutable – peut fixer et rendre intelligibles ces flux d’harmoniques. Septimus, lui, est muet, il laisse sa femme interrompre le flux, dire pour lui l’apparence triviale des choses qu’il ne voit plus. Il est au-delà. Il ne parle pas ; il écrit, certes, mais des fragments disparates qui échouent à transmettre la cohérence écrasante de ses révélations.
« Les hommes ne doivent pas abattre les arbres. Il y a un Dieu. (Il notait de telles révélations sur le dos d’enveloppes.) Changer le monde. Personne ne tue par haine. Le faire savoir (il nota). »
Septimus est le double déformé de l’écrivain, son inquiétant fantasme ; celui qui, incapable de représenter, conscience détrônée par la folie, ne réussit plus qu’à tracer les traits épars d’une figure, invisible et échappée, qu’aucun autre ne pourra jamais voir. L’exclusion est totale. Septimus, écrivain échoué, est désormais à l’extérieur de l’humanité. Et pourtant, c’est là sa victoire autant que celle de Woolf qui exorcise provisoirement, en démontrant la maîtrise de sa propre écriture, ses angoisses les plus destructrices, pourtant Septimus occupe une place irréductible dans la structure d’ensemble de Mrs Dalloway. Il en détermine, au même titre que Clarissa, que tous les autres personnages, certains rencontrés très furtivement, la dynamique inexorable ; il est une partie de la fractale. Son échec à être au monde permet au livre d’exister, de devenir cet univers parallèle, une complication signifiante du réel.
Les objets du monde, comme les feuilles au corps de Septimus, sont reliés entre eux par des millions de fibres. Impossible de les montrer toutes. Mais annoncer leur présence suffit.
La nouvelle An Unwritten Novel deviendra Jacob’s Room – cet achèvement qui commence. Elle en est la carte brisée, comme ces coquilles d’œuf que « Minnie Marsh » étale devant la narratrice.
« Et maintenant vous étalez sur vos genoux un mouchoir de poche sur lequel tombent de petits fragments de coquille d’œuf – les fragments d’une carte – un puzzle. J’aimerais pouvoir les rassembler ! Si seulement vous vouliez bien rester tranquille. Elle a bougé les genoux – la carte est en morceaux une nouvelle fois. »
Remarquable passage, bien sûr, de l’intimité relative du « vous » à la distance déconcertante du « elle ». Flux et reflux de la conscience du narrateur/écrivain face à l’autre qu’il désire obstinément étreindre. Mais la proie continue de rayonner ses millions de fibres, terriblement séduisante, sans jamais se figer sous le regard. Ainsi le monde, qui jamais ne lasse l’amour inépuisable de l’écrivain. Les dernières lignes de An Unwritten Novel resplendissent de ce désir éperdu.
« Où que j’aille, des silhouettes mystérieuses, je vous vois tourner au coin, mères et fils ; vous, vous, vous. Je me dépêche, je les accompagne. Ceci, j’imagine, doit être la mer. Gris est le paysage ; tout comme la cendre ; l’eau murmure et se meurt. Si je tombe à genoux, si je suis tout le rituel, les anciennes cabrioles, c’est vous, silhouettes inconnues ; vous que j’adore ; si j’ouvre mes bras, c’est vous que j’étreins, vous que j’attire vers moi – monde adorable ! »
C’est au sens propre, une profession de foi – sensuelle et profane. On lit dans Jacob’s Room une scène en miroir, aux multiples miroirs même, de celle à l’origine de An Unwritten Novel. Cette dernière est un moment d’écriture fondateur, une expérimentation menée dans le laboratoire du langage – juste une expérimentation, comme pour voir ce qui se passerait si…, mais qui n’en est pas moins la matrice de Jacob’s Room et de toute l’œuvre à venir. C’est, à en croire son Journal, le 26 janvier 1920 que Woolf a conçu la forme de son nouveau roman. James partait d’un sujet, auquel il devait ensuite trouver un espace à habiter ; Woolf part, elle, d’une forme, d’un espace (« room »…) qu’il lui faut ensuite habiter : « je suis arrivée cet après-midi à quelque idée d’une nouvelle forme pour un nouveau roman (…) Je n’ai aucune idée du thème ; mais je vois d’immenses possibilités dans la forme que j’ai découverte, plus ou moins par hasard, il y a deux semaines. » Et cette nouvelle forme procède de l’idée, volontairement avortée, expérimentée, comme pour rire, dans An Unwritten Novel, « une chose qui s’ouvre à partir d’une autre, écrit Woolf, non plus sur dix pages cependant, mais sur deux cents. » Aussi n’est-il pas anodin que Woolf ait inclus dès les premiers chapitres de Jacob’s Room une scène faisant explicitement référence à son expérimentation récente ; un clin d’œil peut-être, mais gonflé de sens.
Dans la nouvelle, deux femmes se retrouvent en tête à tête dans un compartiment de train. L’une sera la narratrice, un regard sans visage. L’autre, une inconnue, sera nommée par la première « Minnie Marsh », au point de devenir, le temps de quelques pages, véritablement, Minnie Marsh. Et toute l’histoire découle – s’ouvre – du regard de la narratrice sur le visage de l’inconnue. Celle-ci oscille, tout au long de la nouvelle, entre deux réalités : elle est la passante, sans nom, sans histoire, rencontrée au hasard d’un voyage en train, et elle est « Minnie Marsh », pure fiction (mais la première identité n’est-elle pas déjà une fiction ? Les frontières se brouillent), projection, ludique et sérieuse à la fois, de l’esprit de la narratrice. Un visage a pénétré sa conscience et l’écrivain se met à composer avec le réel qui lui fait signe. La narratrice invente (ou découvre ?) une histoire à cette femme qui, contrairement aux autres passagers, ne respecte pas les codes de la comédie sociale et « regarde la vie ». Une seule parole sera échangée, qui ouvrira les infinies possibilités du récit, « Ma belle-sœur ». Évidemment, le roman n’a pas été écrit, l’histoire reste à l’état de fragments dispersés, de suppositions, de recherche. Or c’est précisément cet état de recherche inachevée, de sémiologie de l’être qui donne à An Unwritten Novel toute sa puissance littéraire. L’écrivain est au travail sous nos yeux et nous en découvrons le résultat en même temps que le processus. La narratrice, emportée par le flot de sa propre création, finira tour à tour par s’identifier à son personnage (mais sous quelle forme ? la passante anonyme ou « Minnie Marsh » ?) et par se convaincre de la vérité sans retour de son récit fragmentaire. Elle sera tour à tour traversée de doutes (« Vous ai-je bien lue ? Mais le visage humain – le visage humain en haut de la feuille la plus imprimée contient plus, cache plus. ») et assurée de sa victoire (« Mais Minnie, même si nous faisons semblant, je vous ai bien lue – Je suis avec vous maintenant. ») Flux et reflux, encore. Cela échappe, mais nous continuons d’essayer. Écrire ne signifie pas autre chose.
Les morceaux de la coquille ne seront jamais rassemblés. Pire, la carte que l’on croyait pouvoir y lire sera réduite en poussière. Car enfin le train s’arrête. L’inconnue, pour quelques instants encore « Minnie Marsh », descend, et retrouve son fils qui l’attend sur le quai. Cette simple présence d’un fils qu’on n’avait pas prévu, qu’on ne pouvait prévoir, annihile les efforts pour décrypter tout ce que cache et contient le visage humain. Et par un contrecoup violent, la disparition brutale de « Minnie Marsh » menace de détruire la narratrice elle-même.
« Eh bien, c’en est fini de mon univers. Sur quoi est-ce que je tiens ? Que sais-je ? Ce n’est pas Minnie. (…) Qui suis-je ? La vie est sèche comme un os. »
Moment de reflux particulièrement redoutable. Le monde, soudain, s’est vidé ; le regard erre dans un espace infini et silencieux où, pour quelques secondes d’épouvante, plus rien ne le reçoit. Ainsi lorsque j’échoue à lire l’autre ; et j’échoue le plus souvent. Paradoxe déchirant, c’est précisément cette énigme qu’il me faut pour écrire :
« Et pourtant le dernier regard sur eux – lui qui descend du trottoir et elle qui le suit, tournant au coin du gros bâtiment, me fait déborder de questions – m’inonde à nouveau. Mystérieuses silhouettes ! Mère et fils. Qui êtes-vous ? Pourquoi marchez-vous le long de la rue ? Où dormirez-vous ce soir, et demain ? Oh, comme cela tourbillonne et surgit – me recouvre de flots à nouveau ! »
Woolf dans son Journal, justement à propos de son avancée dans Jacob’s Room, nous dit, se dit à elle-même, qu’ « écrire est toujours difficile ». Bien sûr, c’est un risque énorme. Virginia, qui frôle la folie à chaque fois qu’elle met ainsi en jeu son « univers », le sait mieux que tout autre. Jacob’s Room cherche à écrire – écrire, oui, et non décrire – la présence. Celle de Jacob. Graver, au ciseau du langage, cette réalité, incroyablement vivante, incroyablement évanescente, dans la réalité, non moins vivante, non moins évanescente, du livre. Et elle ira plus loin encore dans The Waves, en écrivant la présence de Percival, celui par qui tout arrive, celui autour de qui s’enroulent les flux de conscience de tous les autres, celui, précisément, qu’on n’entendra jamais. Il est communément admis que Jacob comme Percival sont deux figures inspirées du frère adoré, mort à 26 ans, de Virginia, Thoby Stephen. Inutile de s’attarder sur l’aspect autobiographique : on comprend aisément que l’enjeu littéraire est immense. Vital, au fond.
La perte et la disparition forment, au cœur de la galaxie composée par ces deux livres, une espèce de trou noir qui attire inexorablement à lui la lumière de tous les regards. Dès les premières pages, Jacob se signale par son absence et ne semble exister d’abord qu’à travers les cris de son frère parti à sa recherche. Le récit se referme sur l’image de Mrs Flanders, tenant à la main les vieilles chaussures désespérément vides de son fils mort. Entre les deux, Jacob est bien là mais on ne parvient jamais à le saisir entièrement. Nous habitons son espace (« Jacob’s room ») pour le temps de la lecture, mais l’espace qui contient un être ne nous apprend sur lui, véritablement, qu’une seule chose : cette place qu’il occupe, maintenant, sous nos yeux, aucun autre que lui ne peut l’occuper au même moment. Cela seul donne toute sa puissance, son caractère inaliénable, littéralement inamovible, à la présence. Tout le reste est affaire de suppositions, d’interprétations plus ou moins erronées – de divinations géniales parfois, mais fugaces. Voilà ce que le récit, si singulièrement construit, de Woolf nous apprend. Voilà l’expérience qu’il nous fait vivre.
C’est une succession de regards qui passent et se posent sur Jacob. Aucun ne peut le contenir à lui seul. La réunion – impossible – de leurs faisceaux divergents ne pourrait le contenir. Il les dépasse forcément tous. Il n’empêche, ce sont eux qui nous le révèlent, dans son mystère même, comme la lumière fait apparaître tout un univers à déchiffrer. Et c’est Jacob, plus profondément, c’est cet « espace » où Jacob existe, ce trou noir, qui donne – paradoxe génial – leur cohérence à tous ces regards, son unité architecturale au récit, ainsi que Woolf l’a très vite compris en écrivant.
Alors, l’écho à An Unwritten Novel prend tout son sens. Et la scène qui ouvre le troisième chapitre de Jacob’s Room, ce chapitre où Jacob se détache de sa mère jusque-là au centre du récit et prend pleinement possession de son espace, acquiert une dimension transcendante parce qu’elle vibre de cette résonance. Les parties de l’œuvre, elles aussi, sont reliées entre elles par des millions de fibres, étendues d’un livre à l’autre, formant un réseau, une nébuleuse où naissent, et meurent, les infinies possibilités de l’univers littéraire.
De nouveau, un compartiment de train – lieu souvent privilégié par Woolf car propice à la fugitive rencontre des solitudes. Jacob se rend à Cambridge. Par un renversement remarquable, ce n’est pas le regard du héros que nous suivons, mais celui de sa compagne de voyage, une Mrs Norman que nous ne reverrons plus après cette scène. C’est d’ailleurs un exemple parmi beaucoup d’autres de la grande originalité narrative du roman de Woolf. Chaque passant à peine croisé, habituellement renvoyé au quasi néant du royaume des ombres sans nom et sans histoire, dans Jacob’s Room au contraire, est systématiquement nommé dès lors qu’il pose son regard sur Jacob ; la narration entrouvre même une porte, nous offre, en quelques phrases, de jeter un œil sur la vie de ces identités fugaces, qui se détachent alors comme autant de singularités dans la courbe d’ensemble, comme autant de possibilités laissées en suspens et qui persistent incidemment dans l’esprit du lecteur. Ce procédé, loin d’être artificiel, donne au récit une épaisseur extraordinaire, à l’univers qui se dessine une réalité d’une bouleversante acuité. Le livre devient véritable lieu d’existence.
Mrs Norman, donc, observe le jeune homme qui vient d’entrer dans son compartiment. Deuxième renversement, c’est le héros du roman qui devient anonyme, c’est Jacob, encore innommé, que l’on va chercher à décrypter. La scène est un condensé de toute la démarche littéraire de Woolf dans Jacob’ Room. Mrs Norman peut exister parce qu’elle a pénétré sans le savoir dans l’espace de Jacob, qui se confond avec l’espace du livre lui-même. De celui qui ne sera pour elle qu’un jeune homme, elle a d’abord peur. Son regard est empreint de préjugés : « c’est un fait que les hommes sont dangereux. » Puis elle décide de soumettre l’inconnu à « l’infaillible test de l’apparence » – délicieuse ironie de Woolf qui ne cessera, dans tout le roman, de contredire cette supposée infaillibilité, qui la contredira un paragraphe plus loin : « Personne ne voit quiconque tel qu’il est, encore moins une femme d’un certain âge assise en face d’un étrange jeune homme dans un compartiment de train. On voit un tout – on voit toutes sortes de choses – on se voit soi-même… » C’est bien la leçon de An Unwritten Novel, ici d’autant plus juste que, contrairement à la narratrice de la nouvelle, Mrs Norman, lectrice de romans populaires, manque particulièrement d’imagination. Et sans elle, les apparences, couplées de surcroît aux préjugés de classe, d’âge et de sexe, ne diront jamais que l’accessoire : des chaussettes en accordéon, une cravate froissée, des yeux bleus. Mais justement parce qu’elle ne veut pas interpréter au-delà de cette apparence silencieuse, justement parce qu’elle ne veut ou ne peut pas la combler de mots, Mrs Norman ne risque pas de vivre l’effondrement qui menaçait la narratrice à la fin de An Unwritten Novel.
Malgré cela, tout en restant à la surface, Mrs Norman a une conscience vague du gouffre énigmatique que cette présence ouvre sous ses yeux : « il semblait si peu à sa place, inexplicablement, seul avec une dame d’un certain âge. » L’expression anglaise, « out of place », est saisissante pour qualifier, sous le regard d’une Mrs Norman, le personnage qui occupe précisément tout l’espace du roman. Le renversement de perspective mis en œuvre par Woolf dans ce passage lui permet de dévoiler, avec la plus grande sobriété, l’inhérente étrangeté de la présence, incarnée par Jacob.
Les ramifications de ce renversement vont plus loin encore. Mrs Norman, c’est en quelque sorte « Minnie Marsh » résolue. Une femme d’un certain âge venue passer un week-end avec son fils à Cambridge. Elle n’excite plus l’imagination. Jacob, d’ailleurs, ne la voit pas : « il semblait ne pas l’entendre », « il ne faisait pas attention à elle », « il n’avait pas remarqué sa présence, pensa-t-elle », « il semblait absolument indifférent à sa présence ». Et c’est cette apparente absence du regard (car Jacob l’a bien vue et finira par l’aider, maladroitement, à descendre son bagage) qui attire irrésistiblement celui de Mrs Norman, tout en lui faisant penser qu’il n’est pas à sa place, là, avec elle. Il est bien là, pourtant. La contradiction est au cœur du roman, et elle est insoluble. Aucun échange n’a lieu, et Jacob, simplement parce qu’il est là, qu’il occupe bien l’espace de son inamovible présence, a, au moins pour le temps du voyage, un impact considérable sur Mrs Norman ; la conscience de celle-ci est assiégée par l’incompréhensible existence de l’autre. Le narrateur interviendra à la fin, mais pour nous confirmer qu’il n’était pas possible de faire mieux que Mrs Norman : « Il faut s’arranger au mieux avec son témoignage. En tout cas, c’était Jacob Flanders, âgé de dix-neuf ans. Il ne sert à rien d’essayer d’inventorier la totalité des gens. On doit suivre des indices, pas exactement ce qui est dit, ni cependant complètement ce qui est fait. » Ces dernières phrases reviendront identiques dans le roman, telles une litanie d’ordre prophétique.
La scène s’achève sur une question interrompue, question absolue et sans réponse, de Mrs Norman : « Qui… » Jacob a déjà disparu dans la foule. Mrs Norman passera son week-end entourée de jeunes gens. Tous pourraient être l’inconnu du train sans qu’aucun ne le soit. La rencontre a eu lieu, entre Jacob et Mrs Norman, mais la possibilité qu’elle ouvrait s’est évanouie sans retour. « L’image de son compagnon de voyage se perdit complètement dans son esprit, comme l’épingle tordue qu’un enfant a jetée dans le puits aux souhaits tournoie dans l’eau et disparaît à jamais. »
Dernier renversement. Pour Mrs Norman, c’est l’image de Jacob qui est reléguée, au mieux, à l’état de souvenir indistinct. Pour nous, lecteurs, c’est celle de Mrs Norman. Mais, et c’est là sans doute le point crucial, pour eux comme pour nous, rien ne pourra faire que cette rencontre, si fugitive, si inachevée fût-elle, n’ait pas eu lieu. Ils ont, au-delà de leur incompréhension voire de leur indifférence mutuelles, existé, pour quelques heures seulement mais sans retour possible, l’un pour l’autre.
Le récit, comme l’univers, obéit à la loi d’entropie. Et, dans ce monde qui avance, impossible de prévoir ce qui laissera une trace, ni pour combien de temps. La pensée peut être angoissante. Clarissa Dalloway, au tout début de sa journée, s’étonne de cet apparent caprice de la mémoire. Tout le roman est construit sur cette remontée, irrépressible autant que stochastique, des souvenirs. La question est la même que dans Jacob’s Room : puis-je, en eux, me définir ? La mémoire, quatrième dimension de la conscience et de l’être, en complique encore l’appréhension. Elle est ce qui, tout en lui donnant son épaisseur, de lui reste le plus impalpable et le plus incontrôlable. Le récit, c’est là sa force inégalée, est une formidable explicitation du temps, il est ce qui permet de le penser au-delà de son inévitable évanouissement. Il est du temps fait espace – celui défini par le livre. Il décide pour lui-même ce qui laissera une trace, déjouant l’angoisse tout en l’étalant sous nos yeux, entraîne le lecteur tout en laissant à chacun la liberté de sa propre mémoire. Lequel de ces regards retiendrai-je sur Jacob, celui de Mrs Norman ou celui de Madame Lucien Gravé croisée sur l’Acropole (le vestige par excellence…) ? Un autre encore ? Le récit, enfin, dispose d’un pouvoir non négligeable : il offre de revenir en arrière, de renouveler sans cesse l’expérience de sa lecture, de modifier, non son cours inaltérable, mais la mémoire que j’en ai. Et le récit de Woolf offre, mieux qu’un autre, de se construire, de Jacob, une mémoire à la fois bien vivante et jamais figée. Il offre de penser ce que, de l’autre, à travers ces rencontres, si fortuites parfois, mais toujours irrémédiablement vécues, je me souviens. C’est dans Mrs Dalloway qu’on trouve une des plus belles illustrations de cet avènement singulier de l’autre dans la mémoire : « c’était de ses paroles qu’on se souvenait ; de ses yeux, de son canif, de son sourire, de ses bougonnements et, quand des millions de choses s’évanouissaient sans retour – comme c’était étrange ! – de quelques mots, comme cela, à propos de choux. »
Rien ne sert, à l’évidence, de se demander quelle trace on laissera, encore moins de chercher à en forcer l’inscription, toujours étonnamment accidentelle – et pourtant si signifiante et profonde. Il suffit de se laisser embrasser par le regard de l’autre et, pour un instant d’éternité, d’exister en lui, de devenir pour lui ce fragment unique, indispensable à la figure illimitée, impossible à saisir dans son ensemble, que compose mon être ; d’habiter, tel Jacob, l’espace et le temps et de se laisser habiter par eux ; d’être un point irréductible de cette immense constellation de consciences qui s’entrelacent, se séparent, puis se souviennent. Le récit, les mots, même imparfaits, justement imparfaits, garderont la trace, en assureront la rémanence.
A la fin c’est le livre, et la vie du livre, qui nous étreignent, et se courbent sous l’empreinte organique de celui qui est passé.





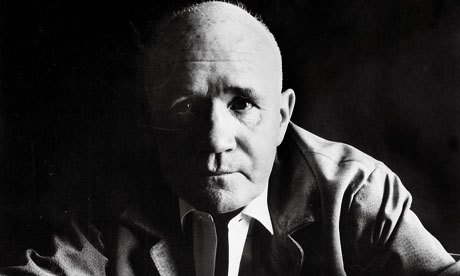


Article absolument passionnant. Merci !