Je referme pour la énième fois les deux tomes du Panégyrique de Guy Debord. A l’évidence, pour subversive que soit sa théorie critique, sa vie l’est encore davantage. Et puis les théories se réfutent, pas la vie. Dans un monde où la marchandise guide le goût, dire ce qu’on a aimé en-dehors des ersatz vendus comme enviables peut expliquer le fond de votre existence et constituer une assez belle injure pour l’époque. Avec Panégyrique, nous avons l’homme et ses passions dominantes. L’oeuvre et la trace de l’oeuvre sublimée par le style. Le goût, écrivait Lautrémont, est la qualité fondamentale qui résume toutes les autres qualités. C’est le nec plus ultra de l’intelligence.
Panégyrique en est la parfaite illustration.
La beauté de ce livre n’est pas seulement liée à son style, elle vient aussi du paradoxe que d’aucuns auront sans doute souligné : l’artiste “sans oeuvre” désira malgré tout laisser une trace. Faire oeuvre et don de son art. Oui, cet artiste sans oeuvre qui, en 1958, appelait le prolétariat à réaliser l’art – ce que fit le prolétariat au-delà toute espérance, de la révolution dite culturelle chinoise à la Star Académie ; cet artiste qui ne cessa de plaider pour un dépassement de l’art prouva, oui, quoi, sinon que l’art est indépassable, et que l’art de vivre ne va pas sans l’art de l’écrire.
Bien avant que les hommes n’inventent le mot art, ils posaient leur main sur les parois des grottes dans lesquelles ils se réfugiaient, ils posaient leurs mains et en peignaient les contours. C’est la scène primitive. L’enfance de l’art. L’art qui ignore encore qu’il en est un. Est-ce hasard si Debord, dans le second tome de Panégyrique, décida d’insérer une photographie de sa main, quand on sait ce qu’une main recèle de significations ? N’est-elle pas ce qu’il y a de plus singulier chez l’homme ? Son outil de préhension grâce auquel on caresse le monde ? La sagesse populaire ne prétend-elle pas y lire notre vie dans le recoupement de ses lignes ? N’est-ce pas le nec plus ultra de l’art et de l’art de vivre que de la tendre cette main ?
L’empreinte est la preuve qu’une autre manière de vivre est possible.
Dans un monde où il faut à tout prix que tout change pour que rien ne change, les révolutions véritables ne font pas grand tapage, ce sont des révolutions silencieuses à peine perceptibles par leurs contemporains, peu importe. Cela est peint ou cela est dit : le corps de l’artiste était ici. Le temps n’attend pas. On a agi comme il le fallait. On ne peut honnêtement juger ce qui a été accompli en omettant les intentions de l’artiste.
Debord travailla beaucoup à vivre comme il l’entendait. Le moins qu’on puisse dire est que rares sont ceux qui s’astreignent à un tel programme une vie entière. Lui n’avait d’autre ambition que de vivre une vie d’aventures, les yeux ouverts. Il y eut donc très tôt le goût de l’errance, les dérives, les rencontres improbables. J’allais d’abord, dit-il, vers le milieu, très attirant, où un extrême nihilisme ne voulait plus rien savoir, ni surtout continuer, de ce qui avait été antérieurement admis comme l’emploi de la vie ou des arts. Bourgeois désargenté, Debord dira n’avoir jamais vu les bourgeois travailler. Mais au-delà des déterminations sociales supposées tout expliquer, on peut dire que cette vie d’aventures était en grand partie due à l’histoire de la poésie moderne. La main à plume vaut la main à charrue, quel siècle à main ! Je n’aurai jamais ma main. Fut-ce avec force parcimonie, Debord comme Rimbaud n’en mirent pas moins quelques fois la main à la pâte. Seulement, l’écriture doit rester rare, puisque avant de trouver l’excellent il faut avoir bu longtemps.
Ah oui, l’alcool, fée marraine du nihilisme, nous en savons quelque chose. Et puis les femmes, bien sûr, les beautés étrangères surtout. L’altérité absolue sinon rien. Et aussi le goût de la guerre, domaine de la déception et du danger, Debord le savait très bien, et cela n’atténuait en rien son intérêt pour elle, bien au contraire. Goût de la guerre et goût de la phraséologie classique et les glissements polysémiques qu’elle permet. Le goût, nous l’avons dit, de la cohérence et de la densité. Mémoire d’un temps où l’univers était contenu dans une tête d’épingle. Son goût et son art consommé de la citation qui trahit ou l’intelligence ou la bêtise de celui qui en use. Ainsi du détournement, du montage, de la photographie. Un goût de la cohérence qui confine parfois à l’absurde. Et un dégoût princier et profond pour toute forme de compromission. Obsédé par le social, mais le tenant toujours à distance raisonnable. Sa mégalomanie était doublée d’une discrétion extrême.
Je rouvre une dernière fois le second tome de Panégyrique à la page où est visible sa main. En guise de légende ces deux phrases de Shakespeare tirées de son Jules César et qui, en soi, résument tout : “L’homme, à certaines heures, est maître de son destin. Nos fautes, cher Brutus, ne sont point dans nos étoiles, mais dans nos âmes prosternées.”


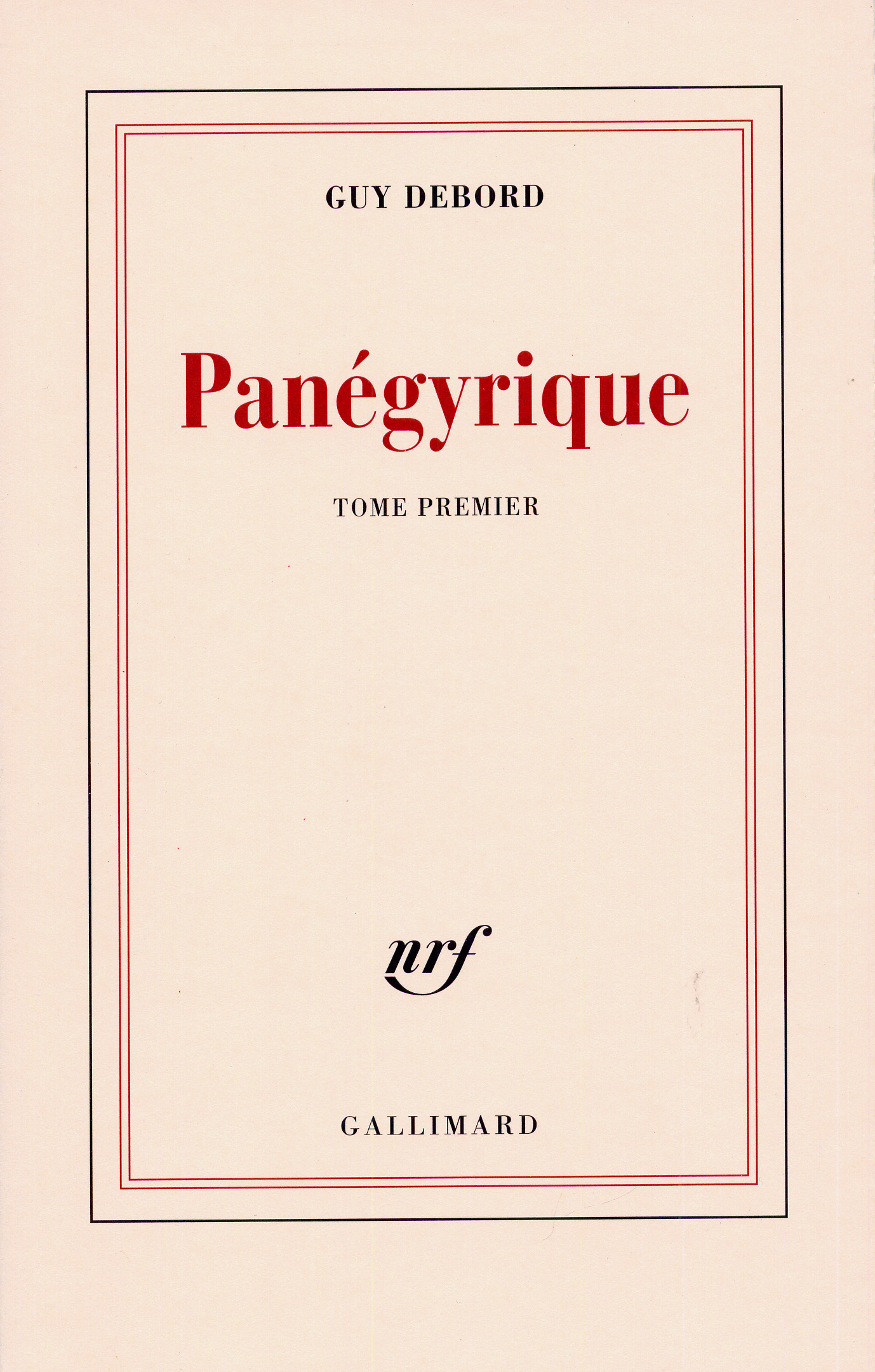

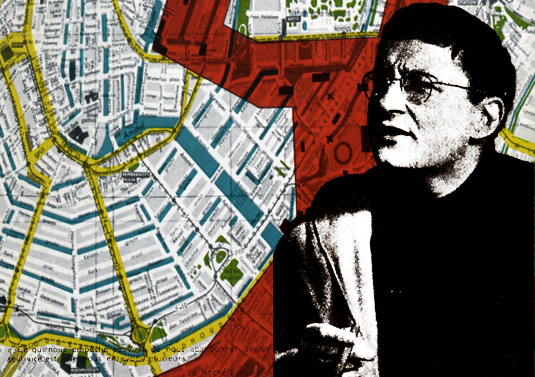
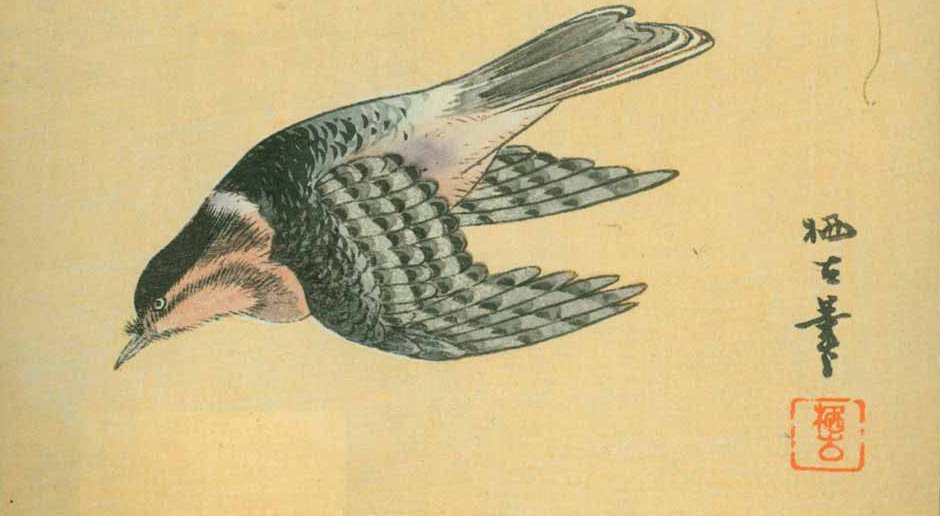


L’empreinte de la main droite réfléchit l’image de la gauche. Cette torsion imaginaire fait écran à celle du chiasme touchant /touché qui la précède par l’appui de la main sur la paroi : sans dehors ni dedans c’est le passage par l’infini actuel. Voilà de quoi faire de notre mythique primate un métaphysicien : le spectacle est troué en ce point où il ne fait pas lien social. Ainsi Debord y trouva-t-il l’ancrage de son sinthome, sa plume.