N’en déplaise à Bernard Lewis et à ses émules, le génocide de 1915 perpétré par les Jeunes-Turcs contre le peuple arménien n’a jamais laissé de marbre, depuis un siècle, les principaux écrivains et intellectuels juifs.
Michaël de Saint-Chéron a d’ailleurs souligné dans un beau texte le tribut littéraire payé par le poète russe Ossip Mandelstam à la mémoire du grand massacre, en évoquant l’empreinte que ce désastre a laissée chez un de ses compatriotes, Vassili Grossman. Quant à Elie Wiesel, qui inspire les positions éthiques de philosophes comme Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy, il a n’a eu de cesse de pourfendre le négationnisme, que celui-ci s’exerce au détriment de la Shoah ou qu’il brouille la mémoire de la catastrophe arménienne. L’auteur de « La nuit » n’a d’ailleurs jamais hésité à penser, ou à évoquer lors d’interviews, les troublantes analogies entre ces deux mécaniques exterminatrices distinctes (1).
Leur précurseur à tous, cependant, est né à Prague en 1890, dans une famille de la bourgeoisie juive, et il fut le mari d’Alma Mahler en même temps qu’un auteur autrichien visionnaire et célèbre : il s’appelle Franz Werfel. La Règle du Jeu lui a consacré, en 1991, un vaste dossier, saluant l’actualité de son utopie d’une unité humaniste de l’Europe. Mais Werfel, c’est aussi, et peut-être d’abord, l’homme qui a offert au génocide arménien son premier mémorial littéraire, « Les Quarante jours du Musa Dagh ».
Voici en quels termes Elie Wiesel a présenté la nouvelle traduction de son kaddish de 700 pages pour une petite nation assassinée : « Qu’il relève du domaine de l’imaginaire ou de celui de la mémoire, ce roman est un chef-d’œuvre, déclare le Prix nobel de la Paix. Je l’ai lu après la Libération. J’avais vingt ans. Je viens de le relire et j’y retrouve la puissance d’évocation et la conscience blessée qui, à l’époque, m’avaient bouleversé jusqu’au tréfonds de mon être. » Et Wiesel d’ajouter : « Ecrit avant l’avènement du régime hitlérien en Allemagne, ce roman semble préfigurer l’avenir ».
On ne saurait mieux dire : l’épopée de cette communauté villageoise d’Arménie assiégée par les massacreurs et optant, in extremis, pour la riposte armée, n’a rien perdu de sa puissance de sidération. Pourquoi ? Pas seulement parce que le massif du Musa Dagh évoque une manière de Massada du Caucase. Pas seulement parce qu’il y a un petit peu de la flamme des futurs combattants du ghetto de Varsovie dans l’héroïque résistance de Gabriel Bagradian et de ses compagnons. Pas uniquement, non plus, parce qu’une période de « quarante jours » figure, dans la Bible, la durée qu’il fallut au Déluge pour produire ses dévastations. Non. Si « Les Quarante jours du Musa Dagh » demeure un texte impérissable, c’est parce qu’à l’amorce des sombres temps, en ce début de juillet 1932 où les coutures de la civilisation craquent de toutes parts, son auteur parle aussi de lui, et confesse en langage codé son désespoir. Son roman se déchiffre comme un palimpseste. Ou comme une confession. Une confession où Werfel réfracte sa condition d’intellectuel juif autrichien dans le jour cru d’un révélateur analogique.
Face à la menace de persécutions imminentes, l’offensive préemptive des villageois arméniens revêt une triple dimension projective. Désigné chef de sa communauté rurale, Bagradian, dans un double geste de défi et de protection, mène ses « ouailles » vers la montagne : Moïse, auquel Werfel songe beaucoup en ces jours, n’a pas fait autre chose… Et c’est toujours tel Moïse à l’agonie contemplant la terre d’Israël du haut du mont Nebo, que Bagradian est censé mourir au faîte du Musa Dagh, « tandis que se déroule sous ses yeux le sauvetage miraculeux de son peuple » (2). En outre, ce guerrier-pasteur, si prompt à défier le programme d’anéantissement, est un marginal, un horsain, un déraciné, un « outcast », revenu au bercail après une interminable excursion dans les cercles assimilés, et parfois huppés, du Paris arménien. Entre le personnage et le romancier, là encore, un écheveau serré d’identification : en 1932, rattrapé par le Rassenhass, la folie raciale des hitlériens, Werfel, à l’instar de tant d’autres artistes de l’aire culturelle germanophone, se devine à nouveau « homme en trop » sur la terre, voué à l’irrémissibilité de l’être-juif.
Enfin, autre analogie limpide : à la fin de l’année 1932, à l’occasion d’une série de conférences, Werfel détaille sans mauvaise grâce à ses auditoires la gestation foudroyante de son grand-œuvre arménien. Avec patience, avec pédagogie, il leur explique que si, dans un passé proche, « l’un des peuples les plus anciens et les plus courageux de la terre a été presque entièrement anéanti, assassiné, exterminé », ce calvaire prend valeur d’avertissement.
Lire Werfel, donc, ou le relire… Car il s’est fait le mémorialiste d’une horreur encore déniée 97 ans plus tard, et qu’avant Soljenitsyne, avant Kundera, avant Jan Patocka, il montre que le témoignage romanesque est l’ultime abri offert aux suppliciés – et l’unique chance donnée à ceux qui n’ont rien connu de leurs souffrances d’en concevoir la simple idée. Remettre, enfin, en tête de nos agendas « Les Quarante jours du Musa Dagh », car sa défiance méthodique à l’endroit des verdicts de l’Histoire possède aussi un pouvoir, celui-là même que Vaclav Havel a nommé le « pouvoir des sans-pouvoir » : celui de prévenir, par l’exercice d’une imagination vigilante, la répétition de la barbarie.
(1)voir notamment le dialogue de Wiesel avec Charles Smolover, The Philadelphia Jewish Voice, novembre 2007.
(2)Franz Werfel, Une vie de Prague à Hollywood, Peter Stephan JUNGK,






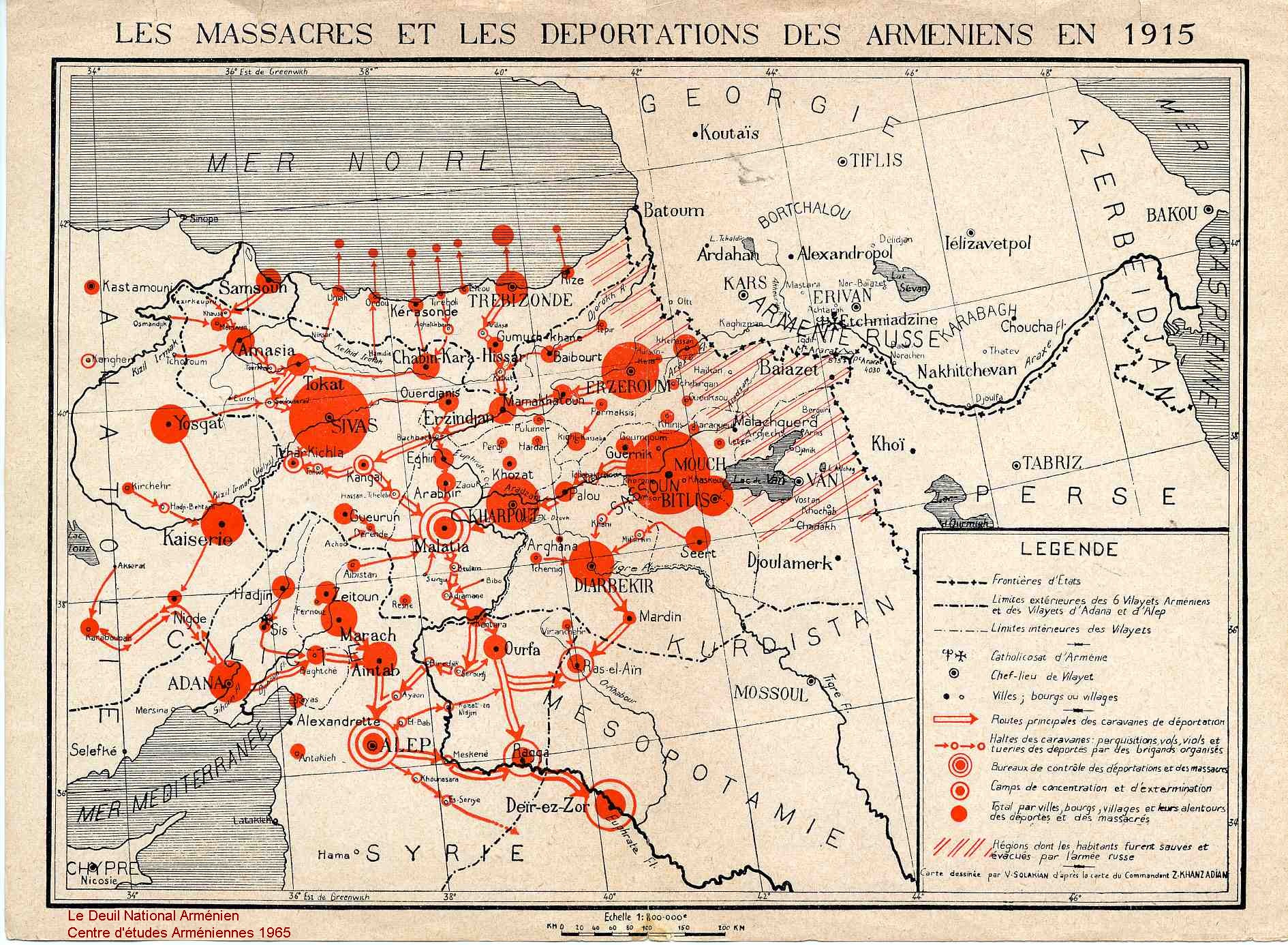


Bonsoir,
Vous avez raison, le livre de Franz Werfel est une oeuvre majeure.
Vous citez Vaclav Havel: savez-vous que Vaclav Havel a lu Les quarante jours du Musa Dagh quand il était en prison. Le jour de l’inauguration de l’exposition Couleurs de la Vie à Prague en 1991, exposition réunissant 100 artistes internationaux de 37 pays, organisée par le peintre Sir-L., à l’occasion de la commémoration du 75ème anniversaire du premier génocide du siècle subi par le peuple arménien, à la mémoire de toutes les victimes des génocides du XXème siècle, Vaclav Havel – qui avait accordé son haut-patronage à l’exposition – nous a confié qu’il a découvert le génocide des Arméniens par cette lecture du roman de Werfel!
J’aimerais également attirer votre attention sur un autre chef-d’oeuvre, le roman de Edgar Hilsenrath, Juif allemand rescapé d’un ghetto d’extermination, qui a consacré 3 ans de sa vie à étudier la vie des Arméniens dans l’Empire Ottoman et le génocide, pour écrire son Conte de la Pensée dernière, traduit aujourd’hui dans une vingtaine de langue, dont l’arménien et le turc. bien avant les historiens, Hilsenrath montre dans son roman l’implication de l’Allemagne..
Cordialement, Elisabeth Guérineau
Enfin un etat des lieux qui relate l’immonde inextinguible que seule la reconnaissance collective attenuera symboliquement .Mais peut-on defossiliser la brulure interieure ?
Vanessa De Loya psychanalyste .
@ Alexis Lacroix, merci pour ce bel hommage à Franz Werfel et pour votre texte fort qui remet les pendules à l’heure.