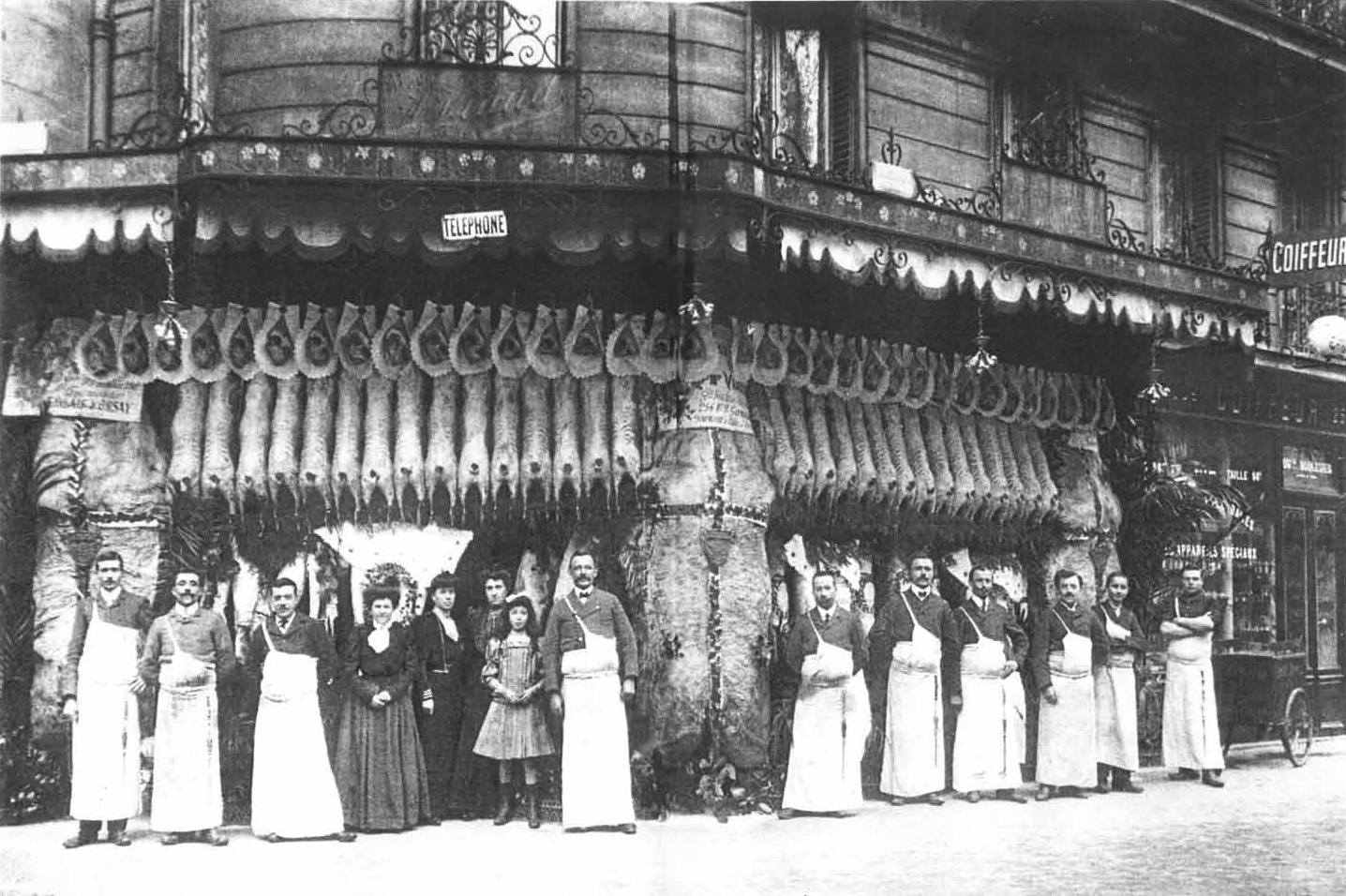Je suis né boucher.
Dès l’âge de cinq ans je montais au petit matin dans la bétaillère avec mon père, boucher à Annecy, chercher des cochons dans les alpages. L’affaire conclue, on mangeait le casse-croûte au jambon et au lard offert par le paysan, puis on redescendait à Annecy où mon père me déposait à l’école.
Les carcasses, le sang, la boucherie, l’abattoir sont toute mon enfance. Tout jeune, je partais à vélo chercher les boyaux de cochon pour faire du boudin, chez le boyaudier, à l’abattoir. On me versait du café dans un verre tellement gras que je ne voyais pas la couleur du café à travers. C’était un test, une sorte de bizutage sans le nom.
J’étais, tout gosse, presque comme un homme, mettant un point d’honneur à revenir avec la marchandise. J’ai acheté ma première génisse à onze ans, toujours à vélo. Je rentrais tout fier de chez Léon, le paysan, qui m’avait donné une courge en récompense… Mon père regarda la génisse, me dit : « Petit, c’est bien ce que tu as fait. Mais ta courge, tu l’as payée trois fois. »
Le paysan m’avait eu. Il connaissait mon père, bien sûr, il savait qui j’étais, mais les affaires sont les affaires. En vérité, mon père savait que je me ferais berner, et que ce serait, plus que tout, formateur. Une bonne leçon valable pour la vie entière n’est jamais payée trop chère. Il m’a renvoyé la fois suivante chez Léon, et là je ne me suis pas fait avoir, ni plus jamais par la suite. Léon a parfaitement joué le jeu, a baissé trois fois son prix. Il me regardait en souriant, une façon de me dire : « Je t’ai mis un coup de pied au cul, et tu as compris. C’est bien. »
J’ai tué à l’abattoir les animaux destinés à notre boucherie dès l’âge de treize ans, aux côtés des tâcherons qui me laissaient faire. On tuait les bêtes, de l’autre côté d’un petit muret, à l’aide d’un matador, un pistolet cylindrique chargé de petites balles, qu’on appelait des bosquettes.
L’école finie, plutôt que d’aller jouer au foot avec les copains, j’apprenais à plein-temps l’art de la viande. Je désossais les têtes de veau, de porc et de bœuf. J’apprenais l’épluchage, qui consiste à enlever les nerfs et l’aponévrose des membranes entre les muscles de toutes les pièces de bœuf. Je faisais les tournées des villages dans la camionnette paternelle.
Cela fait cinquante-trois ans que je suis boucher, à la fois date de l’ouverture de la boucherie et de ma naissance. Elle et moi, nous sommes nés ensemble. Nous ne nous sommes jamais quittés.
Je passe depuis un demi-siècle ou presque toutes les semaines dans les mêmes fermes, pour vendre de la viande ou acheter des bêtes. On imagine l’accueil. Je vais aux communions des enfants, aux mariages, hélas, avec le temps, aux enterrements aussi. J’entre chez Jeanine. Je lui achète ses veaux ; nous mangeons sa tarte. C’est un gâteau roulé, un biscuit fourré de confiture. Le gâteau fait un mètre de long, il dépasse la largeur du frigo. Je prends les deux morceaux qui dépassent.
Chez papy Louis, j’achète des génisses à l’automne. Il possède des herbages extraordinaires, couverts d’une herbe magnifique. L’air y est pur, et il n’y a pas une mouche à la ronde ; les bêtes ne sont pas stressées. On traite ; on s’assoit chacun sur une botte de paille dans l’écurie, je coupe du saucisson, Louis tire d’un tonneau un pichet de vin rouge. Ce n’est pas du vin, on dirait du vinaigre. Cela fait vingt ans que ça dure. C’est toujours aussi imbuvable. Mais, sur le moment, c’est l’un des meilleurs breuvages du monde.
Même chose avec les clients. Ils viennent à la boucherie et « on passe derrière », comme ils disent, déguster dans l’arrière-boutique une assiette de charcuterie savoyarde ou corse, avec une bouteille. La viande fabrique de l’amitié, du respect. C’est un produit si noble qu’il génère comme aucun autre de la complicité et de l’humanité entre les hommes.
Avec mes viandes de toutes les provenances, je fais voyager et découvrir la France à ceux qui l’aiment dans sa diversité si subtile. Je vends de la Salers venue d’Aurillac dans le Cantal, du fin gras du Mezenc, le plateau au pied du Gerbier-de-Jonc. C’est une viande AOC qui ne dure que cinq petits mois de l’année, nourrie avec du foin d’altitude, uniquement du regain (la deuxième coupe), plein de réglisse sauvage. Mais je vends aussi du bœuf d’Écosse, de l’Aberdeen Angus. Et puis j’importe d’Espagne le Wagyu, le bœuf des bœufs, cet animal-roi venu de Kobé, au Japon, où je l’ai découvert, acclimaté au nord de Burgos et bientôt, peut-être, en Savoie, par mes soins. L’agneau, bien entendu, vient des prés-salés du Mont Saint-Michel. Toutes ces viandes, je les laisse maturer de quatre à six semaines.
J’aime par-dessus tout la hampe. Quand j’étais apprenti, on la consommait au casse-croûte. C’est une viande très longue, très tendre. Vous croquez un peu dedans, le jus vous remplit immédiatement le palais, et cette texture de muscle se laisse aller sous la dent.
Mon père est parti trop tôt. J’avais vingt-trois ans. Il me manque toujours. Deux femmes m’assistent. Le mot assister est faible. Ma mère a soixante-dix-huit ans. Elle est tous les jours à la boucherie, c’est mon ministre de l’Agriculture. Elle découpe toujours la viande, Madame Bocquet, quand il y a un coup de feu dans la boutique. Et elle découvre avec un enthousiasme qui eut enchanté mon père les nouvelles viandes que les terroirs nous apportent les uns après les autres avec les saisons. Quant à ma femme, elle est aussi bouchère que moi, ce qui n’est pas peu dire.
Si un homme est heureux dans ce bas monde d’être boucher, ne cherchez pas. C’est moi.