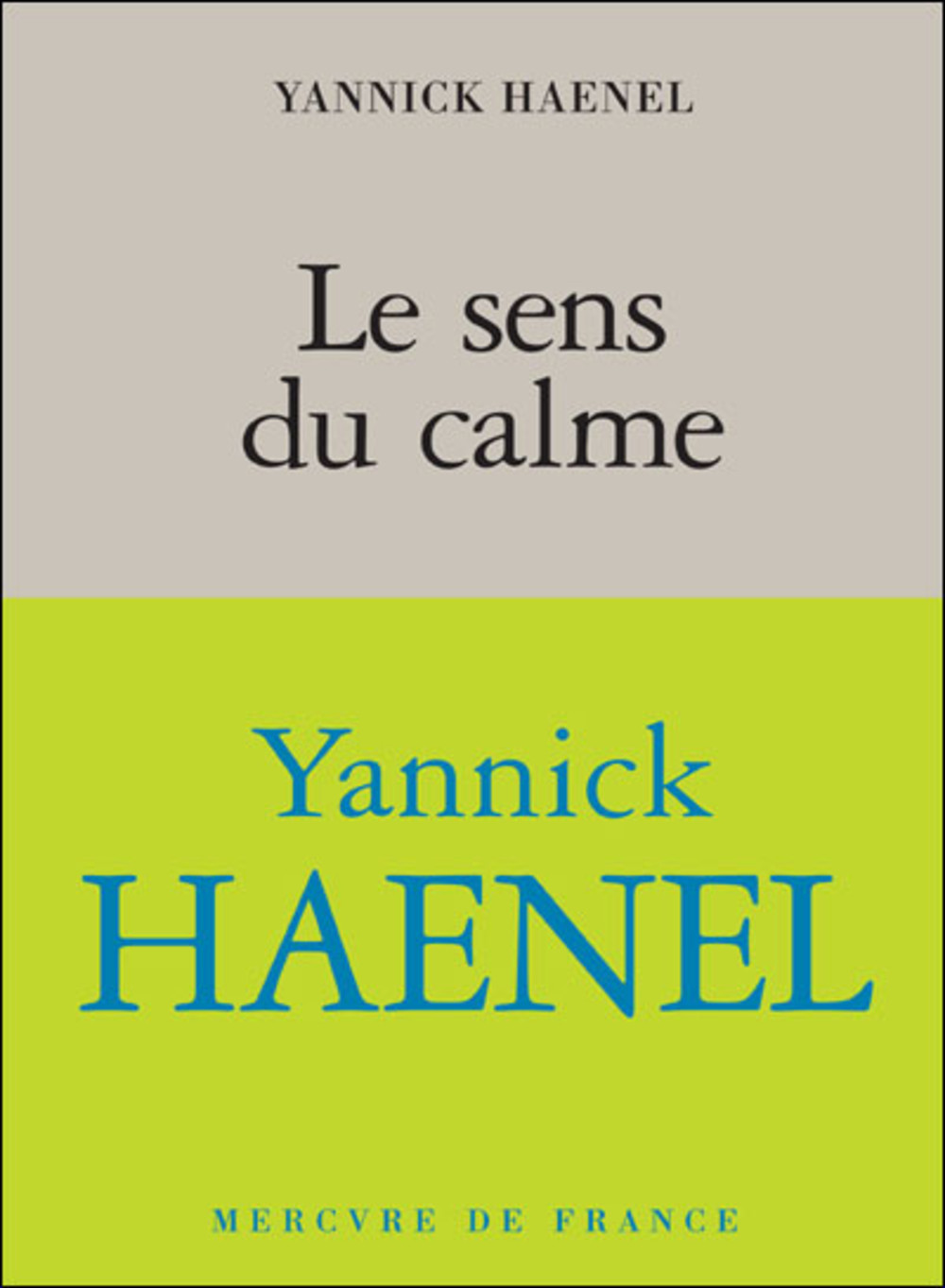Camille de Toledo, Vies potentielles

Certains se souviennent sans doute d’Archimondain jolipunk, que Camille de Toledo publia à l’aube des années 2000 dans un mélange de conviction et de désinvolture. Le livre était pourtant construit avec des équerres et demeure pour beaucoup le diagnostic irremplaçable du monde d’après la chute du mur de Berlin et du post 11 Septembre, ainsi que de la pensée critique qui tenta, comme souvent, d’être une digne remorque de l’Histoire. Suivirent, ensuite, plusieurs livres qui constituaient autant de fuites romanesques pour échapper à l’étouffement que portaient des années sombres et plombées par les raisonnements binaires ; il fallait, pour aller vite, dresser le constat que nous étions seuls, les maîtres à penser derrière nous, et que les flasques analyses de l’actualité n’offraient pas matière à nourrir une âme habitée par une révolte sans emploi. Il fallait et la rébellion et l’élégance ; et les caresses et le vent des grands événements.
Son dernier livre, Vies potentielles, est de l’ordre du sublime, au sens où il confond les ordres du discours, se joue de la fiction et du réel, fait perdre au lecteur d’entrée de jeu ses repères, les jugements bien assis. Livre total, compact, il est composé selon trois strates.
Il y a d’abord ces « vies potentielles » au sens strict. Une série d’histoires courtes brisées, fêlées, comme des séquences rapportées du grand écoulement de l’humanité, du flot informe de la vie sur terre et qu’un Dieu omniscient, qui n’est autre que l’imagination de l’écrivain, rapporterait comme un horizon fictionnel.
« J’aimerais que les amis de vos amis, les relations de vos relations, vos familles en miettes, vos enfants vivants ou morts, vos arbres généalogiques tronqués, vos meubles éparpillés, que tout entre dans les pages de ce livre et que les Vies potentielles les accueillent, attirant, de proche en proche, tout ce qu’il reste de l’homme. » C’est ce qu’explique l’auteur dans une de ses exégèses, véritable deuxième strate du livre, courts textes qui accompagnent ces bribes d’existences, les commentent, les expliquent et les décortiquent. Le « je » du narrateur prédomine et nous transporte quelque part entre le commentaire talmudique et les Confessions de Rousseau.
En troisième lieu, le livre est scandé par un récit, disons, plus mythologique, qui, sous la forme de l’allégorie, rapporte la naissance de ces êtres dont les vies sont exposées.
A partir de ce dispositif virtuose, Camille de Toledo touche à l’universelle condition humaine. Rien de moins. « Je gobe, puis j’écris comme on tousse. Je cherche à saisir, non pas, le petit drame de mes morts, mais ce qu’il reste de l’homme en moi ; ce qu’il reste de l’homme en nous. » Vies potentielles naît d’une forme de désarroi personnel autant que collectif. Si l’écrivain n’arrive pas à raconter une seule histoire, à s’attacher, à ne laisser, comme il l’écrit, « qu’un personnage et sa vie. Seule sa vie. Sa voix. Seule. » c’est parce que le monde lui-même écarte les êtres du destin, les morcelle et les renvoie dans leur éternel possible sans plus de prise sur leur vie. « Ce livre est l’image du monde, de nos vies en morceaux ».
Il y a des vivants et des morts, des destins brisés et tragiques, des vies éclatées comme des débris sur le sol et des figures de héros des temps contemporains qui pleurent le soir ou qui prennent la main de leur fils pour ne pas raconter trop de bêtises ; il y a des pères qui meurent, des enfants, aussi, des frères disparus volontairement – « eh bien comme ça, il nous fera plus chier » – et des vieilles dames qui s’épuisent à raconter une Europe défunte. Tous seront rattrapés par un possible qui leur échappe et expose « un sentiment qui nous donnerait enfin une image de l’homme, une seule, et nous permettrait de reprendre le contrôle du destin ».
Et surtout, il y a Abraham ! Le double de l’auteur, le narrateur qui nous accompagne tout au long du livre, celui qui s’exclut et s’expose, celui qui fait tourner la danse en pensant désespérément rester fixe : « Trouver une parcelle de vie qui ne soit pas déjà entièrement labourée, qui m’appartienne : un mot, une phrase, un prénom. Abraham ! » C’est le père et le fils. S’il n’existait pas, Vies potentielles serait un livre, ne serait qu’un livre, de mélancolie et de deuil, serait-on tenté de dire, mais Abraham est le double de l’écrivain, il est celui qui sait que « partout où il y avait un lien, il y a désormais une chambre vide », il est celui qui creuse tous les murs qu’il a façonnés, il est celui qui a la « nostalgie de ce qu’on appelle, la vérité » et qui, par les mots, fait de la littérature une affaire de connaissance. Non pas par les gouffres, mais par la fragilité, sur la fissure, seulement, d’un sol qui s’entrouvre sous les pieds. Non loin de lui, il y a la figure d’Agar, le nom qu’il donne à sa solitude, à son esthétique de l’émiettement. Abraham a la nostalgie de la vérité, il a aussi, et certainement, celle de l’amour.
Yannick Haenel, le sens du calme

Même si l’on sait que le texte s’écrivait depuis longtemps, il y a comme une douce ironie dans le titre du dernier livre de Yannick Haenel, Le sens du calme.
Dans A mon seul désir, je me souviens que Yannick Haenel proposait d’inventer une nouvelle catégorie de pensée, celle de la douceur.
Le sens du calme, sous une forme composite, thématique, illustrée, réinvente délicatement l’autobiographie et tient le fil de ce programme qui apprivoise la violence et la pacifie. Car Yannick Haenel façonne des phrases comme les pierres d’un royaume et ne trouve de vocation à la littérature que dans la souveraineté qu’elle accorde.
Ce dernier livre, comme les autres, n’est pas le récit d’une libération, il n’est pas non plus le regard complaisant sur la construction ou le devenir de l’écrivain, il est tout entier dans le rendu d’une expérience, dans la trace laissée par les épiphanies qu’une vie disposée à la poésie laisse surgir.
La voie est alors libre pour construire des livres d’ «assauts immobiles » pour reprendre avec lui Franz Kafka.
Article paru dans le supplément du week-end de La Libre Belgique, La Libre Essentielle, du samedi 5 mars 2011.