Dans un récent éditorial de son journal en ligne Médiapart, Edwy Plenel (que j’estime, que je respecte) me prend à partie sur un sujet important, fatidique : la démocratie. Il me reproche, par ma critique de la transparence, par mon opposition aux méthodes de WikiLeaks, ne n’être pas un démocrate, et même : d’être un antidémocrate. Je me suis dit, au vu de l’importance du sujet, qu’il serait intéressant de lui répondre longuement ; ce que je vais faire. En attendant cette réponse longue, en voici une courte.
Une précision : les attaques de M. Plenel ne sont pas de ces attaques personnelles, basses, qui abîment et défigurent le débat démocratique : il attaque mes idées avec ses idées. Mais je suis surpris, de façon vertigineuse (et je ne parle évidemment pas des auteurs de commentaires applaudissant sa vision des choses) par la confusion qui règne dans l’esprit de M. Plenel quant à la définition, justement, de la démocratie – quant à sa définition et quant à sa compréhension ; quant à sa conception.
Tout a commencé par un texte signé de moi dans lequel je fustigeais les méthodes de WikiLeaks : cette religion de la transparence qui, à mes yeux, s’éloigne de l’essence démocratique pour s’apparenter à un avatar moderne de la dictature. Je formulais l’hypothèse qu’au sein même de la démocratie, une obsession du tout-dire, du tout-montrer, du tout-révéler, du tout-savoir, pouvait s’avérer néfaste (notamment dans le domaine diplomatique) et être strictement antagoniste avec la philosophie des Lumières, celle de Rousseau et du contrat social.
Voici quels étaient, exactement, mes propos :
![]() Wikileaks n’appartient pas à la démocratie – mais à la dictature. A force d’étudier, d’examiner, puis finalement d’i
Wikileaks n’appartient pas à la démocratie – mais à la dictature. A force d’étudier, d’examiner, puis finalement d’i ncidemment remanier, d’ajuster, de réajuster la notion de « démocratie », on en oublie presque que le concept de « dictature » évolue, lui aussi. L’affaire des dossiers diplomatiques révélés ouvre la voie d’une dictature toute neuve, d’une dictature en quelque sorte contenue dans la démocratie. D’une dictature parfaitement consubstantielle à la démocratie. Il en va de même de Facebook, soyons lucides. Le rêve qu’entretenait la Stasi, dans l’Allemagne de l’Est de jadis, ou les services secrets roumains, russes, chinois, a été parfaitement réalisé par Facebook puisque Facebook est l’endroit, le lieu, le « site » où tout le monde se livre –
ncidemment remanier, d’ajuster, de réajuster la notion de « démocratie », on en oublie presque que le concept de « dictature » évolue, lui aussi. L’affaire des dossiers diplomatiques révélés ouvre la voie d’une dictature toute neuve, d’une dictature en quelque sorte contenue dans la démocratie. D’une dictature parfaitement consubstantielle à la démocratie. Il en va de même de Facebook, soyons lucides. Le rêve qu’entretenait la Stasi, dans l’Allemagne de l’Est de jadis, ou les services secrets roumains, russes, chinois, a été parfaitement réalisé par Facebook puisque Facebook est l’endroit, le lieu, le « site » où tout le monde se livre –
se livre à tous les sens du terme. Se confie, d’une part ; et d’autre part, se donne. Comme on se donne à la police. Mais la magie est là : tout le monde se livre et, pourtant, on n’a rien demandé à personne. L’Etat n’a rien demandé ; les Etats n’ont (strictement) rien exigé. Mais les gens se livrent, se donnent : révèlent sur eux leurs misérables, innombrables, infinis tas de secrets. La seule chose à laquelle les dictatures n’avaient pas pensé pour obtenir le maximum de renseignements sur les gens étaient donc celui-ci : la liberté. Chacun, sans y être obligé, installe sur son « mur » (ironie de l’appellation quand on se souvient du « Mur » de Berlin) des détails sur sa grossesse, ses vacances à Etretat, le goût de son œuf à la coque. La Stasi était contenue en chacun de nous, il suffisait de s’en aviser.
Nous noterons donc, immédiatement, que la démocratie n’a rien à voir, n’a rien à faire surtout, avec la transparence. La transparence est une obsession totalitaire. Elle est le paradis, l’horizon des régimes fascistes, des dictatures. Le mot de « totalitarisme » d’ailleurs, exprime parfaitement cette idée : tout est égal à tout, tout doit être su de tous, tout doit être connu tout le temps. C’est précisément l’idée que des choses (on appelle ça la vie des individus) puissent être retranchées de ce tout (et cesser d’être publiques pour devenir privées) qui rend fous les régimes autoritaires. Il ne faut pas s’étonner que le nazisme soit, dans sa dénomination, emprunt de socialisme (national-socialisme), ni même que le communisme ait été bâti sur une indifférenciation parfaite des existences. Ce qui compte, en dictature, c’est de rendre les êtres indiscernables – la masse prime sur l’individu (comme à l’armée, bien sûr). La condition même de l’indiscernabilité, c’est la transparence. Chacun étant privé de son intimité, de son goût propre, de sa liberté singulière, est génériquement assimilé à son voisin, et ce jusqu’à l’infini, par récurrence. Pour que les hommes, les citoyens, les paysans, les travailleurs, les militaires soient noyés dans cette masse, de façon totalitaire, il faut bel et bien que règne la transparence : on doit voir à travers chacun pour fabriquer la totalité. Si bien que, de la même façon que l’individu doit être transparent face à l’Etat, l’Etat lui-même accepte d’être transparent face à l’individu. Jamais Hitler, par exemple, n’a caché sa politique ; tout était dans Mein Kampf. Jamais Lénine, c’est un fait, n’a caché son programme : c’est par sa clarté et sa publicité qu’il étonne. Que le peuple ne cache rien et qu’on ne cache rien au peuple : voilà l’équation, pure et parfaite, de la dictature. Une transparence de tous les instants ; et qui se résume à l’enfer, car une vie sans mensonges, une vie sans secrets, une vie sans oblations, sans intimité, sans « privacy » comme disent les Anglais, n’est pas une vie supportable. Savoir cacher, momentanément, savoir voiler, pour le bien public, savoir traduire, pour éviter les emportements, savoir doser, c’est l’art et la fonction mêmes de la politique.
Et je concluais comme suit :
![]() Savoir cacher, momentanément, savoir voiler, pour le bien public, savoir traduire, pour éviter les emportements, savoir doser, c’est l’art et la fonction mêmes de la politique. Tout cela est contenu dans les philosophies contractuelles des Lumières : la somme des volontés particulières ne forme aucunement la volonté générale. Ce qu’on appelle la volonté générale, dont hérite en démocratie celui qui représente le peuple, implique l’existence de ce tamis, de ce double langage (diplomatique, politique) : j’aliène une part de ma liberté pour que ma liberté soit possible ; autrement dit : j’accepte, pour mon bien qui est lié au bien d’une communauté nationale, de ne pas être en mesure, à titre individuel et privé, de bénéficier de toutes les ressources et informations – ce privilège, je l’ai abandonné (démocratiquement) au Président de la République et à son gouvernement. Je me cache à moi-même des choses par son intermédiaire – parce que j’ai choisi, accepté de le faire ; par ce que j’admets, tacitement, qu’il en fera meilleur usage que moi, que nous tous rassemblés. Et surtout, je suis conscient que dans cette part de secret, de voile, d’opacité, réside une valeur ajoutée (en terme de sécurité, mais aussi de démocratie) que le dévoilement, que la publicité mettraient à mal. Wikileaks pose donc un problème grave : il rompt le contrat, celui de Rousseau, des Lumières. Il rompt le contrat social. Il est anti-démocratique parce que soudain, un homme, un organisme, un homme-organisme, décide de ne plus jouer le jeu, de quitter la farandole. Sans bénéficier des pouvoirs (ni la légitimité) de ceux qui nous dirigent mais surtout, mais essentiellement nous représentent, il se met en face d’eux, au même niveau, à la même altitude. Ce n’est pas, ce faisant, les Etats qu’ils insultent, mais les peuples que ces Etats représentent ; c’est nous tous qui sommes insultés. Insultés dans notre démocratie, dans notre liberté : dans notre consentement. Dans notre refus de cette grande clarté générale proposée par ces régimes qui inventèrent les camps et les goulags.
Savoir cacher, momentanément, savoir voiler, pour le bien public, savoir traduire, pour éviter les emportements, savoir doser, c’est l’art et la fonction mêmes de la politique. Tout cela est contenu dans les philosophies contractuelles des Lumières : la somme des volontés particulières ne forme aucunement la volonté générale. Ce qu’on appelle la volonté générale, dont hérite en démocratie celui qui représente le peuple, implique l’existence de ce tamis, de ce double langage (diplomatique, politique) : j’aliène une part de ma liberté pour que ma liberté soit possible ; autrement dit : j’accepte, pour mon bien qui est lié au bien d’une communauté nationale, de ne pas être en mesure, à titre individuel et privé, de bénéficier de toutes les ressources et informations – ce privilège, je l’ai abandonné (démocratiquement) au Président de la République et à son gouvernement. Je me cache à moi-même des choses par son intermédiaire – parce que j’ai choisi, accepté de le faire ; par ce que j’admets, tacitement, qu’il en fera meilleur usage que moi, que nous tous rassemblés. Et surtout, je suis conscient que dans cette part de secret, de voile, d’opacité, réside une valeur ajoutée (en terme de sécurité, mais aussi de démocratie) que le dévoilement, que la publicité mettraient à mal. Wikileaks pose donc un problème grave : il rompt le contrat, celui de Rousseau, des Lumières. Il rompt le contrat social. Il est anti-démocratique parce que soudain, un homme, un organisme, un homme-organisme, décide de ne plus jouer le jeu, de quitter la farandole. Sans bénéficier des pouvoirs (ni la légitimité) de ceux qui nous dirigent mais surtout, mais essentiellement nous représentent, il se met en face d’eux, au même niveau, à la même altitude. Ce n’est pas, ce faisant, les Etats qu’ils insultent, mais les peuples que ces Etats représentent ; c’est nous tous qui sommes insultés. Insultés dans notre démocratie, dans notre liberté : dans notre consentement. Dans notre refus de cette grande clarté générale proposée par ces régimes qui inventèrent les camps et les goulags.
Et voici, maintenant, in extenso, la réaction d’Edwy Plenel :
![]() En nos temps troublés et incertains, mêlant peurs et inquiétudes, l’extension des libertés est la seule garantie pour éviter aveuglements et démagogies, impostures et aventures. Or, au principe et au ressort de la démocratie, il y a le droit à l’information, condition d’une participation éclairée des citoyens aux affaires publiques.
En nos temps troublés et incertains, mêlant peurs et inquiétudes, l’extension des libertés est la seule garantie pour éviter aveuglements et démagogies, impostures et aventures. Or, au principe et au ressort de la démocratie, il y a le droit à l’information, condition d’une participation éclairée des citoyens aux affaires publiques.
La haine d’Internet est une haine de la démocratie, disais-je dans le billet précédent. Les polémiques soulevées par le feuilleton WikiLeaks l’ont illustré, parfois jusqu’à la caricature. C’est ainsi que l’on trouve, sur le site de la revue La Règle du jeu, dirigée par Bernard-Henri Lévy et récemment fêtée par elle-même, l’affirmation que «WikiLeaks n’appartient pas à la démocratie, mais à la dictature». Sous la signature de l’auteur de ce réquisitoire, l’écrivain Yann Moix, la démocratie a un drôle de visage, dans une inversion des valeurs toute orwellienne: loin d’être un partage, elle est un privilège; loin d’être une liberté, elle est une privation. Quand l’idéal démocratique originel, tel qu’il fut promu par les révolutions américaine et française, est celui de l’abolition des privilèges et de la souveraineté du peuple, voici donc, deux siècles plus tard, une pensée aristocratique, oligarchique et élitiste, en lieu et place d’une philosophie de la liberté.
Extrait, pour que chacun juge sur pièces, de cette pensée inégalitaire qui appauvrit la démocratie pour mieux la confisquer: en démocratie, selon Yann Moix, «j’accepte, pour mon bien qui est lié au bien d’une communauté nationale, de ne pas être en mesure, à titre individuel et privé, de bénéficier de toutes les ressources et informations – ce privilège, je l’ai abandonné (démocratiquement) au Président de la République et à son gouvernement. Je me cache à moi-même des choses par son intermédiaire – parce que j’ai choisi, accepté de le faire ; parce que j’admets, tacitement, qu’il en fera meilleur usage que moi, que nous tous rassemblés. Et surtout, je suis conscient que, dans cette part de secret, de voile, d’opacité, réside une valeur ajoutée (en terme de sécurité, mais aussi de démocratie) que le dévoilement, que la publicité mettraient à mal. WikiLeaks pose donc un problème grave : il rompt le contrat, celui de Rousseau, des Lumières. Il rompt le contrat social. Il est anti-démocratique parce que soudain, un homme, un organisme, un homme-organisme, décide de ne plus jouer le jeu, de quitter la farandole. Sans bénéficier des pouvoirs (ni la légitimité) de ceux qui nous dirigent mais surtout, mais essentiellement nous représentent, il se met en face d’eux, au même niveau, à la même altitude».
Comme en témoignent nos premières déclarations d’intention, Mediapart s’est fondé et construit sur la conviction inverse d’une démocratie qui, loin de se réduire à la délégation de pouvoir, suppose la circulation des informations et le partage des décisions. Lors de notre lancement, nous citions ainsi La haine de la démocratie, livre pionnier du philosophe Jacques Rancière qui, dès 2005, montrait combien l’idéal démocratique était désormais vécu comme une menace par les nouvelles oligarchies conquérantes d’un capitalisme vorace et rapace, sans freins ni limites. Il suffit de le relire pour trouver ample réponse à La Règle du jeu et comprendre que, décidémment, la question démocratique est devenue une véritable ligne de partage où se joue la question sociale: de la régression ou de l’extension des libertés et des droits individuels dépend le maintien ou le recul des inégalités et des injustices collectives.
 Dès lors, l’information devient un enjeu décisif: sauf à user de la contrainte et de la force – ce qui n’est jamais exclu –, toute politique socialement régressive suppose, pour s’imposer et perdurer, un peuple qui soit le moins armé pour la contester, la démasquer et la réfuter. En d’autres termes, qui en sache le moins possible, privé de l’accès le plus large aux informations d’intérêt public et détourné des vérités factuelles par des diversions et des illusions, fictions idéologiques et déréalisations aveugles. C’est en ce sens que l’épisode WikiLeaks est un marqueur et un révélateur: tous ceux qui caricaturent en transparence totalitaire ce combat explicite pour le droit à l’information des citoyens laissent entrevoir, peu ou prou, leur peur de la démocratie, de son bouillonnement et de sa vitalité, de ses excès et de ses débordements.
Dès lors, l’information devient un enjeu décisif: sauf à user de la contrainte et de la force – ce qui n’est jamais exclu –, toute politique socialement régressive suppose, pour s’imposer et perdurer, un peuple qui soit le moins armé pour la contester, la démasquer et la réfuter. En d’autres termes, qui en sache le moins possible, privé de l’accès le plus large aux informations d’intérêt public et détourné des vérités factuelles par des diversions et des illusions, fictions idéologiques et déréalisations aveugles. C’est en ce sens que l’épisode WikiLeaks est un marqueur et un révélateur: tous ceux qui caricaturent en transparence totalitaire ce combat explicite pour le droit à l’information des citoyens laissent entrevoir, peu ou prou, leur peur de la démocratie, de son bouillonnement et de sa vitalité, de ses excès et de ses débordements.
Du coup, face à cette lassitude démocratique qui saisit nos élites ou prétendues telles, d’anciennes espérances énoncées par des esprits fort raisonnables semblent soudain des brulôts révolutionnaires. En nos temps de mensonges financiers et d’opacités économiques, il n’est pas inutile de se souvenir, par exemple, de ce qu’écrivait Pierre Mendès France (1907-1982) à propos de cette «fausse science» promue avec autorité comme un savoir économique: «Le plus difficile en réalité n’est pas de faire admettre certaines données fondamentales de l’économie. Le plus difficile est de percer le rôle des préjugés et de la fausse science que trop d’hommes acceptent docilement, passivement parce qu’il a été accepté pendant des siècles. Le plus difficile, c’est d’amener les hommes à penser par eux-mêmes, qu’ils peuvent, qu’ils doivent exiger des informations complètes constamment soumises au contrôle du débat public» (Pierre Mendès France et Gabriel Ardant, Science économique et lucidité politique, 1973).
Du même Mendès France, dans La République moderne (1962), cette définition ambitieuse de la démocratie qui ferait crier au péril fasciste les tenants de la vulgate Yann Moix: «La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus puis à se désintéresser, s’abstenir, se taire pendant cinq ans. Elle est action continuelle du citoyen non seulement sur les affaires de l’Etat, mais sur celles de la région, de la commune, de la coopérative, de l’association, de la profession. Si cette présence vigilante ne se fait pas sentir, les gouvernements, les corps organisés, les fonctionnaires, les élus, en butte aux pressions de toute sorte de groupes, sont abandonnés à leur propre faiblesse et cèdent bientôt, soit aux tentations de l’arbitraire, soit à la routine et aux droits acquis. La démocratie n’est efficace que si elle existe partout et en tout temps».
Nul hasard sans doute si ces deux citations se retrouvent au fil des pages du récent essai d’Arnaud Montebourg, Des idées et des rêves (Flammarion), lequel met en tête de ses «Propositions pour établir une nouvelle et puissante démocratie» l’impérative nécessité de «rendre l’information publique accessible à tous, la partager et la dépolitiser, en créant une Agence indépendante du gouvernement, « données.gouv », chargée de mettre en ligne la totalité des informations des administrations publiques», à l’exception de celles relevant de secrets règlementés (défense nationale, enquêtes judiciaires, vie privée). «C’est l’assurance, ajoute-t-il, d’une information non manipulable entre les mains des gouvernants et la garantie pour le citoyen d’une discussion publique basée sur des données transparentes».
D’une époque incertaine à l’autre, Arnaud Montebourg est au Parti socialiste l’un de ces Jeunes Turcs que fut au Parti radical Pierre Mendès France. C’était dans l’entre-deux guerres, quand le Parti radical était encore le pivot de la vie parlementaire et avant que la Troisième République s’effondre à l’été 1940. Si nous osons ce parallèle, c’est parce que l’insistance mendèsienne sur le partage de la démocratie n’est évidemment pas sans rapport avec cette épreuve. Toute une génération vit son monde disparaître et ses repères s’enfuir au spectacle de l’avilissement de la majorité des élites politiques, économiques et intellectuelles du pays dans l’armistice et la collaboration. Mendès France fut de la petite cohorte de ceux qui dirent spontanément «non» et sauvèrent l’honneur, tout comme un autre homme de principe, peu suspect d’aventurisme ou d’inconscience, Marc Bloch.
Historien, co-fondateur avec Lucien Febvre de l’Ecole des Annales, Marc Bloch (1888-1944) fut, à un âge déraisonnable, un résistant actif. Martyr assassiné par les nazis, il a laissé une réflexion douloureusement lucide sur l’effondrement national de l’été 1940. Or L’étrange défaite, écrit en août et publié après la guerre, contient, dans sa troisième et dernière partie, une vive mise en garde sur la question qui, ici, nous occupe: le lien consubstantiel entre démocratie et information, vitalité de l’une et liberté de l’autre. S’interrogeant sur les «causes intellectuelles» de la défaite, Marc Boch écrit ceci: «N’avions-nous pas, en tant que nation, trop pris l’habitude de nous contenter de connaissances incomplètes et d’idées insuffisamment lucides? Notre régime se fondait sur la participation des masses. Or, ce peuple auquel on remettait ainsi ses propres destinées et qui n’était pas, je crois, incapable, en lui-même, de choisir les voies droites, qu’avons-nous fait pour lui fournir ce minimum de renseignements nets et sûrs, sans lesquels aucune conduite rationnelle n’est possible? Rien en vérité. Telle fut, certainement, la grande faiblesse de notre système prétendument démocratique, tel, le pire crime de nos prétendus démocrates». Et Marc Bloch, après avoir critiqué la faiblesse informative de la presse française, alors l’une des plus florissantes au monde, d’ajouter ce verdict en forme de litote: «Le sage, dit le proverbe, se contente de peu. Dans le domaine de l’information, notre bourgeoisie était vraiment, au sens du sobre Epicure, terriblement sage».
Quelques mois plus tard, en 1941, écrivant son Apologie pour l’histoire, ouvrage inachevé et également posthume, Marc Bloch enfonçait le même clou. Evoquant le matériau des historiens – témoignages, documents, traces, etc. –, il fustigeait les «deux principaux responsables de l’oubli ou de l’ignorance: la négligence, qui égare les documents; et, plus dangereuse encore, la passion du secret – secret diplomatique, secret des affaires, secret des familles qui les cache ou les détruit». «Notre civilisation, concluait-il, aura accompli un immense progrès le jour où la dissimulation, érigée en méthode d’action et presque en bourgeoise vertu, cèdera la place au goût du renseignement, c’est-à-dire, nécessairement, des échanges de renseignements.»
Telle fut, hier, la leçon de Marc Bloch. Telle est, aujourd’hui, notre exigence.
 Je vais reprendre ici, calmement, l’argumentation d’Edwy Plenel. En commençant par faire remarquer qu’une citation (puisque cela semble être sa manie) ne constitue jamais une preuve, ni un début de démonstration, ni rien d’autre qu’un témoignage – et que le fait que March Bloch ou Arnaud Montebourg aient écrit telle ou telle chose ne peut en aucun cas valoir absolution – valoir, surtout, démonstration. Cette remarque ne s’applique pas, évidemment, dès lors qu’on cite les théoriciens sur les écrits desquels furent fondées nos institutions politiques. Je ne nie pas la valeur de Marc Bloch, mais il n’a pas, dans un débat sur l’essence des régimes démocratiques, une autorité qui vaille celle d’un Rousseau, d’un Hobbes, d’un Kant ou même d’un Tocqueville. Il était bon, je crois, de le préciser.
Je vais reprendre ici, calmement, l’argumentation d’Edwy Plenel. En commençant par faire remarquer qu’une citation (puisque cela semble être sa manie) ne constitue jamais une preuve, ni un début de démonstration, ni rien d’autre qu’un témoignage – et que le fait que March Bloch ou Arnaud Montebourg aient écrit telle ou telle chose ne peut en aucun cas valoir absolution – valoir, surtout, démonstration. Cette remarque ne s’applique pas, évidemment, dès lors qu’on cite les théoriciens sur les écrits desquels furent fondées nos institutions politiques. Je ne nie pas la valeur de Marc Bloch, mais il n’a pas, dans un débat sur l’essence des régimes démocratiques, une autorité qui vaille celle d’un Rousseau, d’un Hobbes, d’un Kant ou même d’un Tocqueville. Il était bon, je crois, de le préciser.
Et maintenant, commençons.
En nos temps troublés et incertains, mêlant peurs et inquiétudes, l’extension des libertés est la seule garantie pour éviter aveuglements et démagogies, impostures et aventures. Or, au principe et au ressort de la démocratie, il y a le droit à l’information, condition d’une participation éclairée des citoyens aux affaires publiques.
L’article de M. Plenel commence, nous le voyons, par un cliché :
En nos temps troublés et incertains,
J’aimerais lui demander s’il fut jamais des temps, dans l’histoire de l’humanité, qui ne fussent « troublés et incertains » ; ou, du moins, qui ne fussent considérés comme tels, au moment où il vivaient dedans, par les hommes de ces temps-là. Sous Périclès, sous Charlemagne, sous Napoléon, m’est avis que les temps étaient, pour leurs acteurs, actifs ou passifs, tout aussi « troublés et incertains » – il est même possible, cher Plenel, que ce soit là la définition même du temps présent, puisque le temps présent est offert à l’avenir, que d’être « troublé et incertain ». Si le temps n’était ni troublé ni incertain, il serait du passé. Tous les temps passés ont été, à leur tour, tous les temps passés furent, en leur temps, des temps présents, c’est-à-dire des temps qui n’avaient pas encore été vécus, ni traversés par les hommes, les événements, les choses : il est de la nature du présent que d’être perpétuellement troublé, perpétuellement incertain. Les temps sont toujours troublés, sont toujours incertains quand nous devons les vivre ; ils le seront incessamment, et essentiellement, à l’instant que nous les vivons.
En nos temps troublés et incertains, mêlant peurs et inquiétudes,
Le cliché continue son déroulé, puisqu’il est évident que le trouble et l’incertitude ne suffisant pas, il s’agissait de redoubler de fantasmes et de mots : Thucydide, Villon, Saint-Simon, Balzac, Céline, n’ont-ils pas décrit des temps qui mêlaient la peur et l’inquiétude (ou plutôt, le singulier n’étant pas encore suffisant « les peurs et les inquiétudes ») ? Ni Kafka ? J’aurais la dignité, bien évidemment, de ne pas poser la question de savoir si Primo Levi, ou Robert Anthelme, n’ont pas, eux aussi, connu des temps troublés, incertains, encore plus troublés et plus incertains, qui mêlaient autrement qu’aujourd’hui des peurs plus grandes encore et des inquiétudes beaucoup plus vives. Et je suis étonné de constater, au-delà de ces clichés valables pour toutes les époques, qu’il est probable que nos temps, justement, soient moins troublés et moins incertains, mêlés de moins de peurs et de moins d’inquiétudes que des temps récents, des temps de barbarie encore supérieure à la barbarie contemporaine. C’est le propre de l’homme que d’avoir peur et que d’être inquiet de l’avenir, et de considérer que son époque est la pire de toutes, puisque par définition, par essence, son époque est la plus inconnue, à ce jour, de toutes les époques. Parce que le présent, son présent, n’a jamais eu lieu avant aujourd’hui : vertige face à l’inédit, au non répertorié, à la nouveauté pure, à la possibilité infinie de tous les événements, à la surprise, à l’irruption d’impensés, d’inimaginables. On a moins peur du 11-Septembre depuis qu’il est derrière nous, bien au chaud dans son année 2001 qui ne reviendra plus jamais ; le 11-Septembre 2001, figé, statufié, momifié, gelé, n’est plus troublé, n’est plus incertain, il ne fait plus peur, il n’est plus, ne sera plus jamais inquiétant : il génère des troubles nouveaux, des incertitudes inédites, des peurs fraîches, des inquiétudes réinitialisées, réajustées.
Considérer que nos temps sont « troublés et incertains, mêlant peurs et inquiétudes », c’est insinuer l’idée qu’ils le sont davantage que les temps précédents, et c’est donner à la réalité un aspect déjà déguisé, tronqué – cette rhétorique qui vise à isoler notre époque des autres pour la classer, sous prétexte qu’elle se situe maintenant, à la pointe du présent, dans une catégorie à part, parmi les produits toxiques, est habituellement un ressort intellectuel utilisé par l’extrême-droite. On aura le droit d’être surpris, par conséquent, de voir M. Plenel reprendre à son compte, avec une naïveté qui en l’occurrence ne nous émeut pas, l’antienne rebattue des lepénistes, dont le refrain fut jadis entonné par Maurras au nom d’un traditionalisme, d’un « nostalgisme » qui consiste à voir dans l’époque la plus présente, l’époque la plus dangereuse. La perte des certitudes est vécue ici comme un échec, comme une catastrophe. Est terrible ce qui est incertain. Or, lorsqu’on s’intitule, à force d’articles, un chantre imperturbable des libertés (c’est le métier de M. Plenel, et il le fait avec une énergie qui force mon respect) il est malheureux, de craindre l’incertain. L’incertain n’est-il pas, précisément, le lieu de la liberté ? (« des libertés », comme dirait M. Plenel, qui adore mettre ce mot au pluriel comme s’il en existait de différentes sortes (des bleues, des rouges, des jaunes).
En nos temps troublés et incertains, mêlant peurs et inquiétudes, l’extension des libertés est la seule garantie pour éviter aveuglements et démagogies, impostures et aventures.
 Tout d’abord, oui, cher Plenel, je considère que la démocratie n’est pas, ne peut-être définie par une extension infinie des libertés : de par sa nature même, l’Etat démocratique est fondé (et je parle bien là de Rousseau, non de Hobbes) sur la notion de contrat. Que dit Rousseau ? Que le peuple est une création de chacun d’entre nous, en tant que chacun d’entre nous désire l’égalité, la liberté et la justice. La difficulté est alors la suivante : il s’agit, pour chacun, de penser sa place comme étant membre de cette collectivité qu’est le peuple, tout en constatant que le peuple est une entité extérieure à lui. Intégrer ce peuple, nous dit Rousseau (et c’est ce que je rappelais dans le texte publié ici et qui m’attire les foudres de M. Plenel) c’est abandonner l’homme « naturel » qui siégeait en moi, l’homme égoïste et nu (autosuffisant) pour s’intégrer à la collectivité. Participer, de manière active, à l’expression de la volonté générale (qui ne saurait être la somme, obtenue mathématiquement par intégration, des volontés particulières, singulières, individuelles) implique, oui, que j’atrophie cette part de liberté naturelle : je meurs à l’égoïsme, à l’état de nature, à l’état immature, enfantin, pour devenir cette chose que nous aimons pareillement vous et moi, cher Plenel : un citoyen. La liberté du citoyen, je suis désolé, commence par conséquent, que cela ou non vous agrée, par une privation.
Tout d’abord, oui, cher Plenel, je considère que la démocratie n’est pas, ne peut-être définie par une extension infinie des libertés : de par sa nature même, l’Etat démocratique est fondé (et je parle bien là de Rousseau, non de Hobbes) sur la notion de contrat. Que dit Rousseau ? Que le peuple est une création de chacun d’entre nous, en tant que chacun d’entre nous désire l’égalité, la liberté et la justice. La difficulté est alors la suivante : il s’agit, pour chacun, de penser sa place comme étant membre de cette collectivité qu’est le peuple, tout en constatant que le peuple est une entité extérieure à lui. Intégrer ce peuple, nous dit Rousseau (et c’est ce que je rappelais dans le texte publié ici et qui m’attire les foudres de M. Plenel) c’est abandonner l’homme « naturel » qui siégeait en moi, l’homme égoïste et nu (autosuffisant) pour s’intégrer à la collectivité. Participer, de manière active, à l’expression de la volonté générale (qui ne saurait être la somme, obtenue mathématiquement par intégration, des volontés particulières, singulières, individuelles) implique, oui, que j’atrophie cette part de liberté naturelle : je meurs à l’égoïsme, à l’état de nature, à l’état immature, enfantin, pour devenir cette chose que nous aimons pareillement vous et moi, cher Plenel : un citoyen. La liberté du citoyen, je suis désolé, commence par conséquent, que cela ou non vous agrée, par une privation.
Et vous mélangez tout, cher Plenel : car cette privation même assure la possibilité du peuple souverain, au lieu qu’elle en marquerait l’impossibilité, qu’elle en incarnerait la contradiction. Ce n’est pas moi, c’est Jean-Jacques lui-même qui prononce le mot d’ « aliénation ». C’est dans Du Contrat social (I, 6) : « Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule, savoir l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. » « Aliéner » : il ne faut pas que ce mot vous effraie, vous pouvez le prendre dans son acception, juridique, de céder, d’octroyer, de vendre. Si vous voulez, l’idée, c’est que je me donne moi-même, je m’offre moi-même, de mon plein gré, à cette entité, le peuple souverain, qui me garantit une liberté non par extension (car c’est l’extension des libertés qui semble vous obséder) mais par accroissement, par approfondissement ; je cède de la liberté quantitative (votre liberté préférée) contre de la liberté qualitative (ma préférée, cher Plenel). Je me donne, je m’offre au peuple souverain, par contrat, et c’est ce peuple souverain qui va décider (grâce aux lois votées à l’Assemblée, car je vous rappelle que lorsque nous votons, en démocratie, nous ne votons pas qu’aux présidentielles – cela, vous semblez vouloir l’ignorer dans votre réponse à mon texte), c’est ce peuple souverain qui va décider, disais-je, de la partie des droits qui me reviendra. Ce n’est donc aucunement au profit d’un petit groupe ou même d’un seul (d’un tyran, d’un colonel, ou de toutes vos bêtes noires élyséennes de Mitterrand à nos jours) que je me donne : puisque le souverain, c’est nous tous, c’est tous les Français, c’est vous, M. Plenel, et c’est moi. C’est moi votre souverain, cher Plenel ; et, simultanément, vous êtes le mien.
Aucun individu, y compris le Président de la République, n’est au-dessus des autres : c’est là le génie du contrat développé dans les Lumières ; le Président de la République est une entité qui me permet, au nom de la volonté générale, de n’obéir qu’à moi tout en obéissant à l’intégralité du peuple français. A l’Assemblée nationale, c’est ma volonté, la vôtre et celle de tous les Français qui préparent et votent les lois ; à l’Elysée, c’est moi qui fait respecter la loi, et vous, et tous les Français ; conclusion : nous obéissons à nous-mêmes, puisque nous-mêmes sommes les auteurs des lois. Et oui, oui, en chemin, j’aurai aliéné, j’aurai fait le deuil de ma liberté égoïste, individuelle, particulière : je me serai ligoté, je me serai amputé de cette liberté première qui, sans peuple souverain, n’aurait demandé qu’une chose : s’étendre à l’infini. A l’état de nature, l’homme est situé dans une sphère d’extension maximale de la liberté ; la démocratie, elle, veille très précisément, non à l’extension (que vous réclamez à toutes forces et qui me semble dangereuse, très dangereuse, contraire à la démocratie) mais l’accroissement de la liberté. Ce n’est pas la même chose que d’être libre plus et que d’être libre mieux. Votre démocratie est celle de plus de liberté, la mienne est celle d’une meilleure liberté. D’une liberté plus profonde, plus forte, plus grande ; et non d’une liberté topologiquement plus étendue, plus éparpillée.
« L’extension des libertés »… C’est ici, dès cet instant à vrai dire, que les choses deviennent sérieuses ; qu’elles se compliquent. « Extension des libertés » : quelle étrange formule. Quelle formule, surtout, confuse : faut-il entendre « extension » au sens d’accroissement – c’est-à-dire que, dans un espace (public) donné, les libertés (un peu à la manière d’un gaz) devraient occuper davantage de place, de volume ? Ou bien M. Plenel entend-il donner à ce mot d’ « extension » un sens figuré dans lequel les libertés, cette fois, devraient, tout en occupant l’espace qu’elles occupent déjà, avoir une portée plus générale ? Il ne s’agit pas, dans les deux cas, du même phénomène. En effet, une chose peut occuper davantage de volume, prendre plus de place qu’auparavant, sans que sa portée n’ait gagné un seul degré ; on peut crier plus fort sans avoir la certitude d’être mieux entendu. On peut écrire plus de pages sans avoir l’assurance d’être mieux lu. Ceci (on peut le regretter) n’entraîne pas mécaniquement cela. Inversement, une chose peut être de circonférence modeste, d’étendue restreinte, confinée dans un espace qui lui est propre, occupant la place qui est la sienne sans vouloir déborder, et voir sa portée augmenter, son importance gagner, non seulement en généralité, mais en universalité. On peut emplir toute géographie et ne concerner personne ou seulement quelques uns ; on peut tenir dans un dé à coudre et valoir pour tout un peuple, et être connu d’une nation tout entière, et être reconnu par toutes les nations.
L’extension quantitative n’est pas l’extension qualitative ; et le souci que nous avons, c’est que M. Plenel ne précise pas de quelle extension il parle : si c’est celle du gaz ou de l’intelligence, si c’est celle de l’obèse ou celle de la raison. Il nous laisse choisir entre ce qui se répand et ce qui est intelligible. Il ne se pose pas la question de savoir si l’extension doit être mince et intelligible ou grasse et inaudible. Sans doute considère-t-il que la quantité entraîne avec elle, dans son inertie, la qualité, que la saturation vaut raison. Si l’on construit plus de piscines, le crawl de chacun verra sa technique s’améliorer.
Le pluriel employé par M. Plenel : extension « des libertés », suggère au lecteur qu’il appelle d’une part, à l’anarchisation de la liberté par mitoses en libertés nouvelles, multiplication de libertés neuves (comme il en va bibliquement de la multiplication des pains), dérivées ou non des anciennes ; et d’autre part, à l’augmentation stérique, au sein de l’espace démocratique existant, des libertés qui étaient déjà là, trop maigres à son goût, trop rachitiques, ectoplasmiques en regard de ce qu’elles devraient être dans une démocratie chimiquement pure. Pour M. Plenel, les libertés doivent obéir, à le suivre, à la loi de Mariotte qui, en thermodynamique, indique qu’à pression constante un gaz parfait se doit de remplir la totalité du volume qui lui est proposé. Quiconque viendrait, par hasard, faire montre de moins de chimie dans le raisonnement, de moins de pureté dans ses propositions, de moins de thermodynamique dans son appréhension de la démocratie risquerait sans doute, on en a crainte, de se voir traiter en ennemi de la liberté, en antidémocrate, en démocrate par ablation, par soustraction, par castration – or, c’est bel et bien contre cette vision d’une démocratie de Mariotte qu’il s’agit de réagir : la démocratie, fondée sur, par et pour la liberté, ne peut justement en aucun cas se permettre, il en va de sa survie, d’étendre « les » libertés à leur maximum – elle peut en revanche, et sait parfois, les élever à leur summum.
La démocratie n’a pas pour fonction de créer de nouvelles libertés chaque matin, sorties d’on ne sait quel chapeau ; ni d’étendre, selon la loi PV = nRT, les libertés existantes en leur offrant je ne sais quel espace dans son ultime totalité.
La démocratie est d’abord une limitation de l’extension de la liberté qui, par-là même, autorise sa possibilité et son accroissement. Son affermissement. C’est bien là, n’en déplaise à M. Plenel, le message de Rousseau : si je souhaite faire partie de la collectivité nationale, il me faut avant toute chose me délester de ma liberté « naturelle », cette liberté égoïste, chimiquement pure justement, puisqu’elle me serait livrée dans cet autre état chimiquement pur qu’est l’état de nature. Dans l’état de nature, précisément, ma liberté occupait tout l’espace ; et les libertés de tout le monde saturaient l’espace, qui ne pouvant toutes les accueillir simultanément, menaçait à tout instant de se fissurer, de craquer, d’exploser. Ma liberté, dans l’état de nature qui l’état d’avant l’Etat, ne trouvait aucun barrage, aucune dérivation, ne rencontrait pour se dresser devant elle aucune censure, pas la moindre obligation : elle remplissait l’intégralité de volume qui la contenait, aveuglément, sans jamais croiser quoi que ce soit qui vînt la contrarier.
J’ai donné à Nicolas Sarkozy et à l’Assemblée nationale le droit de me cacher à moi-même des choses (notamment des réalités diplomatiques) ; car l’Elysée et l’Assemblée, c’est moi. Je n’ai pas donné au créateur de WikiLeaks, qui n’est rien pour moi et pour qui je ne suis rien, le droit de me révéler des choses que, par conséquent, j’avais tacitement décidé, représenté par ceux qui font les lois et ceux qui les font appliquer, de me cacher à moi-même. (J’ai quand même bien le droit, cher Monsieur Plenel, de me cacher des choses, non?). WikiLeaks, autrement dit, n’a aucune légitimité pour entrer en compétition avec ceux qui m’incarnent, de droit, de fait. Il y a donc viol de ma liberté au lieu qu’extension de celle-ci. Et quand il y a viol de ma liberté, il y a dictature. WikiLeaks, manipulant des informations d’Etat sans être un Etat, est ainsi en contradiction, sous la forme d’une liberté infiniment étendue, avec la liberté de l’Etat démocratique que j’ai choisi pour m’incarner.
Je suis assez confus, cher Plenel, d’avoir à vous rappeler cette phrase de Rousseau, qui pourtant doit traîner dans votre bibliothèque, à quelques centimètres de vous : « Quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera à être libre. » (Du Contrat social, I, 7) La liberté, cher Plenel, est à la fois la cause et la conséquence du contrat des Lumières.
Alors oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Oui, et Rousseau développe puissamment ce point, « il y a souvent bien de la différence entre la volonté générale et la volonté de tous » (II,3). La volonté de tous est quelque chose de fragile, d’épidermique : prompte, parfois, à obéir aux sirènes du populisme, de la démagogie, des extrêmes, des manipulateurs, de la politique dite « politicienne » ; et, je suis d’accord avec vous sur ce point, cher Plenel, il arrive plus souvent qu’on le croie, que ce soit sous les gouvernements censément les plus démocratiques que les « aventures » (comme vous dites) les plus douteuses peuvent advenir. Rousseau se méfiait notamment, déjà, de la nocivité des partis politiques et de leurs promesses, de leur toxicité, de leur pouvoir de nuire, des déviances de leur fonctionnement, et émettaient des doutes sur le bien fondé de leur démarche. C’est pourquoi, comme vous, je pense que la liberté de la presse est indispensable, et que les journalistes constituent un contrepouvoir qu’il s’agit de préserver. Mais justement : WikiLeaks, ce n’est pas de l’information. L’information, c’est une mise en forme, en relief, pensée, structurée, que le journaliste a pour mission de véhiculer ; WikiLeaks, c’est de la matière brute, bête, de la matière première. Sans tamis, sans pensée, aveugle. Votre métier, M. Plenel, c’est de traduire la matière que nous offre WikiLeaks, et non de la poser, comme une flaque informe, devant le palier de tous les Français. Car ce faisant, vous niez votre métier, vous méprisez votre mission, vous admettez, implicitement, que le journaliste que vous êtes ne sert plus à rien, qu’il n’y a plus besoin, entre le fait brut et sa réception, entre l’émetteur et le récepteur, d’un intermédiaire intelligent dont la tâche est de rendre intelligible le pétrole brut. Nous pensions que les raffineries étaient obligatoires, étaient en tous les cas souhaitables ; au lieu de quoi on se retrouve, citoyens, face à des monceaux, des stocks, des nappes de données, de comptes-rendus que nous n’avons ni vocation à connaître, ni vocation à interpréter, à traduire, à rendre comestibles. Vous êtes, cher Plenel, avec vos fantasmes d’une extension aveugle de la liberté de circulation aveugle de faits aveugles, en train de vous tirer une belle balle dans le pied.
 Je suis d’accord avec vous : la démocratie, ce n’est pas entériner un régime par un vote sage et régulier ; c’est quelque chose que chacun, chaque jour, doit surveiller, corriger, critiquer, remettre en question, interroger, bousculer. Mais on ne le fait pas en mettant tout sur la table, comme un sanglier qu’Obélix jetterait : il faut découper la viande, la cuire, la préparer, la servir. Et je ne vois pas en quoi ces propos ferait de moi un antidémocrate, je ne vous permets pas. Ce n’est pas de ma faute, si vous mélangez les concepts, si vous croyez que la liberté doit s’étendre, se dilater quand elle doit au contraire s’accroître, s’affermir. Quant à votre autre obsession, celle de l’égalité, j’espère que vous n’êtes pas sérieux. Il y a un auteur dont je vous recommande chaudement la lecture. Il s’appelle Charles Péguy. Pour Péguy, l’égalité est une invention bourgeoise : c’est la société bourgeoise qui a choisi cette obligation d’égalité aux yeux de la loi. L’égalité est une règle de comptabilité sociale qui n’existe que pour calculer arithmétiquement les punitions, des peines.
Je suis d’accord avec vous : la démocratie, ce n’est pas entériner un régime par un vote sage et régulier ; c’est quelque chose que chacun, chaque jour, doit surveiller, corriger, critiquer, remettre en question, interroger, bousculer. Mais on ne le fait pas en mettant tout sur la table, comme un sanglier qu’Obélix jetterait : il faut découper la viande, la cuire, la préparer, la servir. Et je ne vois pas en quoi ces propos ferait de moi un antidémocrate, je ne vous permets pas. Ce n’est pas de ma faute, si vous mélangez les concepts, si vous croyez que la liberté doit s’étendre, se dilater quand elle doit au contraire s’accroître, s’affermir. Quant à votre autre obsession, celle de l’égalité, j’espère que vous n’êtes pas sérieux. Il y a un auteur dont je vous recommande chaudement la lecture. Il s’appelle Charles Péguy. Pour Péguy, l’égalité est une invention bourgeoise : c’est la société bourgeoise qui a choisi cette obligation d’égalité aux yeux de la loi. L’égalité est une règle de comptabilité sociale qui n’existe que pour calculer arithmétiquement les punitions, des peines.
Là encore, nous sommes dans ce que vous préférez : la quantité. Moi, l’égalité, ça ne m’intéresse pas : je suis favorable une fois encore à la qualité ; c’est-à-dire, en l’occurrence, à l’équité. Ecoutons Péguy – c’est dans Bernard-Lazare (septembre 1903), Pléiade, tome 1, page 1236 (texte posthume) :
« Le principe que tous les citoyens sont égaux devant la loi n’est pas tant un principe de justice – nous avons dans un précédent cahier commencé à distinguer de l’idée de justice, qui est première, fondamentale, morale, universelle, obligatoire, l’imagination grossière d’égalité, qui n’en est le plus souvent qu’une contrefaçon vile, et nous essaierons de démontrer, quelque jour que nous en aurons le temps, que le principe que tous les citoyens sont égaux devant la loi n’est pas tant un principe de justice – qu’une règle de comptabilité ; c’est une règle de comptabilité sociale, grossière, sommaire, commode, facile, inexacte, établie surtout pour faciliter le calcul des sanctions ; c’est une règle instituée non pas autant pour assurer dans l’humanité l’administration de la justice que pour faciliter dans la société la répartition du doit et de l’avoir ; affirmer que tous les citoyens sont égaux devant la loi, comme l’affirme la Déclaration bourgeoise des droits de l’homme et du citoyen, ce n’est pas autant, nous le verrons, ce n’est pas autant affirmer un principe de justice humaine et d’harmonie, un de ces grands principes universels et profonds, troublants et révolutionnaires, qui font l’époque dans l’histoire de l’humanité, que poser une définition préalable de comptabilité ; et de quelle comptabilité ; s’il se fût agi d’introduire dans l’histoire de l’humanité une exacte comptabilité des intérêts politiques et surtout des intérêts économiques, il pouvait y avoir là toute une origine révolutionnaire ; mais il s’agissait au contraire d’imaginer une comptabilité inexacte et raide ; c’était au fond conclure un arrangement conservateur. »
Ce que vous ne comprenez pas, cher Plenel, c’est que défendre comme vous le faites, l’égalité à tout prix, c’est défendre les valeurs strictement bourgeoises de la Révolution française, Révolution que vous évoquez dans votre texte comme l’absolue référence – sans vous douter de quelques-uns de ses vices, elle qui, je vous l’accorde, n’est quasiment pourvue que de vertus. L’égalité dont vous parlez, monsieur Plenel, est une fausse égalité : car les citoyens ne sont pas à égalité pour interpréter, digérer, assimiler la masse énorme, violente, brutale véhiculée par WikiLeaks. Tout le monde, précisément, n’est pas à égalité devant ce dévoilement, cette transparence ; et en imposant à tous le contenu de documents voués à rester secrets, vous ne faites qu’aggraver les inégalités – alors que jadis, quand vous étiez journaliste et non simplement passe-plat, quand vous étiez interprète et non simplement laquais, vous rectifiiez les inégalités parce que vous éduquiez vos lecteurs, vous leur expliquiez, vous vous efforciez de n’en laisser aucun sur le bord du chemin. Avec votre transparence, votre nouvelle lubie de tout déverser dans la salle à manger, tous les gravats, toute la tourbe, vous ne faites plus l’effort de trier, de sélectionner, d’expliquer : vous remettez chacun en face de son incompétence. Votre défense de la transparence est une démission. Une dé-mission.
Vous étiez, jadis, un éducateur. Vous n’êtes plus qu’un livreur. Les citoyens ne sont pas égaux devant les faits bruts ; ils le deviennent quand le journaliste fait le tri dans ces faits, les ordonne, les agence. L’égalité que vous nommez égalité est une égalité bourgeoise. Élitiste. Vous me taxez d’élitisme et vous voyez à présent comme l’élitiste, c’est bel et bien vous.
Votre souci obsessionnel de l’égalité, contre lequel vous jouez pourtant, se retourne de plus contre la liberté : WikiLeaks et sa transparence peuvent en effet avoir des conséquences sur la sécurité des Etats et, partant, sur celle des citoyens. La diplomatie, cher Plenel, est une discipline qui a ses règles : vous savez, je pense, que ces dernières n’ont pas pour vocation de se fondre dans celles de l’information (surtout quand il ne s’agit pas d’information, comme je l’ai expliqué, mais de son absence). La diplomatie est une science. Comme toute science, il faut des spécialistes pour s’y adonner. La mécanique quantique est le domaine des physiciens des quanta. La diplomatie est du domaine des physiciens des Etats. On ne demande pas à M. Tout le monde, on ne me demande pas à moi, ni à vous, d’interpréter les niveaux d’énergie des neutrinos solaires ; qu’on ne demande pas, non plus, aux citoyens, d’interpréter les documents officiels. Car c’est bien d’interprétation qu’il s’agit. Avant l’interprétation des journalistes, que je réclamais plus haut, il y a d’abord l’interprétation des diplomates. Dont c’est le métier ; dont c’est la spécialité. Par conséquent, entre les faits et le lecteur moyen, il y a deux tamis : celle des diplomates et celle de la presse. Sachant tout de même que ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui, à la source, parlent : mais leur exposition officielle par tel ou tel pays. Ce qui, vous en conviendrez, demande une traduction, un savoir-faire : les diplomates sont des interprètes. Ils parviennent à déceler, mieux que nous je crois, par habitude et par métier, par expérience et par science, ce qui est anecdotique dans une alerte, ce qui est faux dans le vrai, ce qui est inquiétant dans le dérisoire, ce qui est apparent dans le crypté, ce qui est clair dans le flou, ce qui est dur dans le mou ; ce qui est fatidique dans la langue de bois, ce qui est empoisonné dans le dessert ; ce qui est violent dans la douceur ; ce qui est extravagant sous la parure du normal. Pensez-vous, M. Plenel, qu’il ne soit pas nécessaire, quand vous recevez vos analyses médicales, d’aller les faire traduire, d’aller les faire interpréter par votre médecin traitant ? Pensez-vous qu’il suffise, tapant par exemple sur Internet, d’interpréter vous-même vos taux, vos chiffres, vos courbes ? Et tout ceci au nom de ce que vous nommez, naïvement, la « transparence » ? Mais la transparence, M. Plenel, passe par l’intelligibilité – sinon, la seule et unique chose à laquelle vous parviendrez, c’est de l’opacité supplémentaire. Je suis étonné, peiné que vous ne compreniez pas cela.
Le métier d’un diplomate est d’être habile, prudent ; comme le métier du journaliste est d’être critique, renseigné. Et le métier du médecin précis, méthodique. Dans les trois cas, cela exige de la rigueur et de l’expérience – autrement dit du métier. La transparence, qui consiste à nous offrir sur un plateau toutes les données brutes, à nous qui sommes face à elles sans métier, c’est induire une aristocratie justement ; je sais que ma voisine, qui n’a pas fait d’études, ne va pas les lire comme mon avocat, ces données. L’inégalitaire, c’est vous. Je ne vous traiterais pas d’antidémocrate, car je vous sais de bonne foi ; mais l’enfer est, vous qui aimez les clichés, pavé de bonnes intentions. Votre démocratie sans barrage à la liberté, aux libertés, je n’en veux pas. A votre démocratie de libertés en surnombre, quantitativement élargies, je préfère la liberté qualitativement étendue. La démocratie n’est pas, n’a jamais été fondée sur ce dogme aberrant d’une « extension » perpétuelle des libertés : mais sur une liberté perpétuellement consolidée. Vivre en démocratie, c’est accepter une restriction de la liberté afin de la renforcer ; non prétendre l’élargir au risque de l’affaiblir. Rousseau le dit bien : pour que l’homme de la collectivité, celui qui participe de la volonté générale, soit « aussi libre qu’auparavant » (c’est-à-dire du temps de sa liberté naturelle, du temps de l’homme naturel par opposition à l’homme de maintenant, l’homme civil), il s’agit de s’imposer, de son plein gré, des restrictions de liberté. Est liberticide, M. Plenel, celui qui ne saisit pas cela.
Est liberticide également, cher Plenel, celui qui, comme vous, s’appuyant sur un texte de Mendès plein de lyrisme et de mots mais assez peu inspiré sur le fond, voudrait atténuer l’importance des urnes, du vote – dans votre esprit, il est probable qu’une démocratie soit davantage fondée sur l’information que sur le suffrage universel. Je me permets de vous renvoyer, et de renvoyer votre cher Mendès, à ces quelques lignes de Bernard Grœthuysen expliquant ce que, pour Rousseau justement, signifie le vote : « Voter, c’est témoigner de l’union sociale, c’est manifester qu’on appartient au même peuple, que l’existence particulière d’un chacun se rattache au même moi collectif, qu’on se sent pénétré du même esprit, de l’esprit social qui anime tous les membres d’une même communauté. »
Votre transparence pour tous, quand tous ne peuvent l’appréhender avec la même acuité, je vous la laisse. Je suis un membre du peuple, je fais confiance en la démocratie : le vote est là, qui donne régulièrement la confiance ou la retire quand, lorsque je me sens trahi, que je sens que je me trahis moi-même en accordant cette confiance à tel gouvernement. L’expression est libre, le vote, fréquent ; c’est par la diminution des inégalités sociales que la démocratie se fera plus forte, plus dense – plus démocratique. Pas par ce fantasme désolant, cher Plenel, d’une transparence envahissant tout l’espace public, violant ma liberté de citoyen et risquant la sécurité des nations ; une transparence qu’un journaliste digne de ce nom, ce que je croyais bien que vous étiez moi qui vous lis depuis longtemps, ne saurait accepter sans se renier.


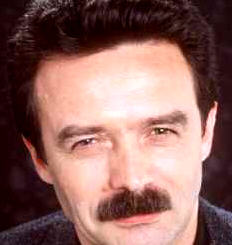





S’il fallait résumer cet échange ver(à 2)bal je ne dirais qu’une chose : « c’est de la sodomie de diptères »….
N’oubliez pas messieurs :
“Un intellectuel assis va moins loin qu’un con qui marche” (Michel Audiard)
Plenel a ce défaut fatal et bien connu de ceux qui pensent que si vous n’êtes avec eux, vous êtes contre eux. En aurons-nous entendu de ces farouches et définitifs anathèmes du coté des années 60, qui nous taxaient d’ » anti-communistes primaires » dés lors qu’on s’élevait contre quelques dérives possibles de ce noble parti. Plenel fait lit avec ces diktateurs en culotte et idées courtes. Le probléme de Plenel c’est que sa seule motivation n’est même pas issue d’un queconque engagement.
Un conflit entre Plénel et Moix est surtout un conflit entre deux egos surdimensionnés et des affirmations souvent péremptoires.
Oui à Médiapart, non à Plénel. Non , mille fois non à Moix pour sa position insensée sur l’affaire Polanski.
Messieurs MOIX et PLENEL
Je ressens votre passe d’armes comme un exercice futile de (soit-disant) intellectuels parisiens.
YM : « les attaques de Mr Plenel ne sont pas de ces attaques personnelles basses, qui abîment et défigurent le débat démocratique : il attaque mes idées avec ses idées… », c’est-à-dire entre gens de bonne compagnie, penseurs à la mode.
Quand aux autres :
« mais je suis surpris, de façon vertigineuse (et je ne parle évidemment pas des auteurs de commentaires applaudissant sa vision des choses) par la confusion qui règne dans l’esprit de M. Plenel quant à la définition, justement, de la démocratie……. »
Cela veut dire que M. Plenel a des idées confuses quant à la définition de la démocratie et cela vous surprend entre gens de bonne compagnie, mais que cela ne vous surprend pas que ces auteurs de commentaires applaudissant sa vision des choses aient des idées confuses ??
YM
« EP me prend à partie sur un sujet important, fatidique : la démocratie »
la démocratie est certainement un sujet important mais qu’entendez-vous par « fatidique » ?? fatal ? Inévitable ?
YM
« Je fustigeais les méthodes de Wikileaks : cette religion de la transparence qui, à mes yeux, s’éloigne de l’essence démocratique pour s’apparenter à un avatar moderne de la dictature »
religion de la transparence – essence démocratique – avatar moderne de la dictature : il s’agit là d’une phraséologie creuse et ampoulée qui ne veut rien dire.
« Wikileaks n’appartient pas à la démocratie, mais à la dictature ».!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wikileaks.org est avant tout un site internet, géré depuis Octobre 2010 sous couvert d’une société de droit islandais Sunshine Press Production, donc appartient à un système légal économique.
D’autres sites de ce style existent et même aux USA un National Whistleblowers Center – NWC – http://www.whistleblowers.org/
leur slogan : Honesty Without Fear.
Finalité et objectif Wikileaks est l’équivalent de Whistleblower
Le site divulgue, de manière anonyme, non identifiable et sécurisée, des documents témoignant d’une réalité sociale et politique, voire militaire, (il ne s’agit pas de renseignements personnels sur des particuliers) qui nous serait cachée, afin d’assurer une transparence planétaire. Les documents sont ainsi soumis pour analyse, commentaires et enrichissements « à l’examen d’une communauté planétaire d’éditeurs, relecteurs et correcteurs wiki bien informés ».
Selon son fondateur, Julian Assange, l’objectif à long terme est que WikiLeaks devienne « l’organe de renseignements le plus puissant au monde » – (la CIA organe de renseignements est-elle une dictature ?)
Wikileaks n’appartient ni à la démocratie ni à la dictature. C’est pour l’instant un phénomène (chose qui surprend par sa nouveauté ou par sa rareté) avant d’être assimilé et accepté comme d’autres phénomènes avant lui (idem pour Facebook) et avec ses bons et mauvais côtés, ses avantages et inconvénients.
Vous mélangez tout en comparant Wikileaks à Facebook. Mais c’est pratiquement la seule attaque que peuvent utiliser ceux qui sont contre Wikileaks.
Facebook (je l’utilise) est pour moi un moyen de communication qui s’apparente aux courriers, cartes postales, journaux personnels, publications, etc… du passé. J’y confie ce que je veux comme j’ai pu le faire avec les « moyens du passé », en toute liberté et en assumant ce que j’y publie.
Vous dites :
« Le rêve qu’entretenait la Stasi, dans l’Allemagne de l’Est de jadis, ou les services secrets roumains, russes, chinois, a été parfaitement réalisé par Facebook puisque Facebook est l’endroit, le lieu, le site où tout le monde se livre «
A l’époque la STASI et tous ses équivalents ouvraient les courriers, procédaient à des écoutes téléphoniques, utilisaient des dénonciateurs, etc… La peur règnait et non la transparence (relire KAFKA ). Ne soyons pas ridicules !
Vous dites :
« Mais les gens se livrent, se donnent : révèlent sur eux leurs misérables, innombrables, infinis tas de secrets. ….. Chacun, sans y être obligé, installe sur son « mur » (ironie de l’appellation quand on se souvient du « Mur » de Berlin) des détails sur sa grossesse, ses vacances à Etretat, le goût de son œuf à la coque. La Stasi était contenue en chacun de nous, il suffisait de s’en aviser. » QUEL MEPRIS pour vos congénères ! C’est tout à fait inadmissible.
(d’ailleurs « misérables, innombrables, infinis tas de secrets », cela me rappelle quelqu’ un de MEDIAPART !
Vous dites :
« La seule chose à laquelle les dictatures n’avaient pas pensé pour obtenir le maximum de renseignements sur les gens étaient donc celui-ci : la liberté. »
Je pense à ceux qui se battent pour la liberté et j’ai honte de lire une telle phrase.
Quant à votre paragraphe suivant : « Nous noterons donc, immédiatement, que la démocratie n’a rien à voir, n’a rien à faire surtout avec la transparence. La transparence est une obsession totalitaire, etc…. » 1) de quel droit écrivez-vous « Nous noterons donc » ? Pensez-vous avoir fait une démonstration magistrale ?? Je préfère ne pas dire ce que je pense de ce paragraphe car je crois que je ne pourrais pas rester polie !
Quand aux auteurs de commentaires sur MEDIAPART, si vous les aviez lu attentivement, vous auriez appris bien des choses qui vous auraient aidé dans votre « article ».
Vous auriez pu, vous et M. Plenel, remonter à SOLON qui a instauré la démocratie et par ses réformes a permis d’accroître d’une façon extraordinaire le rôle de la classe populaire et comment il s’y est pris. Mais cela n’aurait été également que du verbiage.
Par contre, vous auriez dû parler de l’éthique, du nouveau rôle des médias et des journalistes, oui et il y avait à dire mais parler de démocratie et dictature est tout à fait à « côté de la plaque ». Idem pour M. PLENEL.
Pourriez-vous faire un article sur les demandes répétées d’assassinat faites aux USA par des personnalités politiques et médiatiques : est-ce de la démocratie ou la dictature ? Même Poutine est plus discret !
Vous pourriez traiter également ce sujet : Classement des démocraties : FRANCE N° 31 classée dans DEMOCRATIES IMPARFAITES.
Vous vouliez dire…Asinus asinum fricat ! n’est ce pas ?
Moi qui n’ai pas les idées bien en ordre, j’ai pu, et à travers cette gué-guerre les ordonner comme il se doit. Néanmoins, je pense que ce sujet (wikileaks) ne demande pas autant de pédantisme, je pense aussi que comme le mensonge, plus une vérité est grande, plus elle passe inaperçue.
Monsieur,
votre goût pour l’ellipse est fascinant au sens de la rhétorique mais peu efficace dans le cadre du débat d’idées.
Je me permets de vous faire remarquer que votre brillante construction se borne à une analyse des « essences » (liberté naturelle, contrat social…) séparée d’ une critique des formes que ces essences ont pris à l’intérieur des institutions représentatives au fil des siècles.
La démocratie n’est pas conceptualisable « in vitro », ni agitable comme une massue spéculative, elle doit en revanche nous apparaître comme une force impure soumise à de multiples tensions.
Puis-je subrepticement suggérer de renoncer au carcan spéculatif franchouillard et d’évoquer d’autres Penseurs tel Weber, Marx (n’ayez pas peur) ou Carl Schmitt ?
La Suède étant en Europe, Internet étant le monde, il y a de quoi élargir nos frontières conceptuelles.
Bien à vous.
A défaut d’en revenir aux restrictions de la démocratie athénienne originelle, faudrait-il toujours déléguer son jugement à plus apte que soi (à plus « autorisé ») ? Ce qui semblerait inévitable dans quasiment presque toutes les circonstances.
Cette réponse à Edwy Plenel -qui n’est pas sot, non plus- n’emprunte pas qu’à un questionnement des plus intéressants sur ce que devrait être la démocratie, mais tout autant à la mauvaise foi polémique mutuelle, aux questions d’amour-propre, d’égo. Elle me semble n’être qu’une image renversée ou déformée de celle de Plenel et ne pas nous sortir vraiment de la doxa démocratique, ce moindre mal, dont l’idée généreuse, mais consomptible, est décidément toujours bien en deçà de ce qu’elle suggère.
Monsieur
je n’aurais jamais aussi bien exprimé ce que je ressens devant cette « envie » de tout savoir. Vos phrases reflètent parfaitement ce que je ressens face à ces dérives.
Merci
Cordialement
Patrick Lamiable
La plume a toujours plus de force que le plomb