J’ai découvert l’œuvre de Claude Lanzmann un jour de juillet 2007. Je connaissais évidemment le nom du réalisateur de Shoah, que je n’avais jamais véritablement regardé en dehors de quelques extraits choisis. En ce jour ensoleillé à Paris, nous décidions, sur une idée de Judith Cohen Solal et en vue du voyage en Israël que des militants de l’Uejf s’apprêtaient à faire, de questionner Israël au fil de la première réalisation du cinéaste, Pourquoi Israël ?. J’ai été profondément marqué par cette œuvre. Aujourd’hui encore, des scènes et des dialogues me reviennent en mémoire. Celle où ce grand-père de Dimona, ville alors en développement du sud prédésertique du pays, raconte comment l’Agence juive, l’organisme chargé de l’immigration vers Israël, lui a promis qu’il s’installerait près de Haïfa, grand port dynamique au nord d’Israël. Ce moment où des Juifs allemands membres de l’intelligentsia israélienne évoquent avec une nostalgie bouleversante leur pays d’origine, pourtant synonyme de destruction. Ou encore l’ouverture du film avec ces Américains émerveillés par un supermarché israélien et sillonnant les allées hilares en s’exclamant : «du pain juif», «du thon juif…». Claude Lanzmann réussissait la prouesse de nous livrer un aperçu de l’État hébreu des années soixante-dix, tout en posant des questions d’une incroyable actualité. Sans doute parce qu’il amenait des interrogations sur l’essence même de l’État d’Israël.
Près de trois années ont passé, et j’ai eu ces dernières semaines l’occasion d’une nouvelle plongée dans l’œuvre de l’auteur. J’ai lu ses mémoires, revu ses films, récupéré un certain nombre de ses contributions traitant d’Israël à la revue Les Temps modernes, qu’il dirige depuis plus de vingt ans. Jean-Jacques Moscovitz m’a demandé, en vue d’un séminaire, de suivre Claude Lanzmann au fil de son rapport à Israël ; j’ai d’abord dû courir jusqu’au vertige dans les sentiers escarpés de l’histoire philosophique, politique et littéraire du xxe siècle.
Les sentiers sont escarpés et on dit l’homme abrupt. Soit. Dans Le Lièvre de Patagonie, je le découvre inclassable. Et paradoxal. Intellectuel aux allures de boxeur, il chérit la vie et frôle plusieurs fois la mort. Il aime la vitesse d’un avion de chasse ou d’un planeur mais s’applique pendant douze ans pour réaliser Shoah. Participe à nombre de meetings politiques, il se décrit pourtant comme «un spectateur curieux et détaché». Il apparaît hautain mais, tout au long de son ouvrage, il rend hommage à celui-ci et à celle-là, témoigne d’une grande fidélité à ses amis. Il dénonce le mensonge, mais peut le mettre au service de la vérité pour Shoah, «parce qu’il le faut bien», nous dit-il.
Vient finalement la rencontre attendue. Je suis invité avec d’autres à commenter le documentaire Rien ne vaut la vie consacré à Claude Lanzmann, en sa présence. Dans cette salle, le cinéaste est fidèle à son image. Il a pris plaisir à regarder ce film et maintenant qu’un échange s’installe entre lui et la salle, l’homme se joue des conventions et envoie valser quiconque tente de l’interroger sur son œuvre. La salle est divisée ; Claude Lanzmann invite son auditoire à le séduire. Quelques-uns font les groupies : «Monsieur Lanzmann vous êtes un monument, vous étiez si beau.» Lui renchérit : «Et vous pourriez ajouter que je suis resté beau !».
C’est à moi. J’ai marché longuement en ce jour de shabbat pour me rendre dans cette salle du 7e arrondissement. Et je vais parler sans micro. Il me faut élever la voix. Je m’excuse immédiatement auprès de mon auditoire et explique le périple qui m’a mené jusque-là. Le maestro semble soudain attentif. Mes convictions religieuses le touchent. Une femme insiste : «Prenez un micro, monsieur !» Je me sens déstabilisé. Lanzmann me vient en aide : «Respectez-le, madame.»
Je fais remarquer que dans ses mémoires Lanzmann narre souvent Israël avec les mots, les maux, de la Shoah. Ainsi, lorsque jeune homme il embarque pour la première fois depuis Marseille pour Haïfa, il nous confie le vivre «comme le départ d’une déportation». Il nous dit aussi qu’il entend chez les soldats d’Israël l’écho des paroles de Salmen Lewental, rescapé des Sonderkommandos. Plus loin, il relate son échange avec Relik, un pilote israélien ayant participé au raid sur Osirak. Relik a vu Shoah et semble le connaître par cœur : «Il vole pour son grand-père et sa tante assassinés par les nazis.» Ce que Lanzmann montre, c’est à quel point le souvenir de la Shoah est omniprésent en Israël. L’on comprend dès lors que Tsahal ait suivi Shoah. Denis Charbit, le directeur du département de sciences politiques de l’université ouverte de Tel-Aviv, fait remarquer que Lanzmann a choisi un mot, un seul, chaque fois en hébreu, pour nommer ses deux œuvres. Shoah comme le nom de la destruction, Tsahal comme celui de la dignité retrouvée, de la régénération ?
Je sais la portée du terme de régénération, mais je l’ose. Car sur la question du lien entre la Shoah et Israël se heurtent aujourd’hui encore bon nombre de politiques et d’intellectuels. Nier que la création de l’État d’Israël soit directement liée à la Shoah, c’est ne pas reconnaître que cet État a «pour noyau des rescapés à bout de souffrances», comme nous le dit l’auteur dans Le Lièvre de Patagonie. L’énoncer, c’est donner du crédit à l’insupportable thèse d’antisionistes trop contents de présenter Israël comme une patrie volée.
Alors comment faire ? Lanzmann ébauche une réponse. Il l’énonce clairement dans ses mémoires : fustigeant «le discours téléologique et obscène suivant lequel Israël serait la rédemption de la Shoah», il rappelle que «le sionisme politique lui est bien antérieur» et assume qu’«une relation complexe et profonde unit ses deux événements clés de l’histoire du xxe siècle». Pour l’intellectuel, l’État d’Israël, c’est finalement l’antithèse et la conséquence de la Shoah.
Antithèse et conséquence. Lanzmann aime les paradoxes. C’est souvent par ses propres tensions qu’il interroge Israël. Par sa manière si singulière d’être en permanence dedans et dehors.
Dedans et dehors. Comme lorsqu’il entretient à Israël ce rapport idéalisé qui l’emmène à concrétiser à son insu le vœu étrange de Ben Gourion, «Israël sera normal le jour où s’y trouvera filles de joie et escrocs» ; sitôt le pied posé en Terre sainte, le jeune Claude se fait avoir par un chauffeur de taxi et atterrit au café Eden où il rencontre prostituées et proxénètes. Dans cette situation que nombreux décriraient anormale, il vit pourtant la normalité au sens du fondateur de l’État. Dedans et dehors lorsqu’il s’engage aussi : l’homme est un partisan du dialogue israélo-arabe, ou a minima favorable à ce que Sartre dénomme «la contiguïté passive». Il la construit même et y consacre un numéro spécial de mille pages des Temps modernes, qui paraît le 5 juin 1967. Mais ce jour-là, c’est le début de la guerre des Six-Jours. Israël est en danger. Alors il n’hésite pas à haranguer les Juifs de France à rejoindre l’effort militaire devant la menace d’annihilation que risque le jeune État.
Lanzmann est dedans et dehors lorsque, vivant en France, il observe les Israéliens, déclare «être plus sensible à ce qu’ils ont en commun qu’à ce qui les divise», et veut les voir unis. Et dignes. Impossible d’admettre par exemple qu’une Israélienne soit sa domestique, même le temps d’une traversée de la Méditerranée. Et l’arpenteur envie parfois leur enracinement à la terre d’Israël, comme lorsqu’il rencontre ces deux frères israéliens propriétaires d’un hôtel à Safed, et qu’il ressent en contraste qu’il ne sera jamais «de souche» ni en France ni ailleurs : «Juif parmi les Juifs, je suis perdu et sans repère», nous confie-t-il.
Lanzmann est dedans et dehors. Articule les incompatibles et parfois se dupe lui-même. Il le reconnaît sans peine : «Je croyais que l’on pouvait vouloir en même temps l’indépendance de l’Algérie et l’existence de l’État d’Israël. Je me suis trompé.» Une fois il s’en noie. Préférant les conseils d’un médecin israélien à un médecin français, il craint de périr, pris dans des courants mortels à quelques brasses de la plage de Césarée. De cet état paradoxal, il souffre parfois : manquant de s’installer un jour en Israël, c’est le cœur lourd qu’il rentre en France. Sur ce bateau, harnaché à la proue durant une traversée cataclysmique, il ressemble étrangement au prophète Jonas, parti prophétiser à Ninive. Lui va contredire Sartre à Paris et lui dire que, contrairement à ce que le philosophe énonce dans ses Réflexions sur la question juive, ce n’est pas l’antisémite qui fait le Juif.
Comment être dedans et dehors ? Le plus souvent il y parvient, en recherchant la bonne distance, celle qui lui est si singulière. Il choisit de ne pas apprendre l’hébreu car il dit qu’il n’aurait pu réaliser Pourquoi Israël ? s’il avait maîtrisé cette langue. Il a pourtant fait plus que quiconque pour l’apprentissage d’un mot hébreu (Shoah). Et lorsque durant la projection de presse de Pourquoi Israël ? une journaliste américaine lui demande si sa patrie, c’est la France ou Israël, il répond : «Ma patrie, c’est mon film.»
Lanzmann rencontre d’autres sortes d’équilibristes en ces Juifs allemands émigrés en Israël dans lesquels peut-être il se retrouve un peu. À leur manière, ils sont eux aussi dans un entre-deux. Nostalgiques de l’Europe, ils sont pourtant les bâtisseurs d’Israël. L’un veut créer un institut dédié à Mozart. L’autre est resté amoureux des chants révolutionnaires allemands. Lanzmann nous dit combien ces rencontres le bouleversent. Ce rapport complexe du cinéaste à l’Allemagne apparaît dans le documentaire Rien ne vaut la vie, où il nous parle de son attachement à Berlin. Un lien est suggéré au travers de l’histoire de Rosa Luxemburg, théoricienne marxiste assassinée en 1919 lors de la répression de la révolte spartakiste. Lanzmann nous confie éprouver à chaque fois qu’il se rend à Berlin un besoin irrépressible de se rendre à l’endroit où le corps de la militante a été retrouvé, et des scènes touchantes d’un accordéoniste juif allemand et son instrument chantant à la mémoire de Rosa Luxemburg émaillent Pourquoi Israël ? comme un rappel mélancolique d’une époque révolue pour ces olim (nouveaux immigrants) de la première heure, devenus membres de la bonne société israélienne.
Lanzmann est donc dedans et dehors. Cela tombe bien. Car pour lui Israël est, comme en écho, normalité et anormalité. Ce petit pays articule lui aussi les inconciliables, il deviendra parfois allégorie du réalisateur : «J’étais comme l’État d’Israël avec ses immigrants.» Comme lui, l’État hébreu prend le temps à contre-pied. Il réalise ses films suivant son propre rythme de réalisation au défi des pressions financières ; l’État d’Israël est dans l’immédiateté «d’une nation dont les citoyens violent un tabou lorsqu’ils osent dire “Israël en 2025”», comme le suggère l’écrivain David Grossman au réalisateur, dans Tsahal.
Au cours de ma rencontre avec l’auteur, je n’ai eu l’occasion de lui livrer que partiellement les réflexions que je viens d’évoquer ici. Suite à cet échange, nous sommes allés déjeuner avec le petit groupe des organisateurs. Je lui ai dit au passage combien j’ai été impressionné par son interview de Barak en 2008, et ce faisant par l’homme politique. Claude Lanzmann a acquiescé en déclarant qu’il le trouvait brillant et m’a rappelé : «Je sais poser des questions.» Nous étions ensemble depuis plusieurs heures. Soudain il se leva de table au milieu du déjeuner : «Ce resto est dégueulasse. Ça suffit, je m’en vais !» Cette sortie théâtrale ne l’empêcha pas de nous saluer tous. Il n’était plus là, nous en parlions encore. Ce jour-là aussi il était dedans et dehors. Je me suis souvenu alors qu’un mercredi après-midi je m’étais rendu au bureau des Temps Modernes. J’espérais récupérer quelques anciens numéros de la revue. L’hôtesse à l’accueil ne savait trop si quelqu’un était présent : «Le mercredi après-midi, les responsables des Temps modernes sont là ou pas là.» Je crois volontiers à cette étrange formulation. Dedans ET dehors. Dans cet état superposé. C’est que Lanzmann expérimente la vie quantique. Comme le chat de Schrödinger, il est lui aussi capable d’être au même instant dans deux états. Et c’est toujours l’œil de celui qui l’observe qui choisit ; «Il y a mille chemins pour entrer dans Shoah», aime à répéter Claude Lanzmann. Comprendre son œuvre, c’est renoncer à la saisir. Après tout, peut-être ce jour-là était-il là ET pas là.



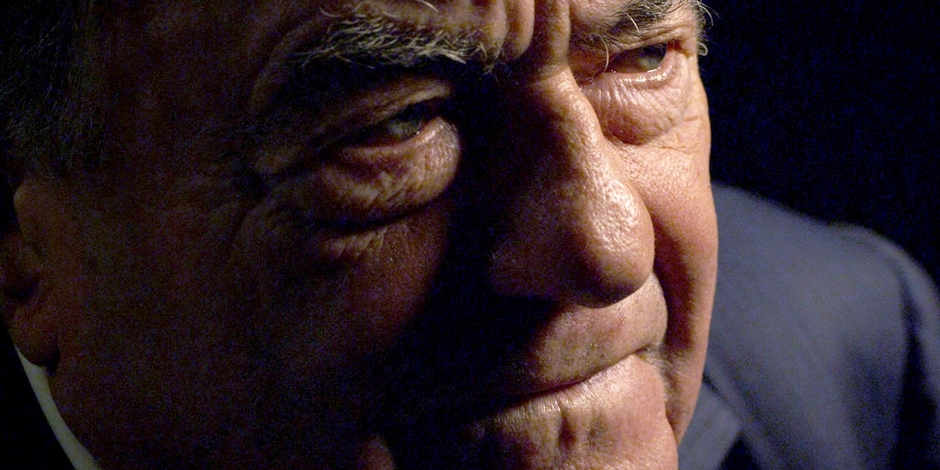




Un très bel (et sensible) article, oui, bravo !
Un acheteur, lecteur et prescripteur de ce livre merveilleux qu’est « Le lièvre de Patagonie ».
http://www.librairie-gallimard.com/detaillivre.php?gencod=9782070120512
Lanzmann
R. Haddad
Yves
Asermourt
merci chacun de vous a honnoré le juste Lazmann
merci à vous tous, je ne sais pour ma part le dire alors je le lis, merci
Monsieur Lanzmann est comme monsieur Baron, que j’appelais tonton Charles, revenu de Buchenwald avec 29 kilos de peaux sur la puissante ossature, devenu éleveur de rêves, il voyait tout avec des yeux que fixait l’infini inférieur, il entendait tout de la voix d’un sourd. Monsieur Lanzmann est mon grand-père tout craché à la face de Dieu. Personne ne peut plus l’impressionner. Rien ne l’interrompra. Rien ne l’empêchera d’enchaîner sa énième phrase par une autre phrase menançant de ne pas être la dernière. Ni plus grand. Ni plus haut. Claude Lanzmann. Un Ia’acob parmi nous. Les faces d’Él? Il leur montre ses faces. Le voir, c’est voir ce qu’il a vu en regardant ce qu’avaient vu ceux dont il a visionné les yeux. Lanzmann est revenu au monde après être retourné à l’immonde, il est un survivant d’une expérience que seuls les âmes aveugles se persuadent qu’il ne l’a pas vraiment vécue. Il n’a pas réfléchi, il est entré tout droit dans la chambre à gaz, et il a mis au monde le bébé de Charlotte Salomon. Il nous l’a mis en plein soleil, sous la manne des lettres comestibles lui donnant un dernier baiser de leurs bouches, afin que nous puissions donner un nom à son avènement que plus personne, jamais plus, ne saura empêcher de se produire.
Merci pour ce bel article : moi aussi, récemment je me « suis mis » à Lanzmann : revu ses films (y compris Le Rapport Karski) lu ses mémoires (qui n’en sont pas vraiment) : mon seul regret est que le livre soit trop court ! Mais effectivement, après les 150 dernières pages consacrées à Shoah, comment continuer à écrire ? Néanmoins, sa vision sur ses deux films (Sobibor, 14 octobre 1943, 16h et Un vivant qui passe) aurait éventuellement pu figurer dans le livre.
Votre analyse est excellente : dedans et dehors. Et oui « il sait poser les questions ». Il sait également y répondre. L’année dernière, invité par @rrêt sur image, la journaliste lui reprochait de trop se vanter dans son livre, il a répondu en ces termes : « je n’ai ni modestie ni vanité, j’ai au contraire de l’orgueil et de l’humilité » et c’est justement « cette conjonction d’orgueil et d’humilité » qui lui permet d’exposer les faits non pas objectivement… du moins, selon moi, sur le ton qui est celui du livre : orgueilleux mais juste, tendre mais sincère, humble mais précis, factuel mais -oserais-je dire- mystique.
Durant les moments passés avec lui, avez-vous évoqué ses projets futurs ? Par exemple, pour le court terme, la sortie en DVD du Rapport Karski (je verrais bien ce film ajouté aux deux autres, Sobibor et Un vivant qui passe, dans une édition mise à jour par rapport à celle des Cahiers du Cinéma de 2003). A ce sujet, je voudrais sincèrement remercier le pauvre Yannick Haenel : certes, il nous l’a bien énervé, notre directeur favori des TM… mais au moins cela nous a permis de le voir de nouveau au montage d’un film et surtout de réfléchir sur ce thème difficile qu’est la vérité historique, son rapport à la fiction, l’illusion rétrospective des historiens amateurs.
Un nouveau film ? Après tout, en 1997, 2001 et 2010, il a réalisé trois bijoux à partir de rushes non utilisés dans Shoah : pourquoi pas un quatrième film ? J’ai compté : sur les 350 heures d’images « brutes » prises lors des 10 campagnes de tournage de Shoah, Lanzmann a monté 4 films pour une durée totale de 9h10 + 1h35 + 1h05 + 0h49 soit un peu moins de 13 heures. Je suis sûr qu’il y a de la matière pour encore approfondir le sujet.
D’un point de vue éditorial, rassembler les articles qu’il a écrits (dans les Temps Modernes ou ailleurs) serait à mon avis une excellente idée. Et je répète que j’adorerais qu’il reprenne la plume pour prolonger Le lièvre de Patagonie.
Bref, merci à vous pour votre article (j’adore votre anecdote sur la manière de Lanzmann de quitter le resto !). Selon moi, Claude Lanzmann est avec Elie Wiesel (dont j’attends avec impatience le prochain roman : Otage, qui sera publié le 18 août chez Grasset) l’un des 36 justes qui permettent au monde de subsister.
très intéressant cet article !