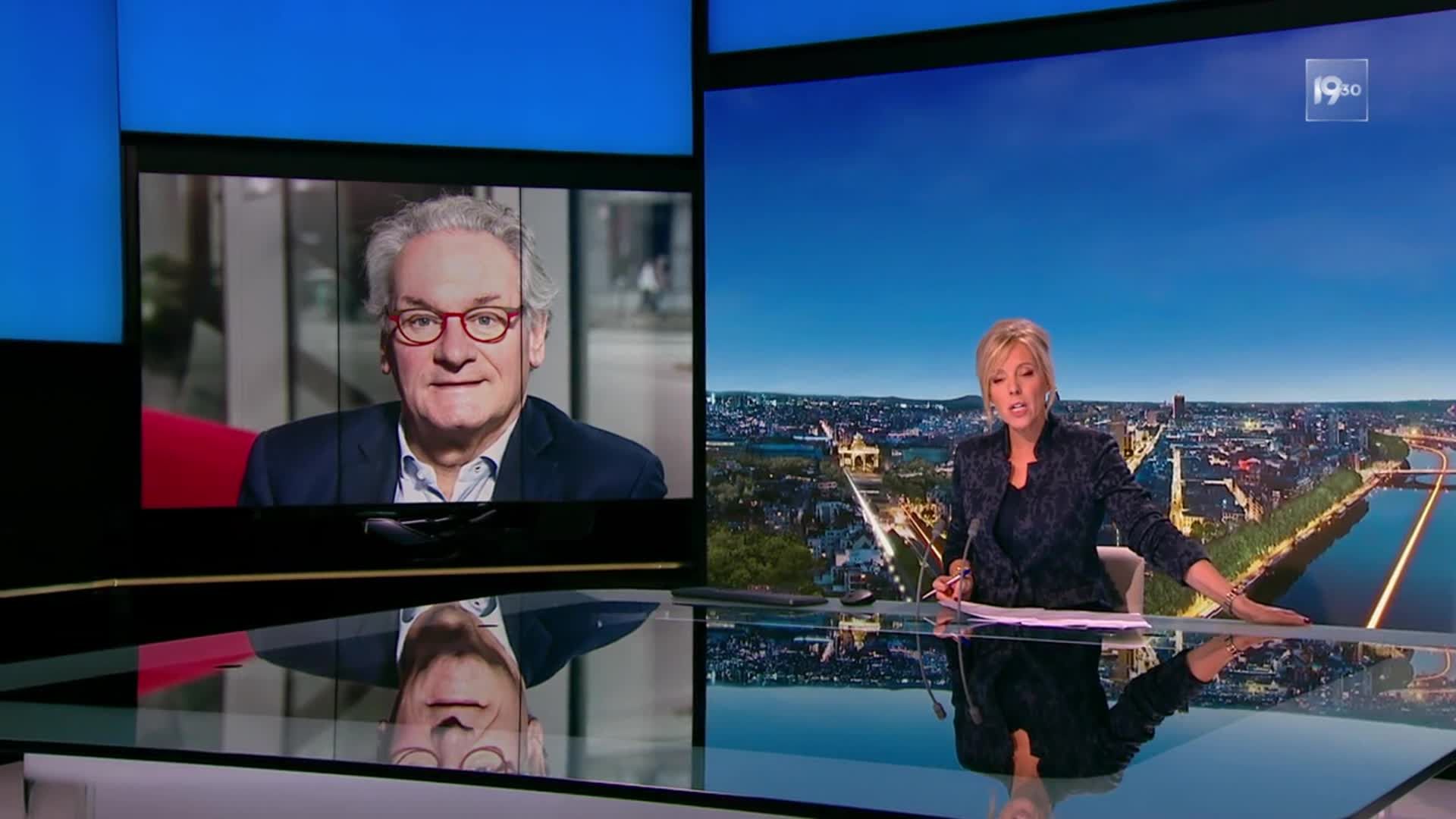Nous y sommes ! Depuis dimanche dernier, je me frotte les yeux, je tends les oreilles, à droite et à gauche, j’arpente la presse. Non, rien, vraiment, ou si peu. L’étau s’est refermé sans grincement, à peine un petit couinement ici ou là.
C’est devenu irrespirable.
C’est le même scénario qui se reproduit. Chaque fois, on pense à un dernier soubresaut pour la forme, à un petit hoquet pour maintenir le folklore, quand il se reproduit en Europe ou ailleurs. Et puis, la réalité vous saute aux yeux, vous griffe le visage, vous tord le ventre et c’est la consternation, la colère, la rage.
Bruxelles, cœur de l’Europe, capitale de la Belgique et de la Flandre. Un homme a pris le pouvoir par les urnes, comme il se devait, et il est inutile de revenir sur le bien fondé de ces dernières élections, de leur nécessité, des échecs antérieurs qu’elles n’ont fait que prolonger, de la pusillanimité des négociations qui y ont conduit. Mais nous en sommes là, aujourd’hui. Le maître du jeu politique du pays incarne un cauchemar pathétique, une farce qui donne froid dans le dos, une bonhomie calme et cynique, perverse même, qui ne s’est jamais empêchée d’envoyer les signaux qui nous renvoyaient au plus glauque de l’histoire. Cela n’a pas suffi et, apparemment, ne suffit toujours pas. Cet homme s’appelle Bart De Wever et il s’est déplacé tout sourire pour écouter Jean-Marie Le Pen en 1996. Il a encore assisté à l’enterrement de Karel Dillen, le fondateur du parti néo-nazi, le Vlaams Blok, plus récemment, et ne rate, par ailleurs, aucune occasion de rejoindre un attroupement flamand sur quelques lieux symboliques de la Flandre éternelle, fait de folklore kitsch et de fantasme délirant. Il s’est enfin, pour compléter ce triste tableau, offusqué des excuses du bourgmestre d’Anvers, Patrick Janssens, adressées à la communauté juive pour l’implication de l’administration anversoise sous l’occupation. En un mot, cet homme ne cesse de remuer les passions les plus viles, les élans les plus crapoteux, les concepts les plus douteux.
Face à cet affichage à peine masqué, à ces quelques repères qui ne trompent pas, à cette réussite électorale évidente, que voit-on ? N’y aurait-il pas ne fut-ce qu’une lueur dans les commentaires, les analyses, les textes de quelques-uns pour dire que, non, cela n’est pas possible, n’est en aucun cas recevable, que la plaisanterie a assez duré ? Pour dire, plus simplement encore, que quiconque veut continuer à joindre, dans une radicalité aussi pataude, langue et territoire doit être empêché, combattu, neutralisé ?
Eh bien, non ! Le spectacle est navrant et accablant.
Côté flamand, d’abord. Je passe sur ce qu’il aurait été bon de faire jusqu’ici pour prévenir et contenir. Mais où êtes-vous, à cet instant, auteurs, créateurs, artistes que souvent j’admire ? Vivrais-je sur une autre planète pour que ne me parvienne aucune réaction publique de votre part. Votre silence me glace.
Je pense aussi à cette presse flamande, toute la presse flamande. Je passe, encore une fois, sur ce qu’elle a fait en amont, même si à l’évidence le cadre journalistique était parfaitement construit pour que ce qui arrive maintenant en soit une conséquence logique. Mais je ne passerai pas sur les éditoriaux que j’ai pu lire au lendemain des élections, que ce soit dans De Morgen ou De Standaard, dont la complaisance, la jubilation, aussi, que l’on pouvait lire entre les lignes, est à proprement parler catastrophique, complice et coupable.
Côté francophone, ensuite, qui ne manque pas de belles âmes, qui ne manque pas de capacité de résistance et de compromis. Qu’y voir aujourd’hui, si ce n’est un attachement à la Belgique qui a bon dos, qui à long terme pourrait même se trouver, en forçant le trait, tout aussi coupable. Car c’est d’une seule voix que parlent des personnalités dont je n’ignore pas, pour certaines, les qualités, la rigueur et l’honnêteté intellectuelles, c’est d’une seule voix, oui, qu’elles se résignent, comme à une évidence, à la logique du compromis et du dialogue avec ce Bart De Wever, dans l’espoir de sauver la Belgique et son unité. Le pire, encore. Car si l’idée de nation, quelle qu’elle soit, ne devrait plus être régulatrice pour toute vraie politique, a fortiori, elle devrait encore moins l’être quand l’agenda du jour, le jeu démocratique réduit à son stade le plus trivial du simple comptage, requiert un pacte avec le rance et le moisi. De cette Belgique, je ne veux pas, et je ne voudrai jamais.
Alors, pour l’heure, c’est la honte que je ressens ! De vivre, ici, de travailler, ici. La colère face à une prise d’otage des meilleures intelligences et des visées politiques véritablement constructives dont j’ai la faiblesse de croire que le Parti socialiste, francophone, peut encore les porter.
D’urgence, il faudra que les démocrates flamands, mais aussi tous les intellectuels dignes de ce nom, se désolidarisent de leur premier parti et de celui qui l’incarne. Par des gestes et des mots qui en seront à la hauteur. D’urgence, également, il faudra que ceux qui, côté francophone, sont sortis gagnants de ces élections pensent radicalement à ce à quoi ils s’engagent. Je pense que ce sera la première adresse, la première posture, le premier signe, les premières phrases échangées qui prédiront de tout le reste. Réfléchissez. Est-ce que l’unité de la Belgique est au prix de ce risque, qui me paraît effarant, et dont je ne doute pas que nous pourrons avoir honte le jour où nous n’aurons plus que nos yeux pour pleurer ?
Pour finir et pour guider cette réflexion, ces quelques lignes que Klaus Mann adressait, si ma mémoire est bonne, à Stefan Zweig dans les années 30 : « La psychologie permet de tout comprendre, même les coups de matraque. Mais cette psychologie-là, je ne veux pas la pratiquer. Je ne veux pas comprendre ces gens-là, je les rejette ». Oui, nous y sommes.