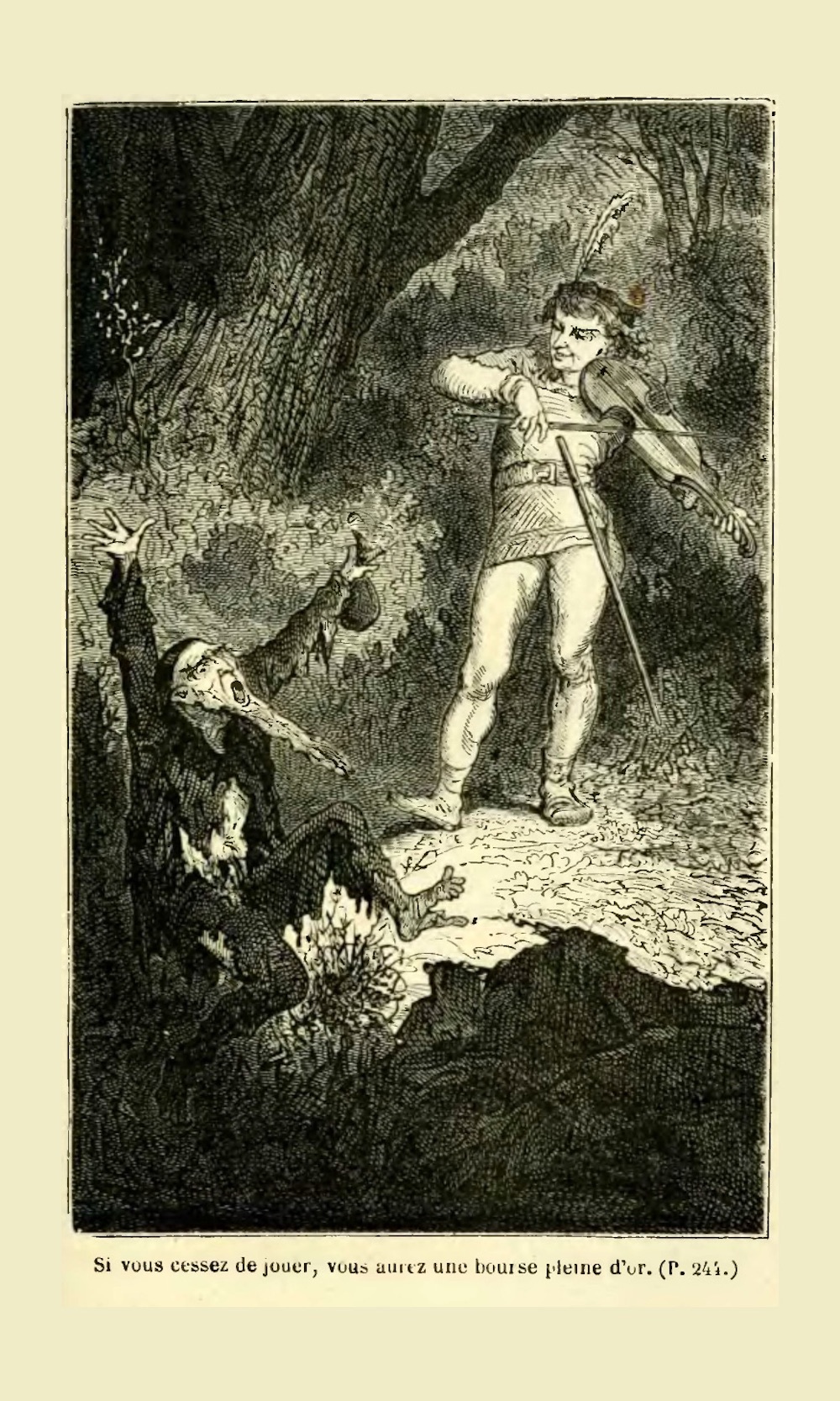Alberto Giacometti – Ghislain Uhry
Je voudrais me fixer comme devoir, pour un certain chant que j’écris, d’être, je viens de le noter dans mon cahier, « vrai et nécessaire comme l’optique de Giacometti ».
Et j’ai jeté ces mots sur le papier ; pour moi-même, et, j’espère, pour tel ami qui le lirait.
Ghislain Uhry m’a dit, il y a deux ans : « la peinture de Giacometti, elle a la couleur des montagnes des Grisons. Montagnes grises, brunes, où les plaines sont à deux mille mètres.
Ce qui est vrai dans Giacometti, ce n’est pas « l’expérience métaphysique » ; c’est Stampa. Stampa qui est la couleur de Giacometti. La poussière de son atelier, c’est la terre du village. L’optique diminuée, le « voir-tout-petit », c’est la faute de la montagne. C’est dans la montagne que l’on voit-tout-petits les hommes, en permanence. C’est dans la montagne que le sens de la grandeur devient comme un autre sens, superposable à la vision – parce que le géant cadre le regard.
Ici, je suis dans un café ; je vois ce plafond jaune, et, au fond, cette vitrine. Mon regard, alors, est un regard est qui n’a pas de haut plus haut que trois mètres, de long plus long que vingt mètres… le plafond opacifie, limite, écrase le regard.
Du coup, ce regard s’excitera, vivra, littéralement, dans la contemplation de ce bois nervuré, en lignes parallèles, dont on a fait la table ; de ce tissu jaune et rouge aux deux matières, l’une lisse, et râpeuse – du lin – , l’autre en reliefs, en festons, et douce, sans doute – des fils de soie – . Regardant-là, je serai vrillé, vissé aux chatoiements des couleurs et des matières ; cet œil-là, je l’appelle l’œil culturel.
Puis vient Giacometti. Genet : face aux choses, il voit absolument la chose comme chose, la solitude, le silence de la chose .
Ou encore : une poule s’assied, et naît une déesse (je paraphrase, je ne cite pas).
Etranges, au fond, ces déclarations qu’il a faites aux uns et aux autres, gentiment docile avec les intellectuels : « je peins le visible » ; « je veux faire une grande sculpture, mais je n’y peux rien, ça s’impose à moi, elle rétrécit, elle rétrécit… » Disons le mot, plutôt qu’étrange : factice, à entendre comme tel ; choquant, tout de même, ce mot. Mais dit. Le factice, c’est que Giacometti nous apparaît là moitié comme un professeur de philosophie, moitié comme un acteur un peu farfelu ; soit comme un de ces hommes (il en existe à chaque génération) qui a investi, comme occupation, de se « vouer à l’essentiel » – tandis que les autres, tant pis pour eux s’ils ne l’ont pas choisi, sont dans l’accessoire, le culturel, le conjoncturel ; soit comme un de ces « savants fous » qui veut tenter une expérience (ah la dette de ces expérimentateurs à la science, c’est à dire au scientisme ; sombre, maudite dette, pour eux qui se revendiquent de la pureté, la noblesse, l’absolu !) ; expérience de la phénoménologie elle-même : dire le regard comme sujet, et non comme regard-objet, si j’ose le raccourci du néologisme barbare.
Expérience philosophique, donc, ou pensée ascétique, ténue jusqu’à l’extrême : ce Giacometti-là, qui voit une déesse dans une poule, a fait de l’essentiel son attitude – une telle lecture de son œuvre, c’est, quoique pénétré de respect, faire injure à Giacometti. Non qu’il ait dû traduire autrement ce qu’il vivait ; non qu’il ait dit autre chose que ce qu’on rapporte.
Mais ce qu’on ne dit pas, avant que ce soit le non-dit, ou le déni, que les docteurs de l’âme me pardonnent, ce qu’on ne dit pas, c’est le cadre de ce qu’on dit, ou, plutôt, le cadre où l’on dit. Car le cadre de ce qu’on dit, c’est exactement le cadre de ce qu’on voit. C’est le nature de l’œil. Voilà.
Et ce sont de ces yeux habitués aux cafés, de ces pensées habituées aux cafés – les yeux de Sartre, pour en dire le paradigme – qui voient dans Giacometti le philosophe qu’il n’est pas ; d’autres, l’homme essentiel qu’il n’est pas, l’ascète qu’il n’est pas.
Car Giacometti a un autre œil, c’est l’œil de Stampa. L’œil naturel. Non, je n’aime pas ce mot. Je déteste le mot de nature. Mot hypocrite, puisque la « nature » l’est : chacun sait ce qu’il y a de mollement animal (pour parler la langue d’Aristote) à revenir à la nature ; et que le problème de l’homme, c’est l’homme – et si, ce qu’on appelait nature, en fait, au prix d’un changement de nom : comme Monde, – peut-être, un problème pour l’homme, problème que le mot même de nature aurait recouvert ; que la langue peut être maligne, tout de même… Cette langue, en tous cas : il en est où le mot de nature n’existe pas !…Bref, disons plutôt : l’œil qui a les montagnes pour objet, et pour cadre. L’œil des montagnes, provisoirement.
L’œil qui a pour objet la saisie immédiate d’un millier d’arbres, d’un million de branches ; l’œil qui a pour objet le tissu, la fourrure des arbres sur la pente ; l’œil qui a pour objet la montagne comme un seul tissu, exactement comme mon œil, là, a pour objet le tissu alterné de bandes jaunes et rouges.
Et quand on a le géant pour objet, tout ce qui n’est pas présence de ce géant – tout est petit ! On est hanté par le géant, et, réciproquement, hanté par le petit. S’il a vu cette tête petite, c’est qu’il l’a vue dans un cadre où sont des poussières qui font les foins, autour de soi ; ou bien, tout là-haut là-haut, d’autres poussières, qu’on appelle encore des hommes – ces idiots qui veulent « conquérir le sommet ». J’invente, bien sûr.
Ce que je veux dire, alors, c’est qu’en vérité Giacometti est absolument aussi complexe que tout un chacun parmi les peintres, ni plus ni moins – ce que veut dire ce mot de complexe, c’est que ce n’est absolument pas dans le dénuement du discours théorique qu’il se trouve, dénuement censé être une espèce de paradis perdu, d’archaïsme retrouvé par un seul qui, en gros, serait redevenu un égyptien du 9e siècle (je cite ici la meilleure version ; l’autre, le torturé, est morte avec l’existentialisme).
Aussi complexe, aussi vivant, aussi peu mort que possible – car mort, cela veut dire : « qui se ramène à l’objet qu’il est ». Car Giacometti ne peint pas des choses, finalement. Non. Giacometti ne peint pas le silence des choses. Non.
Ce qu’il voit, Giacometti, alors ? Il voit Stampa.
Giacometti n’est pas non plus un sculpteur de statues.
Giacometti n’est pas un peintre d’objets.
Giacometti est un peintre de paysages.
Giacometti est un sculpteur de paysages.
Le complément du nom : être ceci de cela. Peintre de : il faut entendre de comme possédé par ; la propriété de. Ce qui possède un artiste, voilà ce qu’il est ; ce qui possède Giacometti, c’est Stampa.
Ce qu’il peint, c’est le paysage de Stampa ; cette tête de Genet, toute petite et toute ronde, et toute dure : ce qu’elle résiste, tout de même, dans le paysage de Stampa ! Ce qu’ils peinent à la réduire, les piliers de 3000 mètres, dans cet œil de Stampa !
Car c’est cela que la réduction ; c’est la puissance, c’est la violence du paysage qui s’exerce sur un peintre, qui persiste à vouloir regarder quelque chose qui vit à son échelle, échelle dans le temps, échelle dans l’espace.
Voilà pourquoi Giacometti peint Diego et Annette, obstinément. Ce sont deux habitants de son village.
Devenir le modèle de Giacometti, c’est devenir un habitant de Stampa. Car c’est ça, un village : un village, c’est un vivre dans lequel rien de nouveau n’apparaît. C’est un œil qui montre toujours le même chose. C’est le contraire de la ville, où l’on ne voit jamais la même chose.
Et bien là, reste qu’ils restent, justement. Qu’ils tiennent le coup, qu’ils tiennent, dans le cadre.
Ils méritent de tenir.
Quant à l’élongation-rétrécissement, dans la sculpture, n’est-ce pas la même chose ? Car dans le cadre, si, ce qu’on éprouve, c’est moins la hauteur que la largeur, alors, à nouveau, alors que le familier, le regardé, le scruté est là, le cadre s’élargit démesurément, montagne, montagne ! entraînant jusqu’au vertige l’amaigrissement des figures.
Dans tous les cas : ça reste ; des hommes, là, dans le quotidien de Stampa. Oserai-je hasarder que le retour régulier à Stampa, c’est le maintien du cadre immense ? Ça demeure, comme une tête, comme un regard.
Autrement dit, ce paysage nous permet de vivre ; nous donne la permission ; nous autorise à vivre. Autorise Diego, et Annette, et ce japonais, et Genet, à rester là, à tenir là. Sans doute, ce qui avait aidé Annette à devenir habitante de l’œil-village, c’était son prénom, et puis elle était suisse, tout de même. Elle avait été agréée par le cadre.
Cela ne voulait pas dire qu’elle était digne de vivre. Cela voulait dire qu’il pouvait vivre avec eux, dans le regard, en maintenant son cadre.
Je fais un pas : cela voulait dire qu’il pouvait rester, avec eux sous le nez, avec eux dans les yeux, dans son grand, dans son long, dans son interminable oeil du monde. Attention, j’ai dit monde. Dans monde, il y a les montagnes, mais il y a le temps aussi, il y a la vie. Dans monde, il y a Dieu. Ne tremblez pas, vous ne savez pas ce que c’est.
Quant à Giacometti : quand on a les montagnes pour objet et qu’on habite un village, on ne dit pas Dieu.
Ce que ce mot dit, pour de vrai, n’est pas venu jusqu’aux montagnes. Ce mot n’a pas escaladé ces montagnes.
Alors oui, Giacometti avait quelque chose de décalé, d’anachronique : à Paris, ville encore de la vie multiple, multiforme, chatoyante de la culture, Giacometti était un habitant de Stampa. Un villageois. Voilà pourquoi les tarés du quartier l’amusaient plus que les mondains d’un peu plus loin. Les crétins des Alpes.
Décalé, oui, mais, ai-je dit : complexe. Pour marteler : moderne. Mais à mon tour, après Genet, de redéfinir. Complexe, parce que, ni plus ni moins que pour tout homme, il faut savoir si ce qu’il a fait est vrai. A-t-il raison, de les voir tenir dans le cadre ? Ce qu’il voit, ce qu’il vit, cela tient-il bien dans le cadre ? Cette question, qui appelle la réponse du monde, il faut non pas un dieu, ni même le bon dieu qui ne l’est qu’à titre de métaphore ; non, il faudrait la toute-vérité même pour y répondre. Alors, vous voulez que je vous dise ? Si ce qu’il a fait, Giacometti, tenir dans son cadre, ce sont des hommes : alors il a réussi. Mais si ce sont des déesses, Monsieur Genet, si ce sont des déesses, alors il s’est planté. Vous savez bien pourquoi : une déesse, c’est une idole ; et une idole, ça ne tient pas dans le cadre. Le cadre n’est pas fait elle. Le monde est fait pour l’homme, pas pour l’idole. Voilà pour le complexe.
Et moderne, parce que moderne, non, ce n’est pas éternel, non, ce n’est pas intemporel ; moderne, cela veut dire : c’est difficile ; ou plutôt : « ça se demande ». Giacometti se demande s’ils sont là, s’ils tiennent. Imaginez-vous un paysan de Stampa, au 16e siècle, qui se demande ? S’il tient dans le cadre ? Non. Il a trop à faire. Trop à déboiser. Mais maintenant c’est fait, sacrément. On a bien déboisé. Ça veut dire d’ailleurs finalement que tout moderne, tout angoissé, tout désespéré qu’on soit, on s’est rapproché du monde ! Qu’on se réjouisse !
Mais aussi, Moderne, ça veut dire qu’on sent très fortement le passé, et plus du tout de futur.
Ghislain Uhry, lui, qui peint aussi longtemps que Giacometti, lui est un habitant des villes. Villes nombreuses ; villes lourdes d’événements ; villes brillantes et inquiètes, chargées d’une lumière cramoisie ; celle de toutes les fins, car Dieu sait que l’ultime est précédée de combien d’autres petites fins ! Ce sont ces villes, froides, mitteleuropéennes au fond, et parisiennes en surface, que lui ont légué ses passés. Quand ce sont de ces villes qu’on hérite, savez-vous ce dont, finalement, on se découvre avoir hérité ? Je vous réponds : le drame humain. Le drame de l’Histoire, dirait-on ; mais si je choisissais cette formule, je voudrais qu’on accentue drame, et qu’on laisse, pour Histoire, beaucoup de ténèbres qui n’enveloppe de lumière que cachée, que réservée. Pour plus tard.
Et Ghislain Uhry peint des paysages. Des cimetières juifs ; un saut du chevreuil ; un lac de Thoune ; un jardin angevin ; et maintenant, des montagnes, des montagnes des Grisons ; les montagnes de Stampa.
Alors je vais finir de rêver en refaisant une rencontre entre un ami que je connais et un autre qui ne m’a même pas vu naître.
Car Ghislain Uhry, non plus, n’est pas ce qu’il est ; Ghislain Uhry, lui aussi, est un peintre de son œil ; car il ne peint pas des paysages, non ; il est un peintre de portraits.
Il a le drame humain comme cadre ; et il regarde, il tente, toile après toile, année après année, de voir si le drame humain, ça veut bien le monde. Et si le monde tient, oui, tient, là, dans l’homme, tapi dans l’œil si lourd de souvenir, si lourd de mémoires, si lourd d’atavisme et de bilan, du peintre. Il tient, le jardin ; il tient, le lac ; il tient, le cirque de montagnes. « Ecoutez, vous les quelques-uns qui regardez ; écoutez ce que vous regardez ; ça vous dit que, toute poussière, toute crasse que soyez pour vous-même, je vous dit que ça tient. »
Au-dessus de moi, j’ai le paysage des Grisons. Un ciel blanc, chargé. Des montagnes, et une plaine, bleues, d’un vert éteint, et brunes ; des couleurs… comment dire ? Et des gestes, comment dire ? Pas du tout ceux de Giacometti, non ; mais pourtant, des gestes qui se demandent, comme les siens, encore ; des gestes qui se souviennent, comme les siens ; des gestes-frères, en quelque sorte, de ceux de Giacometti. Et l’on dira encore : des gestes modernes.
Tout de même, ce gris, ce brun, toujours là depuis toujours chez Ghislain, et chez Giacometti ! D’où je vous écris, je pourrais dire que ces couleurs et ces lumières sont réservées.
Vous savez, ici en ville, non plus, le mot de tout à l’heure n’est pas arrivé ; mais ce n’est pas l’escalade, ici, le problème. Le problème, c’est le bruit. L’angoisse fait trop de bruit, en ville, et encore quelques petites choses. Où l’on parle de Dieu, c’est à dire dans un minuscule abri ténébreux où marchent les méninges et les intelligences à un rythme d’enfer, on dit ceci : on dit que la lumière a été réservée pour les justes. Gardée, intacte. Et donc, cette lumière par excellence, non vue. Inviolée. Réservée.
Ont-ils raison, ont-ils tort, Giacometti et Ghislain ? Ont-ils bien vu que ça tenait, ou bien se sont-ils trompés ? Peut-être que ce jour-là, on verra, dans la réserve des teintes de leurs toiles, un peu de lumière qui dira qu’ici, et ici, et ici, sur cette tête et dans cet arbre, ils ne se sont pas trompés.
J’aime bien cette idée sur la peinture : la peinture, c’est dire avec la main que ça tient, dans le regard. C’est pour ça qu’on déteste la peinture, maintenant ; même les marchands, d’ailleurs. Parce qu’on est tellement moderne qu’on est absolument persuadé que ça ne tient pas du tout. Que ça ne doit plus tenir.
Dire que ça tient. Pour dire, un peintre a une main. Car c’est la main qui parle. Et le poète, d’ailleurs ; qu’est-ce qu’il a d’autre, lui aussi, que sa main ?
Et le poète tenta de les saluer, sans plus les importuner de son bavardage, sous les grands sommets de Stampa, où l’œil du monde se tend.