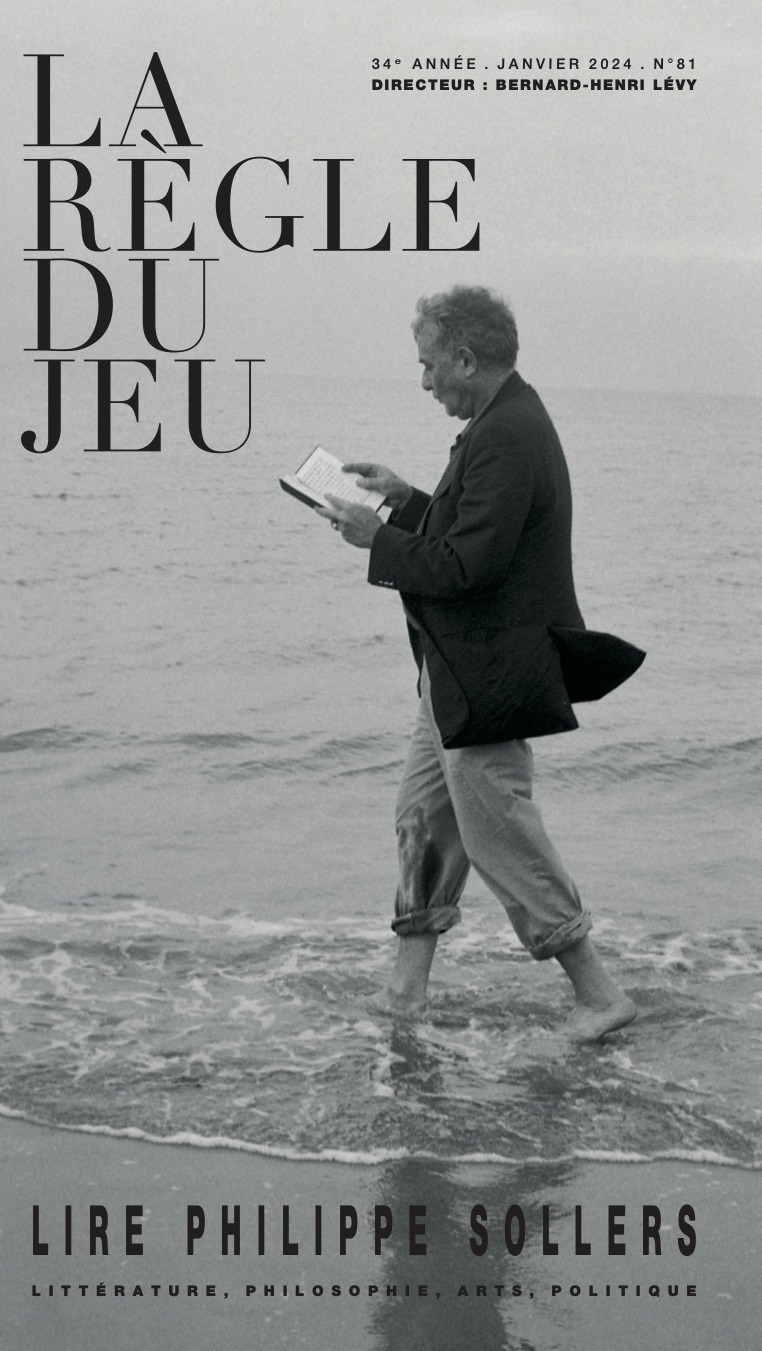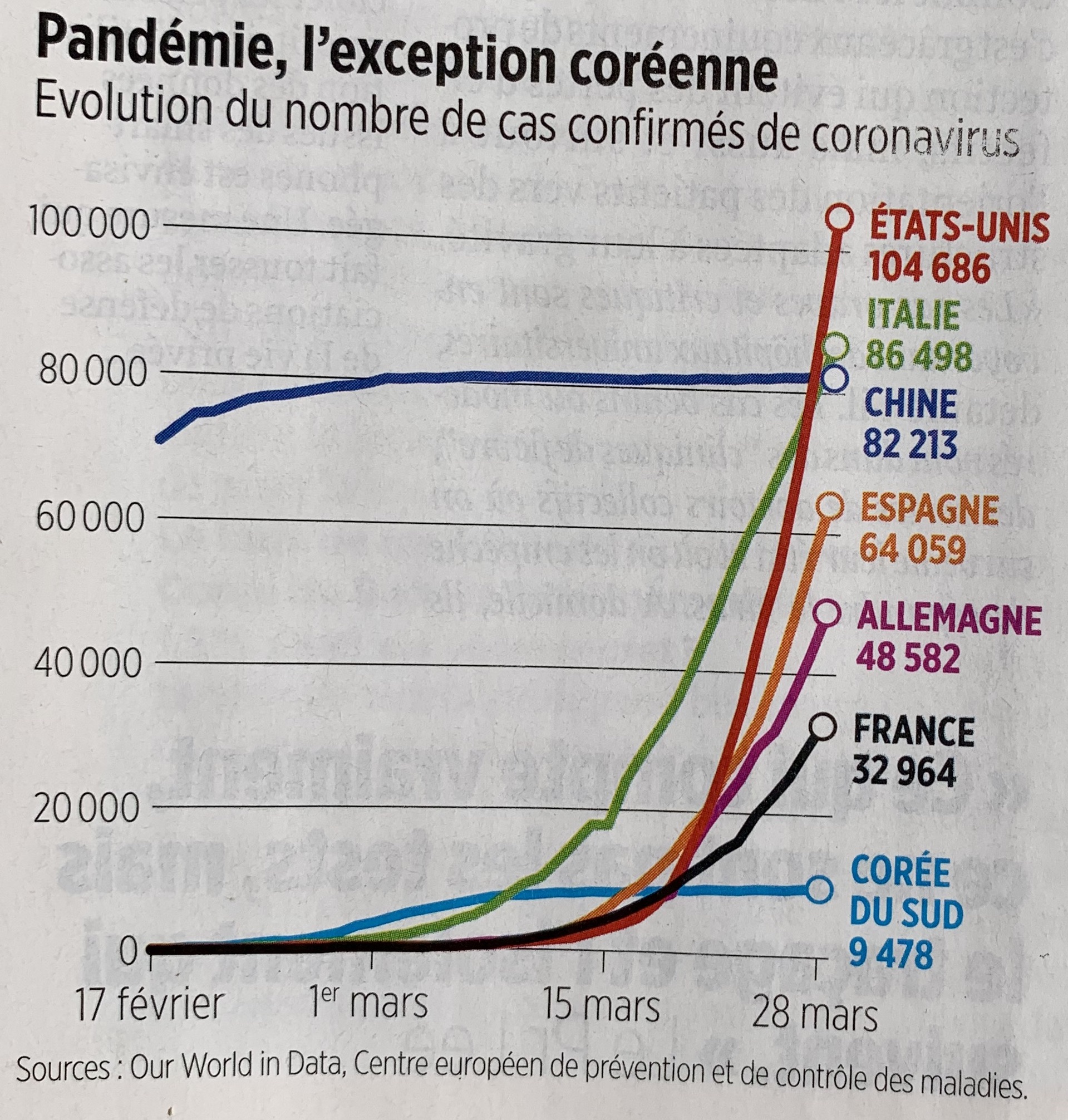« …avec quel talent cette farce grinçante, mordante et réjouissante.” Marie-Céline Nivière (Pariscope).
Lakis Proguidis (« L’atelier du roman » , Flammarion ) : » Comme l’esprit général est dominé par les va-t-en-guerre, nous sommes allés voir samedi la pièce « Pique-nique en campagne »; question de respirer un peu… Et nous sommes sortis largement récompensés! .
________________________________
« L’ATLANTIDE ENGLOUTIE DE L’ESTHÉTIQUE »
Lakis Proguidis
Intervention récente dans un colloque de la Sorbonne sur « la pensée sur l’art »
Avant d’entrer dans le vif du sujet je dois expliquer un peu mon titre.
Que l’esthétique comme science du beau ou comme philosophie de l’art ait disparu du champ de nos intérêts est un fait difficile à contester. Il suffit de nous rappeler la quasi disparition des départements universitaires qui portaient encore ce nom il y a à peine un demi-siècle. L’époque où des ouvrages tels que L’Esthétique comme science de l’expression de Benedetto Croce (1922) ou Philosophie des formes symboliques d’Ernst Cassirer (1953) se discutaient largement est bien lointaine. Le rideau me semble être tombé sur ce domaine du savoir en 1966 avec le livre de Monroe Beardsley Aesthetics : From Classical Greece to the Present. De la Grèce classique à nos jours… certainement l’auteur n’aurait pas pu imaginer qu’il avait écrit l’histoire de quelque chose qui n’avait plus d’avenir.
Si nous sommes d’accord – j’y reviendrai – que par le terme esthétique nous ne désignons pas la simple réflexion sur l’œuvre d’art, mais aussi, et surtout, la sensation objectivable, la sensation qui transcende les expériences partielles, la sensation qui totalise les sensations individuelles, oui, si nous comprenons encore le mot dans son sens original qui, selon le grec, veut dire s’occuper des cinq sens et simultanément les contempler du dehors, force est d’admettre que l’esthétique n’est pas seule à quitter notre monde. La même sorte d’éclipse concerne aussi la philosophie totalisante, je veux dire des grands systèmes de l’esprit destinés à embrasser et à expliquer le monde que notre civilisation a connu depuis les présocratiques jusqu’au milieu du XXe siècle.
Je n’ai rien contre la philosophie analytique, seule désormais à occuper le terrain où hier encore s’affrontaient les grands systèmes philosophiques. Le problème est la pensée unique. Tous nos efforts pour stimuler le multiple, toutes nos déclarations sur la diversité, tous nos discours en faveur de l’Autre, toutes nos tentatives pour faire dialoguer les différentes disciplines et les différents milieux sociaux, toutes nos initiatives pour imposer le pluriel dans tous les mots clés de notre civilisation – on ne parle plus de liberté mais des libertés, on ne parle plus du savoir mais des savoirs, on ne parle plus du beau mais des beautés, etc., oui, tous ces comportements à première vue dus au respect et à la défense de la pluralité des mondes, cachent notre incapacité désormais endémique à nous extraire du monde, à le penser dans son ensemble et, par conséquent, à dialoguer à partir de visions différentes, voire opposées.
Peut-être aimerait-on voir dans cette évolution non pas le triomphe du monologisme mais la victoire définitive du principe d’immanence contre celui de transcendance. C’est un leurre. Car, en fait, ce qui l’a emporté, sournoisement, ce n’est pas le principe philosophique de l’immanence mais l’immanence du monde même tel qu’il est et tel qu’il se répétera à l’infini. Pour ce faire, on a déclaré caduque, inopérante, la lutte incessante depuis l’aube des temps de ces deux principes antagonistes. Ce qui a gagné alors c’est l’idée que c’est à la pensée et à l’imagination de s’adapter au monde tel qu’il est et non l’inverse. Nous risquons ainsi, à long terme, d’être privés du désir, désir à mon avis proprement humain, de nous entretenir avec une totalité qui nous dépasse, qui transcende notre situation particulière, tant sur le plan individuel que collectif.
Que la réflexion sur l’art se limite à l’inventaire et au commentaire des prouesses formelles n’a dès lors rien d’étonnant. On constate et on analyse. Au mieux, on scrute les tendances dites actuelles. La pensée sur l’art se compartimente et, forcément, on fait appel aux experts former pour mener à bien ce travail-là. En philosophie c’est pareil. Que faire ? C’est si vaste l’objet, j’entends l’objection. Non, pas du tout. Encore un leurre d’autopersuasion, d’autojustification. Ce n’est pas l’objet qui est vaste. C’est nous qui l’avons fait tel. C’est nous qui l’avons morcelé.
Et l’Atlantide, pourquoi figure-t-elle dans le titre ? Est-ce pour teindre mes propos du sentiment de nostalgie ? Ce pourrait être le cas. S’agissant de la disparition de l’esthétique on a toutes les raisons du monde pour devenir nostalgique. Mais non, ce n’est pas le cas. L’Atlantide est ici comme un appel à effectuer un grand saut en arrière dans le temps, à revenir aux débuts de notre civilisation. Avec l’idée, bien entendu, que ce retour n’est pas sans rapport avec le sujet de ce colloque.
Pour commencer, regardons du côté de Platon qui, dans un de ses derniers dialogues, Critias, a inventé le mythe de l’Atlantide. Il était une fois, dit-il, sur une île qui se trouvait de l’autre côté des colonnes d’Héraclès, c’est-à-dire dans l’océan, une cité idéale, heureuse, prospère et pacifique. Ses habitants descendaient de l’accouplement de Poséidon avec une belle mortelle. Ils se gouvernaient par des lois justes et parfaites établies par le dieu en personne. Mais l’idylle n’a duré que quelques générations. Avec le temps, le dégradation a pris le dessus dans tous les domaines de la vie. Zeus, alors, saisi d’une colère incommensurable, a précipité l’île entière au fin fond de l’océan. Quant à l’énigme de la dégradation même, Platon dit qu’elle s’explique par le fait qu’au départ le sang divin a été mélangé avec le sang humain. Une telle union ne pourrait, selon le philosophe, qu’aller vers le bas. Mais il reste quand même, semble vouloir dire Platon, le souvenir de la splendide cité qui transmis de génération en génération gardera vivante auprès des mortels la nostalgie de l’œuvre divine.
La description détaillée de cette cité fantastique entreprise par Platon m’a fait penser à une autre description, d’une autre œuvre divine, à savoir celle que fait Homère du bouclier d’Achille dans L’Iliade, œuvre du dieu Héphaistos. Un monde entier y est représenté. Un monde où coexistent la paix et la guerre, la fête et le deuil, les quatre saisons, l’univers céleste et les travaux domestiques. Ce monde ne se dégrade pas comme celui de l’Atlantide de Platon. Il se répète. Il est cyclique et éternel. Ce qui explique peut-être l’animosité du philosophe envers le poète. Platon trouver probablement inadmissible cette neutralité, cette description pour la description, cet artifice langagier dépourvu de moralité, cette absence de la part d’Homère de jugement de valeur morale eu égard au monde représenté sur le bouclier. Platon a été parfaitement conséquent avec son échelle des valeurs. Il croyait que l’homme bon devait se détourner des distractions mimétiques pour se consacrer à la contemplation des idées impérissables.
Cependant il me semble que si ce mentor de la réminiscence que fut Platon s’arrêtait vraiment sur le fragment de L’Iliade dédié au bouclier d’Achille et méditait les mots utilisés, un par un, non seulement il comprendrait la raison d’être de la poésie, mais il se souviendrait aussi de l’origine de sa propre discipline. Parce que Homère ne se contente pas de la description. Certes, il n’émet pas un jugement moral. Mais il émet un jugement quand même. Il introduit dans le poème son appréciation sur l’ouvrage en question. Il dit que ce qu’a fait Héphaistos est « thaumastos » (θαυμαστός), merveilleux. Historiquement parlant, il s’agit du premier jugement esthétique et, du coup, de la fondation de l’esthétique comme nouvelle branche du savoir. Et l’affaire ne s’arrête pas là. Quelques trois siècles avant Platon, Homère fixe le mot d’où jaillira tout l’édifice de la philosophie grecque : émerveillement, s’émerveiller, c’est cela la philosophie disaient les Grecs.
La Grèce n’a pas inventé l’art. L’art est ontologiquement lié à la notion de l’homme. La Grèce a inventé l’autonomie de l’art, la faculté de l’art de se regarder et de se prendre comme objet de jugement à partir de ses propres critères. Critères qui, manifestement, n’ont rien de commun avec l’économie du vivant. Quel intérêt aurait pu présenter pour la vie le fait de s’émerveiller devant une œuvre ou un objet de la nature ou un quelconque événement ? Probablement aucun. Mais depuis Homère nous avons la preuve poétique qu’il existe chez l’homme un ordre du sensible déviant par rapport aux lois de la nature, un ordre qui gratifie l’homme de la dimension du créateur.
Maintenant j’aimerai faire trois remarques qui serviront de lien entre ce fonds homérico-platonicien et notre sujet.
1) Quand Homère compose son chant, il sait qu’il le fait dans une langue précise et qu’il s’adresse à un peuple précis. Il est l’auteur. Ou le coauteur ou la voix collective des aèdes, peu importe. En tout cas, qui qu’il soit, il n’annonce pas que le travail d’Héphaistos est merveilleux parce qu’il lui plaît personnellement. Il argumente. Il expose les raisons de son appréciation. L’attribut du merveilleux est le résultat de son analyse esthétique, dirions-nous aujourd’hui, et pas de ses préférences. Et le public, comment réagira-t-il ? Mais le public est forcément impliqué dans la même manière de voir les choses. Ce n’est pas son appartenance ethnique ou par le fait qu’il parle la langue du poète qu’il partagera son jugement. Il adhère au raisonnement critique. Ce bouclier est objectivement merveilleux pour les Grecs, pour les Perses, pour nous lecteurs d’aujourd’hui et pour tout homme où qu’il se trouve sur cette planète et ceci jusqu’à la fin des temps. Autrement dit, l’esthétique n’a de sens que dans la mesure où elle œuvre en faveur du dépassement des conditions, de toutes les conditions, qui ont contribué à la gestation de l’œuvre dite artistique et bien entendu au dépassement des intérêts, de tous les intérêts des destinataires.
Devant l’œuvre d’Héphaistos on ne s’émerveille pas parce qu’on appartient à tel ou tel groupe à l’identité définie mais parce qu’on est homme. Ce qui n’empêchera certainement pas ces groupes-là – et de nos jours ils sont légion – de vouloir avoir leur art propre exclusivement à eux. Mais cet art identificatoire a selon le vocabulaire de l’esthétique un nom. Il s’appelle le kitsch.
Il est vrai que ces derniers temps on n’entend pas beaucoup ce mot. Mais ceci explique cela. On ne l’entend pas parce que la voix de l’esthétique est éteinte. Le kitsch est l’accord catégorique avec l’être, disait Kundera. Comprenons alors l’esthétique comme la mise en distance de ce qui est là, comme un dépassement du même. Et ce n’est pas avec la segmentation en menus morceaux de ce qui est, action dans laquelle excelle notre monde, qu’on créera la distance exigée par l’esthétique. Un kitsch ou plusieurs kitschs, c’est du pareil au même.
2) La description du bouclier d’Achille dans L’Iliade s’étale sur une centaine de vers. Parfois Homère parle avec admiration de la dextérité d’Héphaistos manipuler ses outils de travail. Mais jamais il n’attribue la valeur esthétique du résultat à sa qualité de dieu. En revanche, chez Platon les premières lois d’Atlantide étaient parfaites parce qu’elles étaient divines. Chez Homère c’est seulement l’ouvrage qui est pris en considération. Ici l’artiste parle d’égal à égal de ce qui est sorti de l’atelier de son confrère.
Dès l’aube alors de notre littérature l’artiste inclut au sein de son œuvre la réflexion sur une autre œuvre d’art. Pourquoi ? Quel est le sens de ce geste ? Vu d’aujourd’hui il me semble qu’Homère veut dire deux choses. Premièrement, que l’œuvre d’art n’est jamais seule, n’est jamais une Atlantide, n’est jamais isolée des autres œuvres d’art. Deuxièmement, que c’est de l’œuvre d’art même que jaillit le désir de la tradition, de la comparaison et de la pensée sur le beau. L’art n’avance pas. Il apparaît. Mais pour voir la nouveauté réalisée dans une œuvre particulière, il faut aussi suivre le dialogue que l’art en question entretient avec lui-même, avec les autres arts et avec la tradition en général, en deux mots, il faut être esthétiquement éduqué.
Je ne sais pas comment cela se passe pour les autres arts. Mais d’après ce que je sais à propos de l’esthétique romanesque, il me semble que l’ouverture de plus en plus manifeste de l’art du roman vers les autres grandes formes, ici en France, par exemple, vers la peinture – je pense à Claude Simon –, ailleurs vers la poésie, la musique, le mythe, etc., ne s’explique pas seulement par sa capacité innée à les embrasser toutes. Il y a aussi autre chose. Je pense qu’en conditions d’apesanteur esthétique, en absence de cette activité autonome de l’esprit et de l’imagination, le roman reprend à son compte et selon ses moyens d’expression le geste homérique. Car ce qui est en jeu dorénavant ce n’est pas l’existence de l’œuvre d’art – tant qu’il y aura des hommes, il y aura création –, mais la survie du dialogue esthétique, dialogue, pour notre civilisation, consubstantiel à l’expérience artistique. Par conséquent, plus ce dialogue fera défaut dans le monde disons extérieur, plus le roman aura tendance à le faire émerger de son for intérieur en prenant souvent appui sur les autres arts.
3) J’en reviens au mythe platonicien. À partir du moment, dit Platon, où l’admirable cité a été fondée grâce à l’accouplement d’un dieu avec un homme, le désastre était inéluctable. Quand l’être supérieur, pense-t-il, est attiré par un être inférieur, le monde qui en résultera, quoique splendide et prometteur au départ, ne peut que péricliter. Mais cette logique de la dégradation continue jusqu’à la chute finale ne concerne pas l’art, semble répondre Homère.
Primo, parce que chaque réalisation artistique est portée au monde, et par la suite soutenue, par l’ensemble de la création.
Secundo, parce que dans chaque œuvre artistique le glorieux passé ne surgit pas comme une réminiscence mais comme un interlocuteur toujours vivant.
Et, tertio, parce que l’émerveillement est hors temps.
Cependant, je ne crois pas que Platon ait tort. Sinon il fallait conclure que la philosophie totalisante a fait son chemin. Ce qui est d’ailleurs le cas, comme je disais au début. Mais les textes sont là, comme un défi permanent.
Depuis trois, quatre siècles l’homme est séduit par la machine et il espère que son accouplement avec elle fera naître un monde éternellement radieux, éternellement prospère et éternellement jeune. Tu fonces droit dans le mur, le prévient Platon depuis son IVe siècle avant notre ère. Car dans les accouplements de ce genre c’est toujours la condition première de l’être inférieur qui l’emporte. Dans l’Atlantide mythique, c’était l’imperfection humaine. Dans l’Atlantide moderne ce sera l’efficacité machinale. À cette précision près, que, aux temps d’Homère et de Platon, l’émerveillement faisait sens, c’est-à-dire structurait l’imaginaire humain. Aujourd’hui, d’après tous les indices dont on dispose, seul l’art semble vouloir s’opposer à la dégradation du monde qu’impose l’efficacité de la machine, et rester fidèle au geste fondateur d’Homère. Et apparemment, sans soutien esthétique « extérieur », il est dorénavant obligé de se faire à la fois bouclier bien fait et observateur émerveillé.