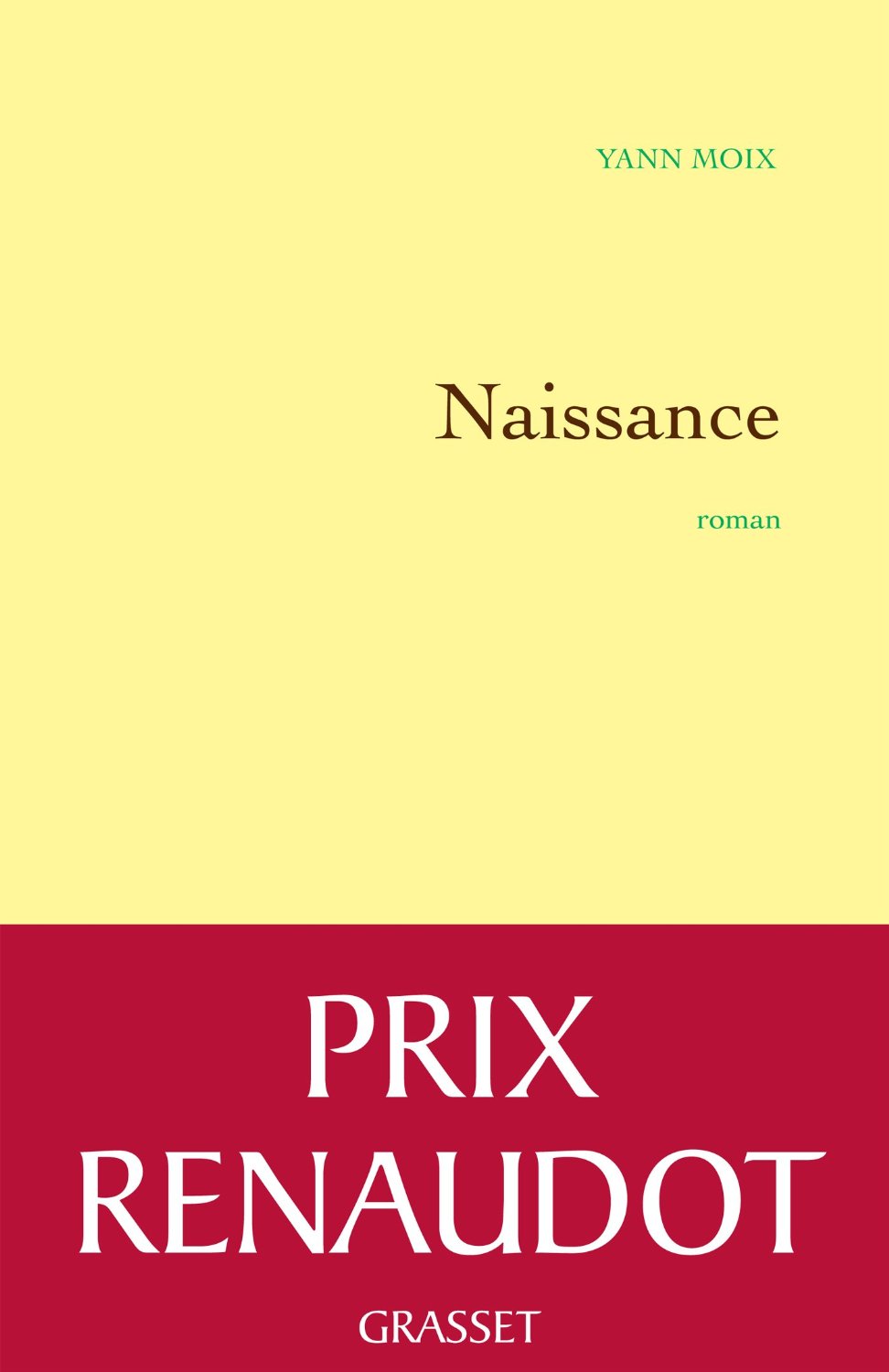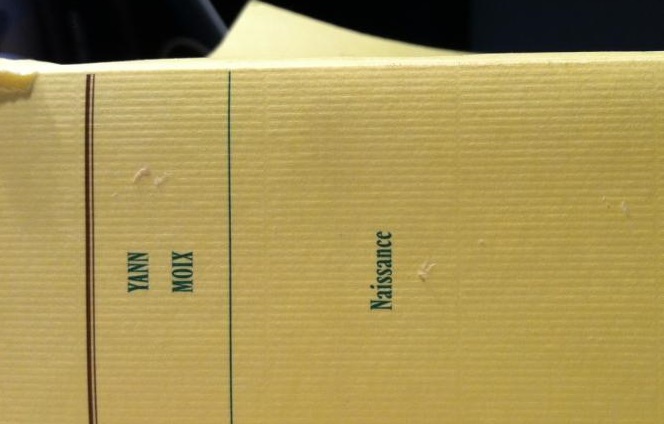La « Montagne Magique » raconte cette histoire simple et improbable d’un homme, Hans Castorp, qui, venant rendre une visite courte et polie à son cousin Joachim prisonnier de sa santé et d’un sanatorium devant remédier aux défaillances de cette dernière, finit, de rallonge en rallonge, de délais en délais, par passer dans cette résidence alpine où le thé se prend à cinq heures et la température à huit, pas moins de sept longues années ennuyeuses et invisibles, avant de sortir, pas plus guéri ou malade qu’il n’était avant d’y rentrer, pour aller aussitôt se faire tirer dessus, brave et résigné, sur le front de la première guerre mondiale. « La Montagne Magique » raconte ce phénomène étrange et fascinant, avec cette sorte d’ironie douce et de tendresse sarcastique que possède en propre Thomas Mann, ce phénomène qui nous fait, par lâcheté et oubli, perdre toute notion du temps ; c’est donc un livre sur l’ennui, la répétition, l’aveuglement volontaire de la conscience chronologique, où le héros se rend peu à peu compte de la différence entre temps senti et temps vécu, temps du cœur et temps des horloges, et où, au final, les séquences les plus roboratives de sa vie, les durées les plus imposantes selon les calendriers, tout cela fuit, se recroqueville, s’écoule en un instant, avant de s’embraser dans le feu d’une minute soudain, à elle seule, plus énorme que sept années passées en un souffle. Avec ce livre, Thomas Mann nous fait sentir une époque, un continent, une guerre ; mais bien plus, il vient de trouver la plus belle des métaphores pour expliquer ce qu’est, en somme, un roman, un chef d’œuvre, et tous les livres que nous aimons : une expérience d’oubli du temps, au fil des chapitres, un abandon de soi dans ces siècles indistincts, le roman digressant autant que progressant, avant de s’embraser, en un dénouement qui enflamme rétrospectivement le livre et nous oblige à le refermer, avec chagrin. Ce séjour de sept ans dont on ne voit rien passer, c’est celui d’Hans Castorp dans son sanatorium, c’est celui de tous les lecteurs du monde dans leur roman favori.
Autant dire, donc, que la lecture d’un roman a, forcément à voir avec la pause, la digression, la parenthèse, et que toute œuvre qui ne soit pas mue par cette impérieuse traction vers l’avant que constitue l’intrigue a non seulement droit de cité dans nos bibliothèques, mais encore au premier chef. Autant dire, finalement, que cet étrange procès en bavassage que l’on tente de faire à Yann Moix est non seulement hors-sujet, mais encore scandaleux.
Nul besoin ici de convoquer, à ce procès, des témoins de la défense parmi les plus éloquents qu’il soit. Je n’appellerai pas, à la barre, Milan Kundera, qui, dans « L’Immortalité », fait dire à son narrateur que « la tension dramatique est la véritable malédiction du roman parce qu’elle transforme tout, même les plus belles pages, même les scènes et les observations les plus surprenantes, en une simple étape menant au dénouement final » ; je laisserai au Panthéon Victor Hugo, défendant, contre son éditeur, les interminables digressions, dans les « Misérables », sur les égouts de Paris ou l’argot de la capitale ; oublions encore, sous peine de faire cuistre, le roman bordel d’Aragon (« le roman, terre d’élection de la parenthèse »), les réflexions de Thibaudet sur le lecteur consommateur et pressé opposé au vrai, à l’unique lecteur, le « liseur » qui déguste et s’attarde ; oublions enfin les pages innombrables de Julien Gracq, qui, expliquant la supériorité par lui conférée, de «La Chartreuse de Parme » sur « Madame Bovary », indiquait que de l’œuvre de Flaubert, il ne savait raconter que, précisément, la simple intrigue (un indice : elle meurt à la fin), tandis que, a contrario, de son cher Stendhal, il retenait tout, scènes de baiser et digressions, paysages et à-côtés, conversations et gambades, apostilles et paperolles, cette collection chérie de souvenirs épars de lecture ressemblant, pour lui, niché au rivage doux de sa mémoire, à un « jeu d’épaves sur la grève ». Eh bien l’on ne saurait dire mieux que cela : « Naissance » est un cimetière marin, d’épaves encombré, et, parmi les plus belles, même si cette anthologie sélective, au fil des mille pages, est un jeu idiot, citons, entre autres, un portrait de Marat, un résumé haletant et hallucinant du duel Giscard-Mitterrand de 1974, des correspondances absurdes avec Monsieur Vuitton pour obtenir, gratuitement, deux malles de voyage, un thé avec Gide, végétal et décadent, un aperçu de la carrière de l’écrivain Yann Moix lors de ses huit ans, (« J’ai 8 ans et mon rapport à la critique est alors excellent. « Avec Le Retour de Tût-Tut l’abeille, Yann Moix renoue avec la veine de ses premiers cahiers de brouillons » ; « A l’érudition et au style, le jeune Moix, 8 ans et toutes ses dents, mêle la jubilation et la tendresse. Il faut se précipiter sur Les Aventures de Carfadoul le Cafard. »). Il y a, dans « Naissance », après la huitième centaine de pages, une dizaine de paragraphes sur Faulkner pour lesquels, personnellement, je sacrifierais bien la moitié de la rentrée littéraire.
Est-ce à dire, pour autant, que « Naissance » est une collection de saillies géniales, ou de notes de bas de page et fantaisies de fin de chapitres ? Eh bien non, « Naissance » aurait pu être une sorte de compilations auto-citatives, d’essais au sens de Montaigne, un herbier des réflexions et bavasseries, un album de vacances pour burlesque virtuose, mais, comme tout roman qui se respecte, il a un sujet, bouleversant et assez terrifiant à la fois, dont aucun critique, tout occupé à souligner combien ce livre est trop gros et trop long, ne s’est apparemment aperçu. Liquidons, d’ailleurs, cette histoire de taille, ou de volume : faut-il que la littérature française soit à ce point d’anémie, à ce degré d’anorexie exsangue, de chic « la peau sur les os », faut-il que l’édition-de-minuisme, l’écriture blanche et translucide, l’élégance hussardière qui n’a d’équestre que ses gros sabots, faut-il que nous soyons arrivés à ce point de dégoût des romans, de haine de la vie et de crétinisme aristocratique pour râler, et ricaner, quand la rentrée littéraire nous offre, c’est le mot juste, un livre de mille pages ? Mais enfin, il y a cent cinquante ans, c’était une sorte de norme, un début de prérequit, dix centaines de pages ! Mille pages, c’était aussi sincèrement habituel, aussi tragiquement banal que les hauts de forme sur les boulevards, les trajets en calèche ou la petite vérole ! Mille pages, à l’époque, cela aurait tout juste fait bailler d’indifférence un des frères Goncourt, sans même réveiller l’autre. Et du reste, imagine-t-on la scène ?, songez, pour la plus grande honte de la critiquaillerie contemporaine, à Sainte-Beuve, ouvrant à son brave libraire, et le renvoyant aussitôt, indigné, lui jetant à la figure ses exemplaires des Illusions Perdues, trépignant sur son palier habillé d’une redingote, hurlant dans la cage d’escalier en piétinant son paillasson, mais enfin, mais comment donc, mais pourquoi cela, mille pages mais vous n’y pensez-pas ! De qui se moque-t-on ? Mille pages ? C’est un scandale, c’est une infamie, monsieur se moque, monsieur est grotesque, monsieur est une fieffée canaille !
Néanmoins, que ce livre soit très volumineux, exagérément encombrant, assez imposant, il faut le dire, tout cela possède une espèce d’importance, cela joue bien un rôle, mais pas au sens où on l’entend. Ce dont la critique aurait en effet pu s’aviser, ce qu’elle aurait pu noter, tout simplement en prenant le temps de réfléchir environ dix minutes et trente secondes, sans même, notons-le bien, avoir à ouvrir le livre, sans même, soulignons-ce point, lire une seule ligne, et ainsi, pour son plus grand bonheur, réaliser cet exploit bienvenu de formuler la remarque la plus pertinente qu’il soit sur « Naissance » sans même avoir à s’encombrer l’esprit de tous ces mots et ces phrases un peu, hum, fatigantes, la lecture de choses aussi peu civilisées endolorissant, c’est bien connu, le système nerveux et lymphatique, ce qu’aurait simplement, et en tout et pour tout, eu à faire la critique pour être, rien qu’une fois, perspicace, eh bien c’est de dire ceci : pour qu’un homme parle de sa propre naissance en donnant un livre en trop, un livre qui déborde, qui embarrasse, qui étouffe, qui pèse et gêne, qui obstrue et fatigue, si un homme fait cela, peut-être bien que cela a une raison, un sens, une fin artistique, celle de mimer, par l’objet le sujet, par le poids du livre le poids de la vie conférée justement par cette naissance, et de dire, avec ce livre énorme la haine de soi, le sentiment de se compter comme en trop, la carence d’un moi légitime, l’épouvantable désespoir d’être au monde. Ce livre, difforme et embarrassant, c’est ce bébé dont, atrocement, les parents ne veulent pas. C’est, ramassée, d’une manière saisissante et spécialement émouvante, la perception d’un enfant que l’on n’aime pas, au sujet duquel on voue une haine éternelle, et à qui l’on fait sentir qu’il doit se faire tout petit sous faute de s’en prendre une. Ecrire ces mille pages, ce n’était pas de l’ordre de l’exploit, du puéril, de la frime, mais tout simplement la réalisation d’une adéquation infiniment belle entre le fond et la forme : de la littérature.
Ainsi, le vrai sujet du livre, cette « Naissance » superfétatoire et absolument révoltante pour ses deux parents, sujet délicat et douloureux traité par là avec une justesse parfaite, ce sujet permet à Yann Moix de donner des pages qui, certes, parlent de lui, mais encore de vous et moi, avec une universalité bouleversante, tout en ayant cette élégance de faire drôle, grotesque et burlesque, pour ne pas tomber dans cet horizon indépassable du roman français contemporain : l’esprit de sérieux. Mais ne vous y trompez-pas : le ton a beau être celui de la pataphysique, les monologues du père (extraordinaire personnage) sont bien d’une insondable monstruosité ; les salons de l’enfance battue et les stages de martinet constituent, mais traités sur le mode absurde, un témoignage qui ne peut laisser indifférent. C’est cet aspect-là du livre, le côté « Albatros, ses ailes de géant… », qu’il n’est pas interdit de préférer. « Une fois que nous t’aurons détruit par les névroses qui nous ont détruit nous-mêmes » disent les parents, ce à quoi un autre répond : « L’analyse sert à cela, tu verras : pardonner à ses parents pour s’en vouloir à soi-même ». Egocentrique, Yann Moix ? Non, hypocrite lecteur, comme disait l’autre. Ce livre, ce sont des circumfessions, extrêmement hilarantes, à propos de choses qui ne le sont pas.
On peut, certes, avoir des réserves, sur quelques passages où parle le Yann Moix contemporain, soudain plus grave, étonnamment moins fou ; on peut aussi estimer que « Naissance » n’est pas encore le meilleur livre de Yann Moix, qui, à vrai dire est une sorte de génie, disons-le, tant l’on est impressionné et fasciné par cette science des mots pour lui transparents, cette démiurgie en matière de poésie, de lecture, de perspicacité quant aux personnages et aux sentiments, tant l’on reste saisi par sa puissance littéraire et son art du vocabulaire, sa virtuosité épique pour écrire à peu près n’importe quoi, poèmes, descriptions ou listes infinies. Oui, on peut se dire qu’après Naissance, cet écrivain aura peut-être une sorte de sérénité recouvrée, d’orgueil rassuré qui lui feront, alors, de nouveau, mettre sa parole unique au service de livres plus méchants et commerciaux, se saisissant, au choix, du désordre contemporain ou de la bêtise moderne, tant le roman français, a, en cette matière, une volonté d’insignifiance qui frise la démission. Il n’y a qu’à lire les passages sur la guerre de quatorze (et nous revoilà avec Thomas Mann, comme quoi, les digressions retombent toujours sur leurs pattes) mettant en scène Charles Péguy ou Alain Fournier, il n’y a qu’à voir leur justesse et leur puissance dramatique, pour se rendre compte que ces vingt pages, délayées et vendues sous couverture blanche avec un faux nom de professeur provincial, récolteraient aisément un prix littéraire abandonné sur un coin de table, puisque la guerre de quatorze, décidément, reste un sujet inépuisable d’inspiration pour la littérature française de notre glorieuse époque (saviez-vous que cela avait fait tant de morts ? et des estropiés ? et des gueules cassées ? qu’on creusait des tranchées sur le front, pendant la guerre de quatorze ?). Mais tout cela, ce sont des regrets de lecteur, plus que des injonctions : Yann Moix peut bien faire ce qu’il veut, y compris, donc, ce livre incroyable et hilarant, où l’on croise un Yteulaire à l’argot absolument génial, un plaidoyer d’un mari contre son fils et pour le monopole des seins de sa femme, une pluie de morts, Fernandel et Georges Bataille, ou bien encore une remarque, sublime, sur le mot brillantine. Qu’ajouter de plus ? Peut-être que le plus dur, avec les naissances, c’est moins de commencer que de savoir s’arrêter.