Une table basse, devant la table basse quelques fauteuils sont disposés en arc de cercle. Les fauteuils sont encore vides. Je suis arrivé en avance. La verrière au-dessus de ma tête diffuse timidement une lumière diaphane qui vient habiter discrètement ce lieu de lettres et de silence. Sur la table basse, quelques livres, Proust, Flaubert, Voltaire dans la Pléiade. Ils portent sur leur tranche des lettres et un numéro, il les aura certainement pris dans les rayonnages de la bibliothèque qui nous abrite. Lui, il est déjà là, assis, un peu à l’écart. Lui, c’est l’écrivain qui nous a invités. Il parlera aujourd’hui de ses auteurs favoris, il lira des passages de ses textes préférés. A côté de la prestigieuse édition de la correspondance de Voltaire, un ouvrage est plus récent que les autres. C’est lui qui l’a posé là, cela ne fait aucun doute, c’est son livre, pas de numéro sur la tranche. C’est le livre de l’écrivain, le sien, celui qu’il a écrit, son dernier livre, celui dont je viens de terminer la saisissante lecture et qui est là aussi, dans ma poche. Un mot est inscrit sur la couverture : Polaire, c’est le titre du livre. Un nom : Marc Pautrel. Ça, c’est le nom de l’écrivain. C’est son nom, le sien. Ce jour-là, j’ai rencontré Marc Pautrel.
Nous nous sommes revus, sur la scène d’un théâtre. Il lisait les fulgurantes et énigmatiques premières pages de Polaire. Moi, je lisais Robert Walser et Pierre Louki pour d’autres qui lisaient aussi pour dire le bonheur de lire. J’ai attendu la solitude de la nuit pour continuer à le découvrir lui, Marc Pautrel, pour me plonger dans ses premiers livres Le Métier de dormir, Le voyage jusqu’à la planète Mars, Le moteur à os, Je suis une surprise et puis ce furent Un voyage humain et L’homme pacifique édités, comme Polaire par Philippe Sollers dans la belle collection qu’il dirige chez Gallimard, L’Infini.
Envisager un entretien devenait incontournable pour moi. Je le lui ai proposé. Nous nous sommes écrits, nous nous sommes revus, nous avons déjeuné ensemble. Il a accepté. P.B.
Polaire, tel est le titre de votre dernier ouvrage sorti en janvier dernier. Nous allons en parler. Mais tout d’abord une première question. Après vos études juridiques c’est l’écriture qui oriente votre vie. Vous écrivez un premier livre qui attendra quinze ans avant de trouver un éditeur : Le Métier de dormir. C’est un recueil de courts récits. Pendant cette période vous vivez dans la précarité. Alors Marc Pautrel, pourquoi écrire?
Marc PAUTREL– Pour être exact, ce n’est pas mon premier livre qui a mis quinze ans à être publié, c’est moi qui ai mis quinze ans à l’écrire. Pendant toutes ces années je n’ai pas arrêté d’écrire mais c’étaient des choses vraiment sans intérêt, de la graphomanie égocentrique. Le mystère, c’est pourquoi soudain un jour quelque chose se cristallise et j’obtiens la clé qui ouvre la porte ? Autre mystère : pourquoi j’ai persévéré aussi longtemps ? Toujours est-il qu’au bout de dix ou douze ans donc, il y a des choses qui bougent, quelques éditeurs connus le voient, m’encouragent, puis je découvre la concision des récits qui feront Le Métier de dormir (et les deux volumes suivants encore inédits), des récits écrits durant une période assez resserrée, entre 2002 et 2004.
Ensuite, j’ai essayé d’écrire plus long, de passer des récits de deux pages à des textes de cinquante ou cent pages. Comme j’étais publié, ça devenait plus facile d’écrire, ça me donnait confiance en moi. La confiance en soi, pour un écrivain, c’est quatre-vingt-dix-neuf pour cent de la réussite. Si je ne doute pas, si ma main ne tremble pas, je reste dans la vérité et je peux écrire, mais si j’hésite, je perds tous mes moyens, les mots me fuient. Comme beaucoup d’écrivains, je suis incapable de dire pourquoi j’écris. Je ne peux faire que des hypothèses, constater la détermination absolue, et terrifiante pour moi qui sais ce que je pense chaque seconde, à écrire ce que je crois devoir écrire. C’est comme si c’était une mission, et même bien plus, une condamnation, un ordre sous peine de mort. C’est une question d’existence et de langage, j’existe parce que le langage m’accompagne, parce que les mots marchent avec moi. Je ne suis pas solitaire dans la vie, j’ai des parents, un frère, des neveux et nièces, des amis, une compagne, des collègues écrivains, un éditeur qui me soutient, quelques lecteurs, donc je suis très entouré, et pourtant, j’ai l’impression d’avoir peur d’être abandonné par le langage, par ma langue, par mes mots. Il y a une sorte de relation amoureuse entre ma voix écrite et mon corps. C’est cette symbiose, l’état fusionnel entre parler et être, écrire et vivre, que je recherche. Bref : j’ai besoin d’être écrit par moi-même pour vivre heureux.
Vous avez dit à Alain Veinstein lors d’un entretien sur France Culture le 2 mars 2013 ceci : «Écrire est une expérience personnelle qui me hante… un texte doit me réveiller la nuit, le texte commence à me posséder et dicte ses instructions».
Oui, le réel veut que je grave certaines scènes. C’est-à-dire que j’assiste à des choses incroyables, que je juge incroyables, et qu’il m’est impossible de ne pas raconter dans une forme qui restitue, dans le corps du lecteur, l’état le plus proche de celui où je me suis trouvé en les vivant, et cette forme est le roman, ou l’épopée, ou le suspense, ou la tragédie, ou la prophétie, bref l’histoire haletante et qui se développe dans une forme temporelle caractérisée. Vous savez, même à l’ère de la vidéo-surveillance et de l’enregistrement numérique, tout ce qu’on ne note pas est oublié. Six mois après, un an après, dix ans après, que reste-t-il d’un événement ? Quasiment rien. Même la mémoire s’efface, et la mort d’ailleurs, au bout de quatre-vingt à quatre-vingt-dix ans, efface violemment les corps, les remplace par d’autres, et tout ce qu’ils contenaient de souvenirs disparaît. La littérature, de ce point de vue, est une technique de conservation de la vie, non pas au sens du témoignage, mais au sens de la restitution parfaite, par transvasement du corps de l’auteur dans le corps du lecteur. La vie passe de corps en corps par l’émotion artistique. Il faut capturer la vie, pas l’emprisonner, non, la conserver et la restituer, non pas congelée ou empaillée, mais entière, vivante, et jamais prisonnière, libre. La littérature sert à ça, et ma conviction est qu’elle est l’art le plus puissant, c’est pour cette raison que je suis devenu écrivain plutôt que musicien ou peintre. C’est pour cette raison que je me bats tous les jours, même quand c’est difficile, même quand j’ai l’impression que mes mots me trompent, qu’ils me faussent compagnie et que je dois recommencer dix fois de suite les choses pour qu’enfin je trouve le passage.
Dans Polaire peut-on aussi parler d’un passage, du point de vue du narrateur celui-là ? Il y a un homme qui aime une femme éperdument et il se rend compte lentement (il ne veut pas y croire et le récit est d’une précision extrême sur ce point) de l’inquiétante singularité de cette femme, de sa position d’exception. Il opère tout un cheminement non ?
Quand je parle de trouver le passage, il s’agit de la capacité à écrire, à restituer, techniquement, l’histoire elle-même. Qu’il y ait dans Polaire un passage à trouver pour le narrateur, et surtout pour l’héroïne, une voie de libération à découvrir, sans doute oui, mais pourtant aucun des deux personnages ne trouve la solution.
Un passage qui serait donc un ratage si on se place du côté de l’amour ?
Un libraire a écrit que ce roman était l’histoire d’un sublime fiasco, il y a de cela, c’est parce que ça échoue, parce que ça bloque, que c’est passionnant. On pourrait presque faire une provocation et dire que la vie heureuse est ennuyeuse, que seul le drame permet de se sentir vivre. Mais c’est une provocation évidemment, je suis comme tout le monde, je préfère être heureux, bien qu’en même temps je déteste par-dessus tout m’ennuyer. Un des sujets de Polaire c’est le conflit entre la folie et l’amour : pour le narrateur, l’héroïne n’est pas malade. Il est persuadé que l’amour est plus fort que la maladie, que si elle accepte l’amour, elle sera instantanément guérie.
Justement, le narrateur se souvient qu’elle lui a déclaré un jour «Je suis désolée, je ne peux pas te donner ce que je n’ai pas». Je repensais à ce que Le Docteur Lacan dit dans «Problèmes cruciaux pour la psychanalyse» le 17 mars 1965 : «L’amour, c’est donner ce que l’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas». Elle, elle dit autre chose n’est-ce pas ?
Oui, elle dit qu’elle ne peut pas donner une chose qu’elle n’a pas, à un narrateur qui veut cette chose, et qui la veut précisément parce qu’il est persuadé que l’héroïne se trompe, et que cette chose, elle l’a. En résumé, il pense qu’au plus profond d’elle-même elle ne veut pas et que sa véritable phrase aurait dû être : «Je ne veux pas te donner ce que je n’ai pas» et donc à partir de là il essaie de la convaincre que si elle veut elle pourra, mais il échoue. Son amour pour elle, qui est une sorte d’aveuglement, comme tout amour, lui fait croire qu’elle n’est pas malade mais dissimule un secret, un traumatisme, une pièce manquante du puzzle, une sorte de vide autour duquel il tournera pendant tout le roman sans jamais parvenir à l’atteindre. Et c’est là le ressort de cette quête amoureuse, il tourne comme un satellite autour de ce secret, réel ou imaginaire, autour de ce vide aussi nécessaire à sa révolution que l’est le moyeu d’une roue.
En vous lisant, Marc Pautrel, j’ai éprouvé un sentiment d’étrangeté. Il y a cette femme qui demeure insaisissable dans sa beauté et dans son rapport au monde, ce narrateur dont on ne sait quasiment rien sinon qu’il l’aime et une temporalité qui échappe au lecteur. Et puis il y a votre écriture qui semble tourner autour de quelque chose de caché, un secret, voire un vide. C’est une constante dans votre œuvre, qu’il s’agisse des romans ou des courts récits que vous avez publiés. Êtes-vous d’accord avec ça ?
Oui, bien sûr, je crois que le secret fonde le monde. Tout part toujours de quelque chose de caché, on ne peut être en relation avec les autres que grâce à du secret, que parce qu’on ne dit pas tout sur soi, il faut taire des choses de soi, il faut du «tu». C’est d’ailleurs assez clair en français, quand je dis «tu» à une femme, elle doit entendre «tout ce qui est tu de moi, tout ce qui est tu de toi». La curiosité va pousser chacun à essayer de percer ce secret, le secret va ici encore être le moteur. C’est parce que quelque chose est caché qu’on cherche à le découvrir, et parce qu’on cherche à le découvrir qu’on se met à marcher et qu’on va quelque part. C’est, je crois, ce que fait la psychanalyse. Dans Polaire, si le narrateur est révolté contre les psychiatres qui assomment de médicaments la femme qu’il aime, et elle le dit elle-même, elle en souffre, elle a des mots terribles quand elle explique que les médicaments lui «sucent le cerveau», que sa «tête est en train de fondre», il admire au contraire les psychanalystes. Et justement, à aucun moment l’héroïne n’évoque la question de l’analyse et il suppose donc qu’elle n’en a jamais suivi. Elle n’a pas assez parlé et le narrateur pense que lui seul, non pas par la parole mais cette fois par l’amour, pourrait délier ce nœud en elle. Plus généralement, s’agissant de la psychanalyse, sans l’avoir pratiquée, j’imagine tout de même que pour un analyste, écouter son patient doit être absolument incroyable, passionnant, dans tout ce que ça révèle sur la nature humaine. Si je n’avais pas été écrivain, j’aurais peut-être aimé être psychanalyste pour pouvoir explorer les êtres et leurs histoires, pénétrer précisément au cœur du secret.
Je suis heureux que vous évoquiez la psychanalyse. Dans Polaire le narrateur parle un peu comme vous, il dit : «J’admire les psychanalystes, pour leur science du langage, leur goût de la poésie et l’élégance de leur pratique, écouter, raconter, parler et encore parler». Quand il fut question du secret, vous avez même évoqué «le traumatisme». Savez-vous qu’en novembre prochain, les 43èmes Journées de l’École de la Cause freudienne portent ce titre, «Trauma» avec en sous-titre «Bonnes et mauvaises rencontres avec le réel, les traumatismes dans la cure analytique»? Alors, enseignez-nous! Ce signifiant «trauma», pour vous, l’écrivain, que représente- t-il ?
Dans Polaire, le narrateur n’a aucune connaissance particulière du trauma, la question est beaucoup plus simple : puisqu’il est amoureux de l’héroïne, il ne peut pas croire qu’elle soit malade au sens pathologique, donc il suppose – c’est seulement suggéré – qu’elle a subi un trauma quelconque, physique ou mental, qui la perturbe aujourd’hui, que la cause de sa maladie est extérieure et non pas intérieure. Le narrateur a d’ailleurs une attirance pour le côté perturbé de cette femme, et à un moment il dit qu’il a vu une photographie d’elle datant de quelques années, et qu’elle y semble très banale, totalement différente, beaucoup moins belle. Donc elle a changé entre le moment de cette photo et aujourd’hui, mais il ne sait pas pourquoi. Tout comme à la fin il devine qu’elle est encore en train de changer à nouveau, et d’ailleurs c’est peut-être sa guérison qui arrive, et c’est le moment où le narrateur choisit de s’en éloigner.
Quand j’avançais cette question sur le trauma, évidemment je pensais à l’héroïne et à cet impénétrable secret auquel le narrateur se cogne. Mais pas seulement. Je songeais aussi à l’acte d’écrire. Y a-t-il quelque chose de traumatisant dans l’acte même d’écrire ou à l’origine de l’acte? Accepteriez-vous de dire quelques mots là-dessus ? Vous évoquez avec Alain Veinstein l’enfer et le paradis.
Écrire n’est pas traumatisant, au contraire écrire c’est être libéré d’un monde trop lourd (sans pour autant être traumatisant). Quant à l’origine de l’acte d’écrire, je ne crois pas à l’idée très répandue selon laquelle il y a toujours eu chez l’auteur un drame préalable qui le pousserait à écrire. Proust ou Kafka n’ont connu aucun drame, si ce n’est des micro-soucis avec les parents. En ce qui me concerne, aucun drame d’enfance non plus. Je pense plutôt qu’il s’agit d’une question de langage, une sorte de don qui permet à certaines personnes de penser directement en langue écrite, d’avoir accès à un langage absolu qui utilise cent pour cent des règles grammaticales, et même au-delà. L’écrivain est un virtuose élu.
Un virtuose élu ? Bigre !
Je ne sais pas si l’expression est parfaite mais les grands écrivains parviennent à utiliser le langage courant, les mots qui nous sont communs à tous, d’une manière extrême qui confère à ce langage des propriétés nouvelles, qui créé de l’Art et de l’émotion chez le lecteur. Et je ne crois pas que ces écrivains y soient pour grand-chose : bien sûr ils travaillent beaucoup, mais tout le monde travaille beaucoup. Simplement, quelques-uns font autre chose qu’écrire, ils font de la littérature, et ils ne comprennent pas comment ils y sont parvenus, donc c’est pour cela que je dis qu’ils ont été élus par quelque chose de supérieur, pas nécessairement religieux, ce peut-être le grand auteur commun décrit par Borges, ou bien juste une propriété naturelle et spécifiquement humaine qui tombe sur certains et pas sur d’autres.
Au début de notre conversation, vous avez parlé du «réel» dans votre écriture, vous avez dit : «Le réel veut que je grave certaines scènes». Vous savez que les psychanalystes font un usage très précis de ce signifiant au regard de l’enseignement du Docteur Lacan et des élaborations de Jacques-Alain Miller dans son cours. Mais vous, Marc Pautrel, qu’est-ce que vous appelez «le réel» ?
Le «réel» lui-même doit ici être entendu dans un sens flottant, parce que c’est le réel perçu par l’écrivain, qui va déformer ce qu’il a vu, vécu, rêvé, entendu raconter, pour n’en garder que ce qui pour lui fait sens, et donc, comme je le disais, qui va vivre ou entendre le réel en le pré-lisant, avant ensuite de l’écrire sur la base de sa vie-lecture déformée. Si je faisais un raccourci, je dirais que l’écrivain est juste le mur sur lequel le réel vient rebondir, s’il n’était pas là jamais le réel ne se transformerait en romans, tout serait oublié, il n’y aurait pas d’autre sens que le présent et la sensation physique primaire de l’être vivant : être heureux ou pas, sans aucune autre portée future.
Vous avez commencé par écrire des récits, très courts, que je considère comme de vraies pépites : Le Métier de dormir, Le voyage jusqu’à la planète Mars, Le moteur à os et La planète Mars, qui est inédit. Puis vous êtes passé à des récits plus longs et au roman. Le style est toujours là, qui fait penser à Edward Hopper – c’est une femme qui me l’a dit, je suis d’accord avec elle – l’anonymat, la solitude des personnages, la suspension du temps. Lors d’une conversation que nous avons eue, vous avez même utilisé une expression étrange «Le livre sans coutures» et là, je ne savais plus si c’était Marc Pautrel le lecteur qui me parlait ou bien Marc Pautrel l’écrivain. Pouvez-vous nous dire pour conclure quelques mots sur les liens entre l’un et l’autre ?
L’expression exacte est «Un ciel sans couture», elle est chinoise et vient je crois du classique taoïste Tchouang-tseu, mais je n’ai pas réussi à retrouver le passage. Un ciel sans couture, c’est-à-dire un ciel complètement bleu, représente l’image de la perfection. L’univers des chinois, particulièrement des taoïstes, est très présent dans mes livres, c’est un monde radicalement différent de notre monde occidental, chez eux il y a un grand équilibre général des choses, une sorte d’immense roue qui tourne, et il faut réussir à tourner en même temps qu’elle, être entraîné par elle et bénéficier de sa force, et le moyen d’y parvenir est de rester le plus inactif, le plus discret et le plus apparemment faible possible. Le taoïsme est un véritable traité de stratégie, et si on considère que toute la vie, de la naissance à la mort, est hélas une guerre défensive, il devient très utile de suivre les conseils de Lao-tseu comme «Ne pas lutter, et pourtant savoir vaincre» ou bien «Celui qui sait où se tenir n’est pas en péril», cette dernière phrase étant l’exergue de mon deuxième livre. Pour ma part, j’essaie de suivre la Voie des chinois, de faire ce que j’ai à faire et seulement ça : écrire juste. Pour ce qui est des différences entre MP lecteur et MP écrivain, disons que je suis devenu écrivain parce que j’étais lecteur, mais je ne suis pas un bon lecteur de mes propres textes. Je ne me vois pas, si vous préférez. C’est d’ailleurs le cas dans la vraie vie : sans le secours d’un miroir, on voit quelques parties de son corps, mais on ne voit jamais son propre visage. C’est sans doute pour ça qu’on lit des romans, pour se voir en face.
Note biographique
Marc Pautrel est né en 1967. Après des études de droit, il a décidé de se consacrer à l’écriture. Il a été lauréat des «Missions Stendhal». Il est l’auteur, notamment, de L’homme pacifique (2009), Un voyage humain (2011) et Polaire (2013), parus aux Éditions Gallimard. Il est aussi présent sur Internet au travers d’un carnet d’écriture quotidien et d’un blog d’actualités. Il est actuellement en résidence d’auteur à Brive où il travaille à l’écriture d’un roman parlant du Japon.


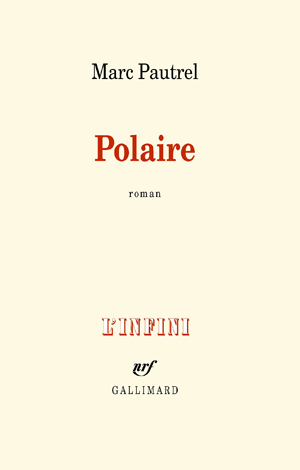





L’écriture comme condamnation, saisissante fulgurance pour faire entendre le terrifiant de ce long face à face silencieux et solitaire avec le bruit et la fureur. Très bel entretien.
Je me demande si je n’ai pas été un des premiers éditeurs de Marc Pautrel, c’était dans la revue que j’avais créée : Le Bord de l’eau. Marc Pautrel s’en souvient-il ?
Bonjour, je vous remercie de votre lecture de cet entretien. Je ne peux malheureusement pas répondre à votre question et espère que Marc Pautrel va le faire. je connais un homme charmant (Jean-Paul) que j’ai rencontré il y a quelques temps , j’ai oublié son nom de famille. C’est le libraire de la Place des Chartrons à Bordeaux « Librairie Olympique » qui a édité Marc Pautrel au tout début. J’espère avoir le plaisir de vous lire. Quelle était votre revue ?
Bien à vous et belle journée.
Philippe Bouret