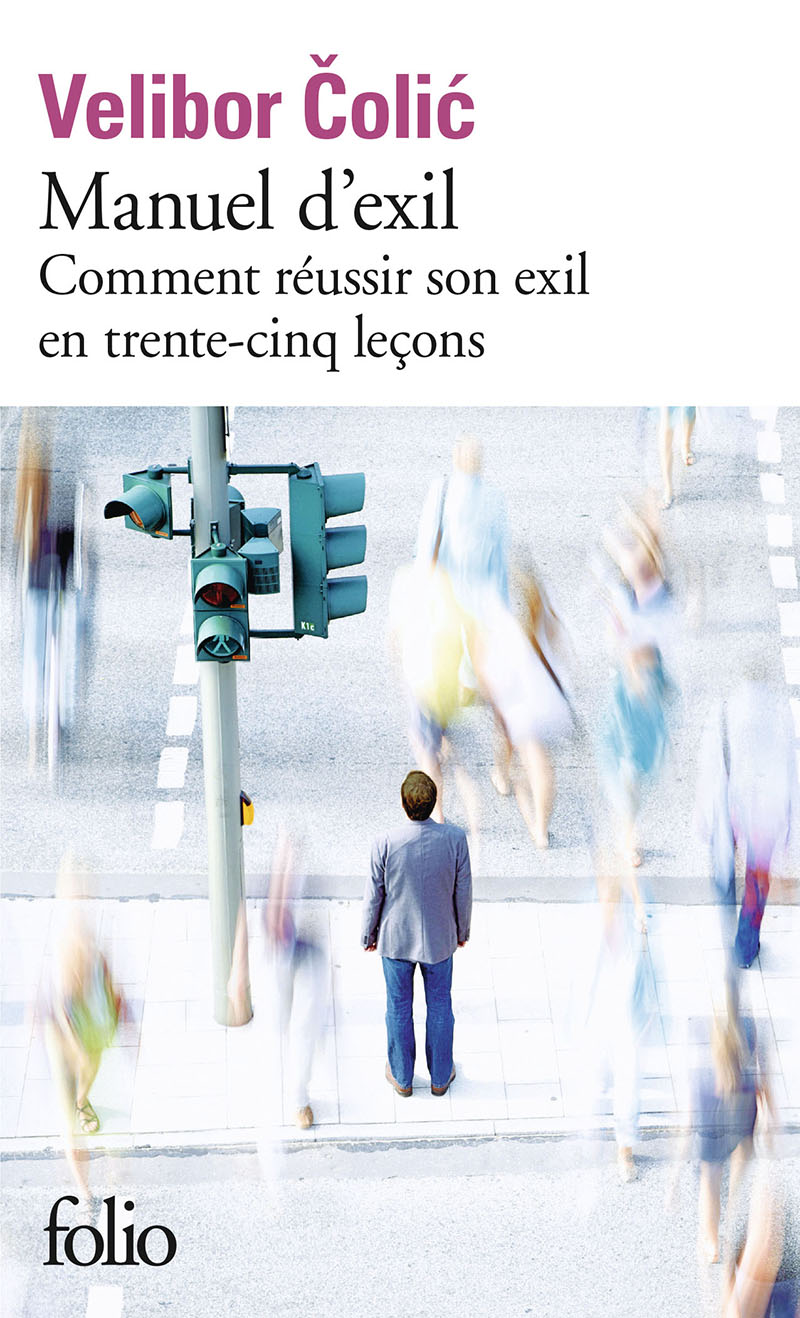Nous sommes une bonne cinquantaine d’amoureuses et amoureux du livre et de la littérature, rassemblés sous la belle et large verrière de la médiathèque de Brive en ce samedi ensoleillé. Invités à partager un moment avec Velibor Čolić, romancier bosnien exilé et réfugié politique en France depuis 1992, nous sommes impatients. Le Lauréat du Prix des lecteurs de la ville de Brive est actuellement en résidence d’auteur. Il nous attend. C’est le jour de son anniversaire. Mais une autre date compte, autant que la première. C’est sa «seconde naissance» dit-il, le 20 août 1992, quand il a franchi la frontière française, après avoir fui la Bosnie pour un «aller sans retour».
L’atmosphère est studieuse et silencieuse, le lieu paisible et clair. Au milieu des plantes, les livres semblent nous regarder du haut de leur savoir, quelques lecteurs flânent encore entre les rayonnages. Vont-ils rester ? Il plane malgré tout dans l’air comme un parfum de gravité pour ceux, qui, comme moi, sont sensibles au passé qui se répète et aux évènements tragiques qui ont scandé le XXe siècle. Répétition, oui, c’est bien d’une répétition qu’il s’agit. Et pourtant, après 1945, ILS avaient dit «Plus jamais ça…» Mais à quoi bon, «Ce qui est forclos du symbolique revient dans le réel»[ref]Jacques Lacan, à propos de la castration de l’Homme aux loups, Écrits, Seuil, Page 388.[/ref] ce réel-là, personne n’a voulu le regarder en face, ni même le voir. Déni !
Velibor Čolić est porteur de cette histoire, de cette répétition, de l’Histoire obscure et lourde de la guerre en ex-Yougoslavie. Il a souffert. Il ne s’en remettra jamais. C’est l’Histoire d’un génocide que personne n’a eu le courage de reconnaître, jusqu’aux plus hautes autorités européennes et françaises de l’époque et encore de nos jours. Pourtant, des voix se sont élevées et se font encore entendre. Je pense bien évidemment à Velibor Čolić, mais aussi et surtout au travail colossal que Louise L. Lambrichs a effectué depuis plus de vingt ans, sur ce déni de génocide [ref]Louise L. Lambrichs, Comme en 14 ?, Collection Sciences & Humanités, Ed. La rumeur libre, septembre 2014.[/ref]. Velibor Čolić la connaît bien, il m’a dit son admiration et son estime pour la romancière et essayiste. Il reconnaît la pertinence de ses thèses auxquelles il adhère et rend hommage à la ténacité et à l’intelligence de cette femme, qui, c’est le moins que l’on puisse dire, ne cède pas sur son désir.
Velibor Čolić est là, aujourd’hui parmi nous, assis dans un fauteuil club, sur une petite estrade. Devant lui une table basse avec des livres, une feuille blanche griffonnée et un micro. Parfois on s’approche, on échange deux ou trois mots. C’est un grand bonhomme d’un mètre quatre-vingt-douze, habillé de noir avec un tee-shirt imprimé où l’on peut lire :
Nem Alegre
Nem Triste
Poeta
(Ni joyeux, ni triste, poète)
Velibor Čolić a reçu en 2014 le Prix des lecteurs de la ville de Brive pour son roman Ederlezi [ref]Velibor Čolić, Ederlezi, Collection blanche, Ed.Gallimard, mai 2014.[/ref]. Cette année, il est accueilli en résidence d’écriture pendant un mois. Il nous propose de découvrir ce qu’il appelle sa «géographie musicale et littéraire». Un voyage en musiques, en livres et en paroles pour découvrir les grands événements de sa vie.
A l’instant même où il prend le micro et nous adresse ses premiers mots, je sais que j’ai la chance de participer à un moment précieux. L’homme parle lentement, son accent invite à la découverte et à l’attention délicate. «Où que j’aille, j’ai un accent, même en Bosnie. Je serai toujours l’étranger». Et le voilà parti dans un français impeccable et un vocabulaire recherché à raconter sa vie, les ruptures, la mélancolie et les envolées heureuses de l’adolescent, puis du jeune homme étudiant bosnien, passionné de littérature et de jazz. Les années d’université, les études de lettres, la musique, les émissions qu’il crée à la radio. Le phrasé accueille les silences comme autant de ponctuations nécessaires. Des pauses musicales rythment un discours que la présence et la dynamique du corps viennent souligner. Les inflexions, les scansions et la parole s’imposent en contrepoint pour dire la vie dans un texte vivant au présent et en mouvement. Velibor Čolić a le corps nomade. Ses yeux pétillent sur Round Midnigt par Miles Davis. Sa bouche s’entrouvre, on croit entendre un souffle, sur Saint Thomas par Sonny Rollins. Il frappe la mesure du pied, balance la tête lorsque résonne Orient est rouge par le Koćani Orkestar. La Macédoine aussi a son jazz. Puis la musique s’estompe pour laisser place à sa voix, Vélibor Čolić cite Aldous Huxley : «Après le silence, ce qui vient le plus près à exprimer l’inexprimable est musique». L’inexprimable est là, bien là, présent sous chaque mot proféré. Le dit jaillit au-delà du dire pour pointer l’indicible, le corps s’engage là où le mot manque. Alors l’écrivain lève le doigt, pointe l’espace, tel le Saint Jean Baptiste de Léonard de Vinci – plus haut encore, il tend son bras vers le ciel, celui de son village natal, gris, cerné de hautes montagnes dans ce pays d’Europe de l’est des années 1980, totalement coupé du monde. Seul le jazz qu’il découvre vient ouvrir au jeune adolescent de quinze ans les portes d’un ailleurs inatteignable «Je ne pouvais pas aller vers le monde, alors le jazz m’a permis de faire venir le monde à moi». Silence… la main redescend lentement, se crispe, doigts crochetés, tétanisés, quand le romancier évoque les débuts de la guerre civile. Hier, c’était la vie, le théâtre, le cinéma, les études littéraires classiques, les copains dans les bars, les filles, la musique, le jazz à la radio chaque jour, les émissions qu’il anime. Aujourd’hui, les drapeaux noirs claquent au rythme des bottes nazies, le jazz pleure devant les chemises noires et les uniformes vides. Velibor Čolić troque malgré lui sa guitare basse contre une Kalachnikov, «Une arme facile et meurtrière, un jour suffit pour apprendre à s’en servir et savoir tuer. Enfants-soldats».[ref][/ref] Il déserte peu de temps après. Il est repris, s’évade à nouveau. Un stade, un soir d’orage, ils sont tous «parqués là», prisonniers, les gardiens autour, en armes, ils sont ivres, il en profite. Risquer sa peau pour la liberté, il n’hésite pas, il fuit pour ne pas être contraint à tuer. «Moi, j’aimais bien les stades, mais pour le football».
La musique est toujours là, les notes indélébiles comme ultimes compagnes, dans sa tête. La médiathèque résonne du blues et de la voix de Baschung qui creuse le sillon, La nuit je mens, «Ecoutez comme c’est beau !» Il a raison, Baschung était un grand. Alors la main se détend, elle se libère, elle caresse son genou, elle effleure l’air en douceur. Dansent ses doigts, encore, qui écrivent dans l’espace ce qui ne peut se dire. Ecouter Baschung et regarder sa main suffisent.
Velibor Čolić aime l’écriture et les beaux textes. Souvenirs émus de la bibliothèque paternelle, quand il parle des quatre murs couverts de livres. Sur les rayonnages du haut, ceux interdits par le père, il découvre les grands écrivains russes, Chalamov, Dostoïevski, Boulgakov, mais aussi français, dans la traduction, Camus, Perec… et les autres, Primo Levi, Kerouac, Garcia Marquez, les poètes, Baudelaire, Verlaine… Il aime leurs mots simples pour dire la complexité de la vie, sa radicale brutalité, mais aussi la liberté. «Si je n’avais pas connu la lecture, la musique, l’écriture, je ne serais pas là aujourd’hui devant vous. C’était la mort qui m’attendait comme certains de mes amis chers ou bien passer de l’autre côté du miroir.»
«Quand je suis arrivé en France, j’ai vécu à Strasbourg, au douzième étage chez une amie qui m’hébergeait, elle fermait à clé la porte du balcon, elle me l’a dit plus tard, elle avait peur que je saute». Evocation du vide, la main se crispe brusquement, elle bouge, impatiente, nerveuse, le regard se perd, les doigts s’agitent, que tentent-ils de saisir ? Le silence s’invite… Le calme revient, la main se détend et maintenant caresse le genou, elle décolle lentement, elle est oiseau, les doigts se déplient, souples maintenant, pour inscrire dans l’espace une calligraphie dont seul l’écrivain connaît le secret. Les doigts dansent sur une phrase qui s’envole. Voler, voilà une idée face au vide, voler avec les mots. Une citation de Baudelaire et le regard s’illumine. Le sourire s’esquisse quand L’étranger de Camus revient en mémoire. Vélibor Čolić s’absente, l’espace d’un instant, il est là-haut, son regard levé traverse la verrière. Le poing est serré, vers hier, sur la tragédie, sur le rien qui puisse dire ça. Non, il y a quand même quelque chose à dire. Qui va le dire… bon sang ? Qui va enfin l’entendre ? La voix devient plus grave, les mots plus espacés pour décrire son éviction de la radio Yougoslave au moment de l’arrivée des «nazis» au pouvoir. «La veille, j’animais à la radio des émissions de jazz, comme chaque jour, et j’avais un “Camarade Directeur” qui se réduisait à un voyant rouge sur mon téléphone. Le lendemain, je reviens au travail et là, on me dit que “Monsieur le Directeur veut me voir, c’est un nazi”. Il me dit :“Il n’y a plus de place à la radio pour cette musique de nègres (jazz) et de pédés (rock). Tu es viré.”»
Les doigts se remettent à danser dans l’espace, ils capturent le regard de chacun qui, dans l’assistance, offre en retour à cette parole incarnée une présence consistante. Soudain, Velibor Čolić ouvre le ciel d’une main largement déployée et généreuse pour dire son arrivée en France, il écarte d’invisibles nuages, mais le poing se referme aussitôt quand il évoque le passage par l’Allemagne : «Je quittais la guerre, les massacres, les atrocités, j’arrive en Allemagne, et je me rends compte que pour eux, c’était l’été… A la lecture de mon passeport le policier me fait un geste rapide, du style, dégage ! – comme si j’étais un pestiféré – pensez donc, un petit yougo, mieux vaut le refiler aux autres». C’est ça le déni !
Comment l’Europe a-t-elle pu fermer les yeux sur un génocide ? Est-elle là la question ? Avoir sous les yeux le génocide et ne pas le voir… Et le voilà qui nous explique et nous dit comment, en Europe, dans les années 90 s’est déroulé un processus programmé d’extermination massive et que personne n’a rien vu. Conflits interethniques ? Comment peut-on se contenter de ça ? C’était un génocide, oui, un génocide, il n’existe pas d’autre mot pour nommer cette répétition, ce retour de l’identique, le même que celui perpétré contre les juifs en 1940. Pour Velibor, c’est un processus en trois temps, méticuleusement pensé et personne n’a vu ça. Génocide, mémoricide, urbicide. Le corps se tend alors, la main saisit le genou, les ongles griffent la toile et la voix se perd vers le village natal. «C’était un lieu triste, certes, mais il y avait là deux mosquées anciennes de cinq cents ans, deux ou trois églises catholiques, une église orthodoxe… Les gens vivaient ensemble et dans cette ville triste et grise, cernée de montagnes, où on ne voyait qu’un bout de ciel, la vie était présente. Quand j’y suis revenu, les mosquées avaient été rasées, à la place un parking. Les églises, absentes, détruites… pour construire un supermarché.» Pour Velibor Čolić, voilà le mémoricide, l’effacement de tout ce qui a constitué la vie passée, les monuments, les gens, les traditions, comme si rien n’avait existé. Urbicide… Sa voix se glisse et disparait dans le silence… la main se renverse, paume vers le sol, les doigts se contractent en forme de griffes, rapace qui vient saisir la vie et l’anéantir. La Chose est palpable, l’impensable s’impose, Shoa. «Comme disait un officier au soldat qui tentait de régler la batterie de canons pour ne pas manquer la cible : “point besoin de réglages, on ne manque jamais une ville”.»
Il avait commencé son intervention par ces mots : «Notre existence est marquée par le lieu où l’on naît». Sa mère, catholique pratiquante voulait l’appeler Antoine car il était né le jour de la Saint Antoine. Pour son père, communiste, il n’en était pas question : «Alors il a cherché un prénom d’avant l’arrivée des catholiques en Bosnie et il a trouvé Velibor qui signifie Le grand sapin. Comme vous le voyez, j’ai bien grandi puisque je mesure un mètre quatre-vingt-douze.»
Quant à la langue, il l’évoquera en public et il m’en reparlera en privé. «Je suis parti de Yougoslavie avec un bac plus cinq, je suis arrivé en France illettré, je suis reparti à zéro, j’ai appris la langue et maintenant je n’écris qu’en français.» Le temps de griller une cigarette, de prendre l’air devant la médiathèque et une voix orientale s’élève, Goran Bregović. C’est une longue plainte venue de Bosnie, d’une grande beauté. La verrière n’existe déjà plus, Velibor Čolić a ouvert pour nous les portes du possible. Il a perdu sa maison, ses manuscrits ont été réduits en cendres mais les montagnes de la petite ville de Bosnie, où il a vu le jour, se sont enfin écartées pour dégager cette partie du ciel humain où le désir et l’amour des mots font dire à ce poète «La littérature et la musique – et je pèse mes mots – m’ont sauvé la vie».