Hannah Arendt connaît une forte actualité depuis quelques mois avec la publication en novembre dernier d’une nouvelle biographie signée Elisabeth Young-Bruehl (Pluriel), ainsi que de ses Écrits juifs (Fayard) [1]. Enfin, un second Quarto (Gallimard) lui est consacré sous le titre L’Humaine condition (comprenant La Condition de l’homme moderne, De la Révolution, La crise de la culture, Du mensonge à la violence) sous la direction de Philippe Raynaud. Rappelons que le premier Quarto comprenait Les Origines du totalitarisme et Eichmann à Jérusalem.
Ces deux derniers volumes Écrits juifs et L’Humaine condition nous donnent à la fois des textes célèbres en France et des inédits nombreux comme De la Révolution ou ses pages juives.
Après son Eichmann à Jérusalem, L’Humaine condition est sans doute son livre le plus connu. On peut regretter avec les éditions Gallimard que Calmann Lévy, sans raison, ait refusé que leur traduction reprise dans ce volume le soit sous ce titre, qui pour évoquer Montaigne, n’en est pas moins fidèle à l’originel, faute bien sûr de pouvoir reprendre celui rendu célèbre par Malraux. D’emblée, nous sommes frappés de voir que le livre sorti l’année où Levinas publia Totalité et infini, 1961.
L’Humaine condition (que nous préférons à son titre français usuel) analyse quelques-unes des problématiques capitales de l’être humain : la vita activa, le travail, le commun et le public, à partir de quoi Hannah Arendt aborde le bios, les grandes questions morales comme la liberté, la nécessité, la bonté, le marxisme, la parole, la solitude, la pauvreté… Les pages sur le travail témoignent de la puissance de sa pensée. L’œuvre (= la fin), écrit-elle, « justifie les moyens ; mieux encore, elle les produit et les organise. La fin justifie la violence faite à la nature […] le bois justifie le massacre de l’arbre, la table justifie la déstruction du bois » (p. 182).
Tout sur terre, depuis que l’homme l’a dominée avec l’ère industrielle, a une fonction de moyen. Tout sauf l’humain, comme Kant le proclama dans sa célèbre formule : « L’homme ne peut servir de moyen en vue d’une fin, tout être humain est une fin en soi » (184). Pas une époque où ce principe n’ait été foulé au pied. À la dernière page de son avant-dernier chapitre « L’Action », H. Arendt écrit cette parole capitale, aussi importante que celle de Kant : « les hommes, bien qu’ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover » (259). Sa philosophie de l’action est tout entière inscrite dans ces mots.
Au premier chapitre de On Revolution (De la Révolution), Arendt se livre à une analyse sémantique autant qu’historique du mot en lui-même montrant l’incroyable détour accompli depuis De revolutionibus orbium coelestium de Copernic (1543) jusqu’à sa première acception moderne puis son sens contemporain. La grande dame de la philosophie du XXe siècle montre la longue évolution du substantif pour acquérir enfin sa signification moderne avec la Révolution française. Philippe Raynaud, maître d’œuvre du volume, a voulu y adjoindre La Crise de la culture, Huit exercices de pensée, 1961 qui s’ouvre avec Char (« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament ») et se clôt avec Heisenberg et Einstein. Arendt y développe ses analyses sur l’autorité, la liberté ou la crise de l’éducation.

Abordons ses Écrits juifs, car un sujet aussi immense demanderait un ou plutôt des livres et un colloque entiers. On sait que la philosophe éleva le principe d’indépendance de l’esprit au-dessus de toute appartenance politique, idéologique, communautariste, mais comme tout principe, il faut savoir s’en détacher. Dans une lettre datée de 1963, par laquelle elle répondait à Gershom Scholem (qu’elle appelle de son prénom allemand « Cher Gerhard ») qui voyait en elle une « fille de notre peuple », elle écrivait : « La vérité est que je n’ai jamais prétendu être autre chose, ni être autre que je ne suis […] ». Mais elle ajoute tout de suite après : « Vous avez tout à fait raison : je ne suis animée d’aucun « amour » de ce genre, et cela pour deux raisons : je n’ai jamais de ma vie ni « aimé » aucun peuple, aucune collectivité […], ni rien de tout cela. J’aime « uniquement » mes amis et la seule espèce d’amour que je connaisse et en laquelle je croie est l’amour des personnes. En second lieu, cet « amour des Juifs » me paraîtrait, comme je suis juive moi-même, plutôt suspect1. »
Deux essais retenus pour l’édition actuelle sont des inédits de poids, « L’Antisémitisme » datant sans doute de 1938 ou 39, puis un texte de 1944 The Jew as Pariah (Le Juif comme paria). Par ailleurs, qui savait que la jeune philosophe avait voulu constituer une armée juive internationale dès 1941 ? En 1944, elle consacre un magnifique texte, une sorte d’appel, intitulé « Pour l’honneur et la gloire du peuple juif », à l’occasion du 1er anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Elle ne sait pas encore sans doute l’étendue du massacre. En décembre 1943, elle intitula l’un de ses tout premiers écrits, sur la question de la Palestine qui occupe la plus grande partie du volume : « La question judéo-arabe peut-elle être résolue ? »
Si Hannah Arendt fut si souvent douée d’une vision et d’une compréhension des situations que l’on ne peut que saluer, il lui arriva de se tromper gravement aussi, tout spécialement à propos du cas Eichmann en forgeant le concept de Banalität des Bösen, la « banalité du mal », qui serait d’ailleurs dû à son mari Heinrich Blücher. S’il n’y a pas en soi de « banalité » du Mal, il y en a moins encore dans tout ce qui touche au nazisme. A-t-on pu être Eichmann ou Himmler ou Mengele par hasard, par accident ? Eichmann ne savait-il pas qu’il conduisait des millions d’êtres à la mort ? Est-on banalement le pourvoyeur des chambres à gaz ? On sait que la philosophe suscita une massive controverse en Occident après son Eichmann à Jérusalem. Aujourd’hui le pourfendeur ou plutôt l’inquisiteur de l’orthodoxie de la Shoah, Claude Lanzmann, monte en première ligne contre H. Arendt, en préparant un nouveau film consacré justement au cas Eichmann à partir du témoignage de Benjamin Murmelstein qu’il filma à Rome en 1975 mais l’écarta de Shoah. Dans leurs entretiens, Murmelstein, qui côtoya l’Obersturmbannführer SS à Rome de longs mois durant, affirmait son fanatisme antijuif, sa haine radicale du Juif qu’il fallait détruire.
Au final, Hannah Arendt témoigne avec hauteur que si c’est l’Homme lui-même qui l’intéresse par-dessus tout, l’histoire juive, le peuple juif, ne la laissent pas indifférente, loin de là. Malgré ses quelques erreurs de jugement, ces deux volumes attestent une fois encore de la force de sa pensée métaphysique et politique, qui n’a rien perdu de sa prégnance.
[1] Traduits de l’anglais et de l’allemand par Sylvie Courtine-Denamy, qui a déjà accompli par ses traductions et ses études un énorme travail sur la philosophe
[2] Cf. Les Origines du totalitarisme, trad. Sylvie Courtine-Denamy, Quarto, Gallimard, 2002, pp. 1353-1358.
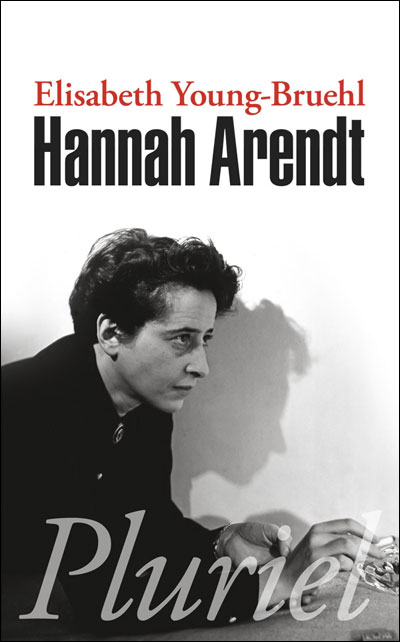
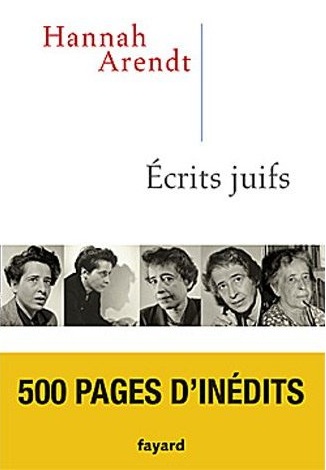 Hannah Arendt, Écrits juifs, traduits de l’anglais et de l’allemand par Sylvie Courtine-Denamy, Fayard, novembre 2011, 752 pages, 28 euros, ISBN : 2213642583
Hannah Arendt, Écrits juifs, traduits de l’anglais et de l’allemand par Sylvie Courtine-Denamy, Fayard, novembre 2011, 752 pages, 28 euros, ISBN : 2213642583
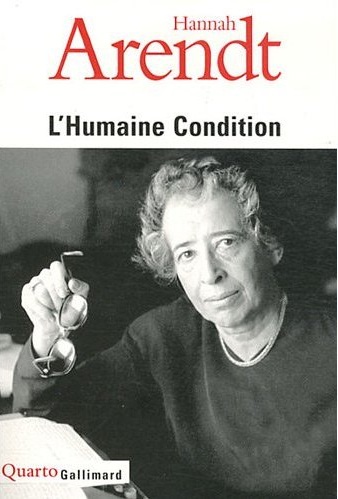 Hannah Arendt, L’Humaine Condition, sous la direction de Philippe Raynaud, Quarto Gallimard, mars 2012, 1300 pages, 26 euros, ISBN : 2070122395
Hannah Arendt, L’Humaine Condition, sous la direction de Philippe Raynaud, Quarto Gallimard, mars 2012, 1300 pages, 26 euros, ISBN : 2070122395








« le pourfendeur ou plutôt l’inquisiteur de l’orthodoxie de la Shoah, Claude Lanzmann » : dommage ! Le reste de votre article est très bien argumenté, mais là, avec ce genre d’idiotie, tout tombe par terre…