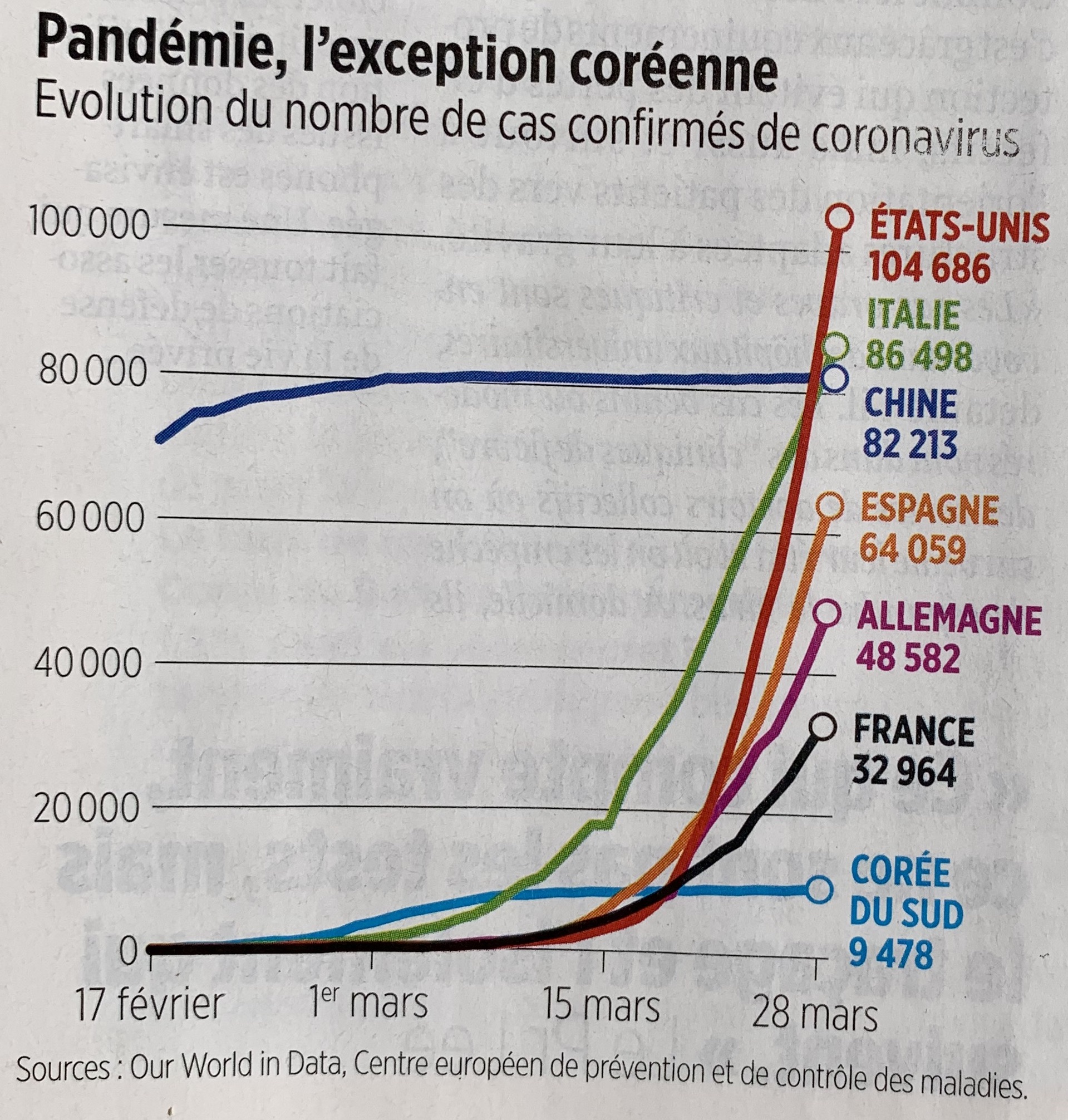En 71, les gestations cinématographiques d’Arrabal n’ont évidemment pas plu du tout à la censure française : alors que l’Espagne est encore sous le régime Franquiste, il ira tourner son film en Tunisie ; même chose pour L’arbre de Guernica quatre ans plus tard, continuation historique essentielle de son oeuvre qu’il ne pourra filmer qu’en Italie. Au risque de se délocaliser de son berceau (et bourreau), il conserve malgré tout cette âme méditerranéenne, ces campagnes lumineuses et arides où l’on rêve et meurt.
Dans Viva la Muerte, le petit Fando apprend que sa mère a fait arrêter son père – un « rouge »- pour ses idées politiques controversées : ouvertement auto-biographique, Arrabal dessine les contours d’une enfance meurtrie, malade (au sens propre comme au figuré), sans aucune concession. La figure maternelle (stupéfiante Nuria Espert) convoque douceur et sensualité d’une scène à l’autre, et se fait brutale lorsque le fanatisme latent reprend ses droits, celui-là même qui hante les rues d’un pays fascisant. Des notions qui redoublent avec un personnage de tantine illuminée, qui fait naître davantage les contradictions d’un univers étouffant et trouble, à l’érotisme moite et scabreux.
 Dans le rapport au corps, Viva la Muerte ne s’embarrasse d’aucune horreur, d’aucune gêne, d’aucune barrière : cette mise à nu évoluant dans un contexte à l’authenticité parfaitement dérangeante est traversée de séquences expérimentales, comme autant d’illustrations de « l’immontrable » ; à savoir des fantasmes enfantins gangrénés de pulsions de vie et mort. Dans ces scénettes saturées de couleurs baveuses, Arrabal arrose son spectateur d’images infernales, allant de la scatophilie, en passant par la torture, l’inceste, la nécrophilie, la castration, poussant le symbolisme dans ses retranchements les plus scandaleux comme son ami Roland Topor, à qui l’ont doit les dessins du générique (illustrant moult corps violés, transpercés, écartelés, ou couverts d’excréments).
Dans le rapport au corps, Viva la Muerte ne s’embarrasse d’aucune horreur, d’aucune gêne, d’aucune barrière : cette mise à nu évoluant dans un contexte à l’authenticité parfaitement dérangeante est traversée de séquences expérimentales, comme autant d’illustrations de « l’immontrable » ; à savoir des fantasmes enfantins gangrénés de pulsions de vie et mort. Dans ces scénettes saturées de couleurs baveuses, Arrabal arrose son spectateur d’images infernales, allant de la scatophilie, en passant par la torture, l’inceste, la nécrophilie, la castration, poussant le symbolisme dans ses retranchements les plus scandaleux comme son ami Roland Topor, à qui l’ont doit les dessins du générique (illustrant moult corps violés, transpercés, écartelés, ou couverts d’excréments).
Arrabal ne connaît guère les limites, les explosant lors de l’ultime vision libératrice où la mère de Fando vit une transe sanguinolente près de la carcasse d’un boeuf égorgé et castré face caméra (et… sans trucages). Un spectacle hallucinatoire, qui fascine par les moyens radicaux avec lesquels il bouscule son auditoire : une délicatesse derrière l’outrage qu’on capte au détour d’Ekkoleg, chanson d’ouverture et comptine danoise obsédante…
Là où le plus farfelu J’irai comme un cheval fou tentera d’aller encore plus loin dans la furie surréaliste (et il le prouvera !), L’arbre de Guernica se fait plus rigoureux : on est cependant bien chez Arrabal vu le contenu sulfureux de certaines images (verge brûlée au fer rouge, statues souillées de sperme ou d’urine, corrida humaine, nains crucifiés : Arrabal n’est pas un amateur de la retenue !) mais l’histoire prend place sur la provocation.
On assiste au branlebas de combat d’une petite ville nommée Villa Ramiro (agitée par la révolte des villageois républicains), non loin de Guernica, dont elle subira l’effroi du bombardement.
On sent qu’Arrabal est possédé par le désir de retranscrire la terrible histoire de son pays, quitte à se placer dans une optique… en spontanéité. Tout aussi rageur, mais plus lyrique (l’idylle d’un surréaliste et d’une sorcière aux yeux verts au coeur de la bataille arrondit les angles) et très passionnant… : Arrabal nous fait voir aussi bien dans l’intime que dans le spectaculaire sa vision du franquisme, sans jamais se répéter… Une oeuvre folle.