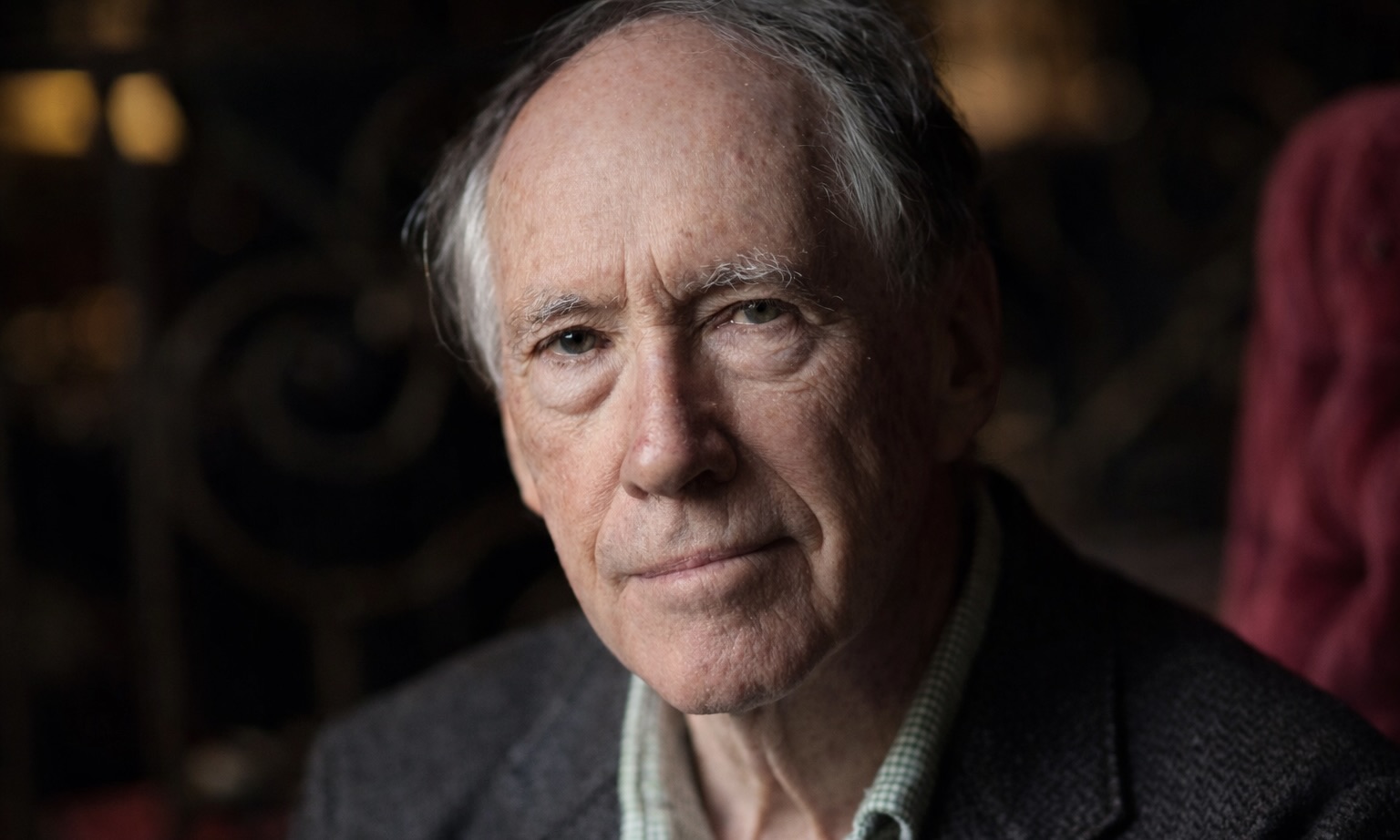Dans les années cinquante, alors que j’étais étudiant et découvrais la musique – pendant mon enfance, je n’en avais jamais entendu une seule note, ma famille étant indifférente à cet art : aucun disque chez nous, pas de phonographe, la radio ne servait qu’à prendre les nouvelles – dans les années cinquante, donc, les jeunes Français nourrissaient le plus grand mépris pour l’opéra italien ; adoptant d’ailleurs, sans le savoir, le point de vue des Allemands, selon lesquels il fallait tenir les Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, plus tous les véristes, pour des compositeurs bruyants et superficiels, sans technique sérieuse, dépourvus d’ambition, coupable d’avoir abâtardi l’art du chant. À partir de Mozart, le sceptre de la suprématie musicale était passé d’Italie en Allemagne : c’était là pour nous un article de foi. Barbier de Séville et Norma, Rigoletto et Bohème ? Œuvres privées de toute dignité artistique, buffonate bonnes à divertir les Arlequins et les Polichinelles de la péninsule, mais qu’une personne chérissant quelque idéal devait rejeter sans appel. Nous les condamnions en bloc – sans les connaître, bien entendu. Les seuls opéras que nous consentions à entendre et que nous apprenions à aimer, c’étaient ceux que nous jugions appartenir à la « grande musique », et que nous mettions sur le même plan que les passions de Bach ou les quatuors de Beethoven : soit l’Orfeo de Monteverdi, seul rescapé du cirque transalpin, les opéras de Mozart, Fidelio, Boris Godounov, Pelléas, Wozzeck. Tel fut, longtemps, tout mon bagage en matière de théâtre lyrique.
Je me rends compte aujourd’hui que j’obéissais inconsciemment, que nous obéissions tous a un préjugé qui, si j’avais continué à le suivre, m’aurait empêché d’écrire des romans. Que signifie en effet porter aux nues Monteverdi, Moussorgski, Alban Berg, et d’autre part dénigrer Verdi et Puccini ? C’est faire une distinction entre la « haute musique », la musique de « recherche », la musique exploratoire, savante, réfléchie, et la « basse musique », spontanée, vitale, plus immédiatement acclamée, plus facilement destinée à devenir populaire. Je ne dis pas que la « haute musique » ne puisse pas devenir populaire, ni qu’un Verdi ou un Puccini ne se soient pas livrés, eux aussi, à des expériences formelles audacieuses, je dis que, en gros, on peut distinguer deux familles de compositeurs d’opéras, selon qu’ils attachent plus d’importance à la théorie de leur art – ce sont les « réformateurs », de Monteverdi à Berg en passant par Gluck et Wagner – ou qu’ils se fient davantage à leur instinct, à leur vitalité – ce sont les « tempéraments », de Tchaïkovski à Darius Milhaud et à Benjamin Britten, avec, au premier plan, il va sans dire, les Italiens du XIXe siècle. Or – pour continuer cette classification, si sommaire soit-elle – comment ne pas être tenté d’appliquer une telle distinction à la littérature elle-même ? Parmi les écrivains, on reconnaîtra d’un côté ceux qui privilégient la recherche formelle, l’innovation dans l’écriture – et ce seront avant tout les poètes, les auteurs de proses courtes et rares – et d’un autre côté ceux qui préfèrent raconter des histoires sans trop se torturer sur la question de savoir comment les raconter – et ce seront les romanciers. J’entends par là non la descendance de Flaubert et de Joyce, race plus intellectuelle, soucieuse de purifier le texte de toute scorie étrangère à la littérature, mais les romanciers à la vitalité immédiate, puissante, presque sanguine, les Daniel Defoe, les Dickens, les Tolstoï, les Dostoïevski, les Balzac, les Dumas, les Hugo. Encore une fois, je ne dis pas que ces derniers ne se soient pas interrogés sur leur art, mais que l’art, la forme, l’écriture passaient au second rang de leurs préoccupations, emportés qu’ils étaient par le mouvement de la fiction. Pour clarifier les choses, prenons deux contemporains en France, comme Gide et Simenon, et deux autres en Amérique du Sud, comme Borges et Amado, et l’on conviendra que voici deux sortes de créateurs, séparés par une ligne de démarcation éclatante, l’espèce des spéculateurs et l’espèce des fonceurs, ceux qui se tiennent à distance de la vie, dans une aristocratique réserve, et ceux qui l’empoignent à bras-le-corps, les martyrs de la littérature et les champions du roman.
J’établis la même différence entre « littérature » et « roman » qu’entre « musique » et « opéra ». La littérature – entendue comme recherche et spéculation – et la musique – entendue comme travail sur les moyens d’expression – représentent la partie « noble » de l’art, alors que le roman et l’opéra en sont la partie impure, non noble, compromise avec la réalité, souillée par le contact avec la vie. Les gens, et ils sont encore nombreux aujourd’hui, qui disent aimer la musique mais détester l’opéra italien, exercent le même genre de discrimination que les amateurs de lecture pour qui un Balzac, un Zola, une George Sand font à peine partie de la littérature, et un Alexandre Dumas, un Jules Verne, un Traven pas du tout. Jeune, avant de commencer à écrire, je pratiquais une semblable dichotomie entre ce qui me paraissait « valable », digne d’appartenir au monde de l’art, et ce que je tenais pour simple divertissement, amusement sans valeur – quitte, d’ailleurs, à me sentir parfois incertain et déchiré, car mon roman préféré était déjà L’Île au trésor, et j’en avais un peu honte, convaincu qu’il ne pouvait s’agir là de « haute » littérature, puisque ce n’était, me disais-je avec dédain et en contradiction avec mon violent plaisir intérieur, qu’un roman d’aventures.
En musique, je faisais un départ encore plus rigoureux. J’allais écouter à la salle Gaveau l’intégrale des quatuors de Beethoven par le Quatuor hongrois, mais n’aurais jamais consenti à entendre une note de Rossini ou de Bellini. Ce parti pris était poussé si loin que, contrairement à ce qui m’arrivait pour Stevenson et Dumas, j’en venais à nier mon plaisir, ou, plus exactement, à me rendre sourd à ce que je ne voulais pas qui me causât du plaisir. Ainsi, me trouvant à Venise au mois de septembre 1951, de retour de Salzbourg où j’avais découvert, ébloui, Wozzeck dirigé par Karl Böhm, je pris un billet pour la Fenice, en pestant contre la nécessité de devoir écouter, pour avoir le droit de visiter le théâtre, une œuvre aussi calamiteuse et dégénérée que le Requiem de Verdi. Or, comme je l’ai appris par la suite, j’eus la chance inouïe d’assister à une exécution magnifique, une des plus belles de l’après-guerre. Chef : Vittorio de Sabata. Ténor : Giuseppe Di Stefano. Basse : Cesare Siepi. Soprano : Élisabeth Schwarzkopf. Eh bien ! j’étais si enfoncé dans mes préventions que je me rappelle fort bien m’être dit, en sortant : « Ce n’est pas de la musique religieuse, c’est de l’opéra ! », jugement empreint d’un profond mépris, comme si, au lieu d’avoir entendu un chef-d’œuvre de vocalité effusive, j’étais allé au cirque. Même Venise, même la magie d’un concert à la Fenice, n’avaient pu me délivrer de mon préjugé.
La conversion à l’opéra
Il fallut Naples, la vigueur et la gaillardise de Naples, pour m’amener à résipiscence. Ayant été envoyé dans cette ville, pour un long séjour, je m’aperçus que la seule activité culturelle y était l’opéra. Peu de librairies, presque aucune salle de concert, de rares cinémas ; on ne s’intéressait ni aux livres ni aux films, en revanche le San Carlo faisait salle comble. Une première tous les dix jours à peu près, en séance de gala, suivie de deux représentations ordinaires, à six heures de l’après-midi. Et presque uniquement des opéras italiens, de Cherubini à Zandonaï. Maugréant contre mon destin, je pris moi aussi l’habitude de me rendre au San Carlo, poussant le dépit jusqu’à me faire confectionner un smoking, qui était alors obligatoire pour le parterre et les trois premiers rangs de loges. Les six premiers mois passèrent sans que la grâce me visitât. Par exemple, dans Norma, qui fut chantée, je crois, par Anita Cerquetti, trop bref météore dans le firmament des étoiles, je ne fus pas sensible à la beauté de la mélodie, mais seulement au ridicule des druides et des processions. Raillerie étriquée de Français ricaneur. Enfin – c’était le 15 mars 1958, je n’oublierai jamais ce jour – on programma La Forza del destino. Encore du Verdi ! protestai-je in petto. Et, au vu du livret et de l’intrigue, du plus mélodramatique et mirlitonesque Verdi ! Pourtant, je fus vite subjugué. Je ne connaissais pas le nom des chanteurs, j’ignorais absolument à quel point ils étaient célèbres, aucun d’eux ne me disait rien. Mon impression, mon émotion furent immédiates, pures ; je fus converti d’emblée, à ce qui me parut être l’art suprême du chant, bouleversé en particulier par le duo entre Carlo et Alvaro, par la phrase si lyrique, si poignante d’Alvaro Or muoio tranquillo, vi stringo al cor mio, quelque chose d’équivalent au Lascatemi morire de Monteverdi, par les deux airs de Leonora, par son duo avec le Père gardien. Il faut dire que des intercesseurs exceptionnels avaient présidé à mon baptême. Je sus plus tard qui avaient été pour moi les messagers du bel canto italien. Il serait impossible aujourd’hui de réunir de pareils artistes : tout simplement, chacun était le meilleur au monde, à cette époque, dans son rôle. Franco Corelli, jeune alors, éclatant, en Alvaro ; Ettore Bastianini, le plus grand baryton de son temps, en Carlo ; Renata Tebaldi, à l’apogée de sa carrière, en Leonora ; Boris Christoff en Père gardien. Il n’y avait pas jusqu’aux rôles secondaires qui ne fussent tenus par des chanteurs de premier plan, Renato Capecchi pour Melitone, Oralia Dominguez pour Preziosilla.
Non seulement je fus converti à l’opéra, mais à une certaine manière de concevoir la représentation d’opéra. En effet, le San Carlo ne ressemble pas aux autres salles de théâtre. C’est Alexandre Dumas, le plus napolitain des écrivains français, qui l’a dit : « En France, on va au théâtre pour se montrer ; à Naples, on va à l’opéra pour jouir. » De nos jours, certes, les spectateurs du San Carlo ne se font plus apporter des glaces dans leurs loges pendant les airs jugés ennuyeux, appelés autrefois ario del sorbetto ; on a d’ailleurs supprimé les rideaux qu’on tirait devant sa loge quand l’opéra était décidément trop mauvais et qu’on voulait s’isoler de la salle pour jouer aux cartes, causer ou faire l’amour. Le public napolitain, néanmoins, reste exigeant sur son plaisir, c’est-à-dire irrespectueux des conventions ; il bavarde en pleine représentation si celle-ci l’embête ; il chantonne avec une demi-seconde d’avance les airs qu’il préfère ; il s’enthousiasme au-delà de toute mesure. Quand Renata Tebaldi eut achevé l’air du dernier acte Pace, pace mio Dio, un tonnerre d’applaudissements se déchaîna ; puis, dans la brève minute de silence qui précéda la reprise, on entendit une voix crier, du poulailler : Sei un angelo ! Nouveau délire d’ovations. Voilà ce que j’ai appris ce soir-là : non seulement à aimer et à placer au premier rang des compositeurs Verdi, mais à chercher dans l’opéra autre chose qu’un sujet de dévote et culturelle admiration. Oui, c’est par une sorte de plaisir physique que j’ai adhéré pour la première fois à un opéra, et, depuis ce temps, il n’y a pas d’opéra que j’aime où je n’aie retrouvé ce plaisir physique, cette liberté du corps – qui commence, si le spectacle me barbe, par la liberté de quitter la salle au premier entracte.
Voilà une des raisons pour lesquelles j’éprouve une répugnance invincible contre Wagner, le wagnérisme et le culte de Wagner, caractérisés par la prétention de transformer le spectacle en messe, par la componction imposée au spectateur, de qui on exige une idolâtrie religieuse, par la sacralisation du théâtre en temple, toutes choses où je vois la négation du véritable esprit de l’opéra, qui est espiègle et frondeur. Où sont le jeu, le plaisir, l’humour, dans la représentation d’un opéra de Wagner ? Le public, que cela lui plaise ou non, est sommé de garder un mortel sérieux. Certes, il est facile de comprendre pourquoi Wagner a voulu cette réforme dans l’opéra ; en bon Allemand, il aurait dû – comme Beethoven, comme Schumann, comme Brahms avant lui, comme Bruckner et Mahler après lui – n’écrire que des symphonies et des quatuors, se tenant au large de ce genre impur qu’est le théâtre lyrique, laissant l’opéra à ces buffoni d’Italiens. Mais comme ses dons le portaient vers le théâtre et la musique vocale, il crut résoudre la contradiction en transformant ce genre impur en genre pur, ce passe-temps vulgaire en musique, par la magie d’un cérémonial pompeux autant que par le choix de sujets nobles. Pour moi, il n’a fait que dévoyer l’opéra. Je note aussi que la réputation de musiciens « inférieurs » faite aux Rossini, Donizetti, Verdi, ce que j’ai appelé plus haut le point de vue des Allemands, date justement de Wagner et des wagnériens, qui ont essayé de discréditer la conception ludique, familière, chaleureuse de l’opéra pour imposer la leur, affreusement lourde et ennuyeuse.
L’esprit napolitain contre celui de la NRF
Distinguer un opéra de nature inférieure, qui serait l’opéra italien, et un opéra de nature supérieure, qui serait l’opéra wagnérien, c’était tenter une opération politique, une opération de racisme musical, qui a en général fort bien réussi. Sauf à Naples. Naples, qui m’a non seulement initié à l’opéra italien mais conforté dans mon intention, vague encore et encombrée de réticences, de remords, d’écrire des romans. En effet, j’avais été élevé dans l’atmosphère littéraire de La Nouvelle Revue française, et cette chapelle, comme on sait, tolérait à peine le roman. Albert Thibaudet, une des consciences critiques de la revue, avait fort bien établi l’origine impure du roman, né au XVIIe siècle comme fourre-tout où les écrivains pouvaient mettre tout ce qui ne tenait pas dans les genres considérés alors comme nobles, la poésie, la tragédie, l’éloquence. Il faut être un peu pauvre d’esprit pour écrire des romans, suggérait Valéry, s’il est vrai, comme André Breton le rapporte, qu’il se proposait de réunir en anthologie un grand nombre de débuts de romans, « de l’insanité desquels il attendait beaucoup ». En ce qui le concerne, ajoutait Valéry, il se refuserait toujours à écrire La marquise sortit à cinq heures[1]. Aucun interdit littéraire n’a fait plus de dégâts que cet oukase prononcé par une bouche si auguste. On ne voit pas où serait le génie du roman, sinon dans l’audace d’écrire La marquise sortit à cinq heures, dans l’arbitraire héroïque qui consiste à poser sur le papier une phrase bête de tous les jours, qui devient, par la magie de l’écriture romanesque, le moteur de l’action et le port d’embarquement pour un nouveau monde. André Gide, peut-être sous l’influence de son ami, n’écrivit pas de romans, mais des « récits », des « soties », des « traités » ; il ne consentit, non sans beaucoup d’hésitations et de chichis, à appeler « roman » qu’un seul de ses nombreux livres, Les Faux-Monnayeurs. Jean Paulhan, directeur de la NRF avant et après la guerre, éminence grise des lettres françaises pendant plus de quarante ans, ne se serait jamais abaissé à écrire un roman. Marcel Arland, codirecteur de la revue après la guerre, n’écrivait, lui, que des romans et des nouvelles, mais il donnait l’impression d’en avoir un peu honte. Or, c’est dans la NRF, justement, et sous la direction de Paulhan et d’Arland, que j’ai publié mes premiers articles, que j’ai fait mes premiers pas officiels dans la littérature ; décidé déjà à écrire un jour des romans, certes, mais persuadé, par tous ces mentors illustres, Thibaudet, Jacques Rivière, Valéry, Valéry Larbaud, Gide, Paulhan, que c’est là une besogne de second rang, une récréation dont il ne faut pas trop se vanter. L’essai, la note, la notule, la chronique, le fragment de journal, le « propos » à la manière d’Alain, le « rhumb » ou la « pièce » à la manière de Valéry, le poème bien sûr, tels étaient les genres tenus en honneur à La Nouvelle Revue française ; on avait le droit de s’aventurer dans le roman, mais un fort sentiment de culpabilité vous accompagnait dans cette entreprise. On a peine à s’imaginer aujourd’hui le pouvoir d’intimidation qu’exerçait, dans les années cinquante encore, la rue Sébastien-Bottin sur un apprenti écrivain. Moi, c’est Naples, la vitalité puissante et colorée de Naples, le caractère naturellement romanesque de cette ville, qui me délivra du puritanisme parisien. Je continuai, pendant mon séjour napolitain, à envoyer des articles et des chroniques à la revue de Paulhan et Arland, mais non sans commencer à douter de la validité de ses critères esthétiques. De même que je découvrais en Verdi le contraire du cabotin pour auditeurs sous-développés qu’on m’avait présenté à Paris, de même il m’apparut qu’exclure le roman de la littérature était un ostracisme décidé par des esprits affectés de rétention littéraire, dépourvus de générosité, frileux, repliés sur eux-mêmes et pour tout dire moins admirables que je n’avais cru.
Le hasard avait donc voulu que me fussent révélées en même temps et la qualité musicale de l’opéra italien et la nécessité littéraire du genre romanesque. Rien d’étonnant, dans ces conditions, si mon premier roman a pris pour sujet le monde de l’opéra italien et pour personnages des chanteurs d’opéra, et si, pour rendre hommage à la ville qui m’avait apporté cette double révélation, j’ai situé ce roman à Naples. En vérité, j’en avais écrit trois auparavant, mais tous trois assez gauches, il me semble, enveloppés, hésitants, marqués de cette culpabilité que j’ai dite à l’égard du genre romanesque ; manqués pour d’autres raisons aussi, bien sûr, tenant à mes problèmes psychologiques et sexuels personnels ; mais l’influence, même lointaine et discrète, d’une esthétique entêtée à maintenir l’œuvre d’art à l’écart et au-dessus de la vie avait eu sa part dans le manque de confiance et d’entrain avec lequel j’avais écrit ces premiers romans. Pour souligner le changement survenu, je donnai à Porporino un sous-titre exprès provocateur, en cette époque – c’était l’année 1974 – où le Nouveau Roman, surgeon exténué de l’arbre NRF, quintessence du jansénisme et de l’élitisme littéraires, sévissait encore. Porporino, ou les mystères de Naples. Allusion au roman d’aventures, clin d’œil au roman feuilleton du XIXe siècle. Hélas ! je n’aurais pas été capable d’écrire un vrai roman d’aventures, à la Dumas, à la Eugène Sue ; je crois que notre siècle ne possède plus la naïveté nécessaire à ce genre d’entreprise ; nous avons trop lu ; la confiance dans l’homme, l’optimisme étaient la première condition du roman à la Dickens, à la Hugo. Proust, Kafka, Faulkner nous feraient honte de croire qu’on peut échapper à la fatalité de l’échec ; les événements politiques, les guerres, les tyrannies, les horreurs de notre siècle ne leur ont donné que trop raison. Porporino se termine par une catastrophe, par la mort rituelle du héros, selon l’idéologie pessimiste à laquelle nul n’échappe aujourd’hui. D’ailleurs, pour être sincère, ce n’est pas un roman d’aventures que je voulais écrire ; le sous-titre n’était qu’une indication polémique, et une incitation que je me donnais à moi-même pour mettre de l’action dans mon livre, pour le guérir du virus de l’analyse psychologique, de l’introspection. Mon vrai modèle, c’était l’opéra ; l’opéra italien ; et plus, particulièrement, l’opéra napolitain. Oui, j’ai voulu, avec Porporino, rivaliser avec l’opéra, écrire un opéra en mots ; non pas, selon la formule des symbolistes, reprendre à la musique son bien, c’est-à-dire, comme ils l’entendaient, épurer le langage jusqu’à en faire l’équivalent immatériel et impalpable de la musique (pour eux la musique de chambre ou symphonique, évidemment), mais au contraire plonger le roman dans la même réalité chaleureuse, pulpeuse, chatoyante, joyeuse que j’avais découverte au San Carlo.
D’abord, le sujet. L’éducation et les débuts de deux chanteurs d’opéra napolitains, au XVIIIe siècle. Pourquoi au XVIIIe siècle ? Parce que ce fut l’âge d’or de l’opéra napolitain. En passant, j’avais envie de réhabiliter une époque féconde en compositeurs aujourd’hui injustement oubliés, tels que Porpora, Jomelli, Traetta, Durante, ou même le Pergolese et le Cimarosa de l’opera seria, escamotés au profit de la Serva padrona et du Matrimonio segreto. Le XVIIIe siècle est aussi l’époque où une représentation d’opéra était plus libre, où le roi Ferdinando, Re Nasone, donnait l’exemple en se faisant servir dans sa loge un plat de macaronis fumants. J’ai indiqué en Wagner le responsable de la sacralisation de l’opéra ; à vrai dire, il faudrait remonter plus haut, aux années trente du XIXe siècle, lorsque l’esprit romantique commença à supplanter l’insolence et la désinvolture propres au siècle précédent. Les romantiques étaient terriblement sérieux ; ils croyaient au progrès, à l’émancipation de l’humanité ; ils voulaient que dans les opéras aussi l’auteur lançât un « message », fraternel et contagieux ; en Italie, par la plume de Mazzini, ils sommèrent les compositeurs de renoncer aux comédies de mœurs et aux sujets d’amour, et de prendre en compte qu’ils avaient une mission, politique et éducatrice, à remplir. Le mépris du jeune Berlioz, pensionnaire à la Villa Médicis, pour la musique italienne de son temps, n’a pas d’autre origine que la maturation en lui d’une conscience romantique de cette sorte. Et quant à Rossini, typique survivant du XVIIIe siècle, homme de jeu et de plaisir, son retrait des scènes à partir de 1829 n’a rien d’énigmatique, mais s’explique fort bien par l’avènement des grandes machines politico-historiques à la Meyerbeer. Rossini pouvait faire aussi bien, dans le genre sérieux et grandiose, il l’avait prouvé avec Guillaume Tell ; mais si la musique devait se mettre dorénavant au service d’une cause, devenir propagandiste et oraculaire il préférait se retirer de la musique et se consacrer au tournedos.
Cette romantisation de l’opéra eut une influence profonde, qui me paraît assez peu étudiée jusqu’ici, sur la forme même de l’opéra. Un rapide examen comparatif de la structure de l’opéra au XVIIIe et au XIXe siècle me ramènera à Porporino et à ma propre conception du roman. Pendant tout le XVIIIe siècle, Rossini compris, deux catégories de formes musicales entraient dans la composition d’un opéra : il y avait d’une part le récitatif, sec (soutenu uniquement au clavecin) ou accompagné (par l’ensemble de l’orchestre) ; d’autre part les airs, duos, trios ou ensembles vocaux plus importants. Le récitatif était récité, c’est-à-dire simplement dit, comme au théâtre ; alors que les airs étaient chantés. Le récitatif appartenait au genre de la prose et du théâtre ; les airs, au genre de la poésie et de l’opéra. Ces deux catégories de formes, et j’en viens au point important, avaient des fonctions très différentes. Le récitatif, dont chaque syllabe était distinctement perçue par le public, servait à l’informer sur le déroulement de l’action, à faire le point dans l’enchevêtrement de l’intrigue, à établir la continuité et la cohérence de l’œuvre. Les airs au contraire, duos, trios, etc., dont le public ne saisissait que quelques mots dame enrobage musical, n’avaient pas trait au sens ; c’étaient les moments réservés à l’émotion. L’action s’arrêtait ; et, pendant cette pause de l’action, le ou les chanteurs exhalaient leur chagrin ou leur joie, leur déception ou leur surprise, leurs peines ou leurs bonheurs, Peu importait le contenu de ce qu’ils exprimaient ; seule comptait l’intonation générale, le climat affectif de l’air, donné par la mélodie, et qui permettait au public de s’identifier au héros, d’être triste ou gai avec lui. Les romantiques condamnèrent ce système, le jugeant artificiel et contraire à la vérité profonde de l’être humain, lequel, lorsqu’il est en proie à un sentiment, s’y livre tout entier. S’arrêter soudain de chanter pour reprendre la conversation, parut aux partisans de l’opéra total une incongruité de l’ancien régime : d’où leur volonté de supprimer les récitatifs, d’abord le sec, puis l’accompagné, et de faire du spectacle lyrique un continuumchanté, doctrine qui aboutit au durchcomponiert allemand : tout pour l’émotion, rien pour la raison.
Il me semble que pour un romancier, l’ancienne conception de l’opéra est plus riche d’enseignement. Si l’on peut admettre que dans un spectacle musical l’histoire racontée est tout à fait secondaire, dans un roman, qui fait appel bien plus à la raison et à l’intelligence du lecteur, comment garder la place nécessaire à l’information, sans nuire à l’unité esthétique de l’œuvre ? Comment faire avancer l’histoire, sans renoncer à la qualité poétique de l’ensemble ? Comment dire ce qu’il importe de dire, sans tomber dans le didactisme ? Balzac n’a pas toujours trouvé la solution ; ses livres renferment comme des plages mortes, où l’excès de renseignements fournis au lecteur l’empêchent d’être ému. Même dans un roman aussi réussi que Les Illusions perdues, on regrette de voir tant de pages purement didactiques sur le fonctionnement d’une imprimerie.
De cette difficulté, inhérente au genre romanesque, un autre romancier s’est tiré avec beaucoup plus de bonheur, parce qu’il connaissait beaucoup mieux et aimait beaucoup plus l’opéra : Stendhal, le grand admirateur, justement, de Rossini. Je crois qu’on pourrait relire Stendhal à la lumière de Rossini et découvrir dans Le Rouge et le Noir, dans La Chartreuse de Parme, dans Armance, une alternance entre récitatifs et airs, entre moments d’action et moments de rêve, comme dans Le Barbier de Séville ou Tancredi. Le récitatif informe le lecteur de ce qui se passe, mais en même temps il ne cesse pas d’être musique, il fait partie de la musique de l’œuvre ; c’est de la musique plus articulée, plus raisonnée, mais c’est encore de la musique. Découpés eux aussi en récitatifs et en airs, les opéras de Mozart offrent l’exemple insurpassé d’harmonie, de fusion entre l’intelligible et l’affectif, satisfaisant l’esprit autant qu’ils touchent le cœur. Rossini, Mozart : tels sont quelques-uns des modèles auxquels moi, en tout cas, je me suis référé en écrivant Porporino et les romans qui ont suivi. La distribution entre action et émotion, principe fondamental et pierre d’achoppement de tout roman, s’est faite selon l’alternance entre passages plus parlés et passages plus chantés – mais je ne voudrais pas faire croire à une organisation systématique de mon travail. Ennemi de toute théorie, me guidant plutôt sur un instinct musical de la mesure et du contrepoint, j’ai d’abord obéi à mon oreille : tantôt accélérant le rythme quand il ne s’agissait que de tenir le lecteur au courant des événements, tantôt le ralentissant pour laisser le temps aux personnages d’épuiser la valeur émotive d’un moment donné.
La division des sexes
Porporino et Feliciano ne sont pas seulement deux chanteurs d’opéra : ce sont aussi, ce sont d’abord, deux castrats. Pourquoi ce choix de personnages dit « anormaux » ? Il y a une première raison, historique. Quand j’ai pensé à écrire un roman sur le monde de l’opéra napolitain au XVIIIe siècle, je me suis heurté à un obstacle en apparence infranchissable : m’étant aperçu que l’opéra à cette époque était dominé par les castrats, que les divas du XVIIIe siècle n’étaient ni les femmes, cantonnées dans des rôles secondaires, ni les ténors, encore plus insignifiants, mais bien les castrats, qu’à beaucoup d’entre eux avaient échu des carrières fabuleuses, je découvris en même temps que ces monstres de légende appelés Farinelli, Caffarei, Sensino, Crescentini, Siface, Velluti, Aprile et tant d’autres avaient disparu soudain de la mémoire des hommes, que de ces superstars il ne restait aucune trace dans l’histoire, qu’il était impossible de trouver le moindre document, ni sur leurs performances vocales ni sur leurs désordres amoureux. Ils s’étaient purement et simplement volatilisés, victimes de la censure, autour de l’année 1800. L’Europe, soumise à l’influence des nouvelles idées révolutionnaires sur les droits de l’homme et la liberté, eut tout à coup honte d’avoir applaudi pendant deux siècles des garçons qu’on avait mutilés pour leur conserver leur voix d’enfant. Non seulement on cessa de châtrer, mais on cessa de parler des castrats, on cacha ou détruisit les documents qui auraient pu témoigner de leur gloire, leur souvenir fut refoulé pour toujours. J’étais sur le point d’abandonner mon projet d’écrire un roman sur les castrats napolitains, lorsque je m’avisai que cette absence de témoignages constituait au contraire une chance inouïe pour le romancier, lequel n’aurait pas à reproduire la réalité, mais à la réinventer ; et c’est ce que j’ai fait, imaginant de toute pièce, d’après mon expérience des rues, des bruits, des odeurs, des mœurs de la Naples contemporaine, la vie des castrats d’autrefois : non pas une reconstitution, donc, mais une recréation, selon la conviction, qui devint mienne alors, que seuls les romanciers peuvent écrire l’histoire, car la vérité réside non pas dans les faits, mais dans l’imagination des faits.
J’avais un autre motif, évidemment, pour m’intéresser aux castrats ; un motif puissant, un motif personnel. Qui étaient-ils, ces chanteurs, lorsque, étant sortis du théâtre, ils se retrouvaient seuls avec eux-mêmes, loin des feux de la rampe et du fracas des acclamations ? Se sentaient ils hommes ? Se sentaient-ils femmes ? À quel sexe pensaient-ils appartenir ? Peut-être aux deux ? Passionnant problème d’identité sexuelle et d’identité tout court, qui a été le vrai moteur de mon travail. Il m’est apparu que le monde de l’opéra avait gardé bien plus vives que dans les romans la conscience et la nostalgie de l’indifférenciation sexuelle, de cette indétermination des origines à laquelle se rattachent les plus vieux mythes de l’humanité, de la Bible à Platon, des mythes orphiques de la création du monde aux rites d’initiation dans les sociétés primitives.
L’opéra et le roman sont nés en Europe à la même époque, au même moment, au début du XVIIe siècle. 1607, par exemple, est la date à la fois de l’Orfeo de Monteverdi et de la première partie de L’Astrée d’Honoré d’Urfé. Je ne sais si cette liaison a été assez remarquée, et si l’on a souligné les points de ressemblance et de divergence entre ces deux genres rigoureusement contemporains. En simplifiant beaucoup, disons qu’au XVIIe siècle, surtout en France et en Angleterre, prend son essor une nouvelle classe, la bourgeoisie ; que cette nouvelle classe cherche à imposer peu à peu une nouvelle morale, fondée sur l’ordre, le rendement, l’efficacité dans le travail, et sur la discipline dans la vie privée ; et que l’instrument de cette nouvelle idéologie sera justement le roman. Que racontent les romans, en effet, dès la naissance du genre romanesque ? Des histoires d’amour, des histoires d’hommes et de femmes qui s’aiment et cherchent à se rejoindre à travers mille obstacles. Simple truisme, objectera-t-on, que de décrire ainsi l’art du roman ? Non, car ce qu’on oublie trop souvent de remarquer, c’est qu’une telle façon de raconter des histoires suppose comme une donnée évidente, dont on ne discute même pas, le fait qu’il y a d’un côté les hommes et de l’autre côté les femmes. Lorsque je définis la morale bourgeoise par le souci d’introduire la discipline dans la vie privée, je n’entends nullement dire que le roman est né avec l’intention de raconter des histoires édifiantes, à l’eau de rose ; c’est plutôt le contraire qui s’est produit, et surtout au siècle suivant, le XVIIIe, fertile en récits d’aventures dissolues et « immorales ». La morale, la solide morale bourgeoise, était pourtant là, bien présente au cœur du dévergondage ; elle était dans l’affirmation, inlassablement répétée par les romanciers, qu’ils fussent chastes ou libertins, décents ou coquins, puritains ou débauchés, que l’un s’appelât Rousseau et l’autre Sade, qu’hommes et femmes appartiennent à deux camps distincts. Voilà la discipline, voilà l’ordre que la nouvelle classe, classe d’affaires, classe réaliste, imposa par le truchement de ses romanciers : une stricte répartition des rôles sexuels, l’établissement d’une ligne de démarcation bien précise entre la virilité et la féminité. D’un côté les hommes, de l’autre côté les femmes, sans confusion possible. Pendant tout le XVIIIe et le XIXe siècle, jusqu’à Proust et Thomas Mann, le roman n’a eu qu’une mission, qu’une fonction, de proclamer, de célébrer, d’orner de mille détails piquants ou graves, lyriques ou graveleux, le principe sacro-saint de la division des sexes, nécessaire au développement de l’économie. Rares furent les auteurs, comme Casanova, qui osèrent contester un tel postulat.
L’opéra, au contraire, malgré une apparente ressemblance (histoires d’amour, et uniquement histoires d’amour), garda intacte la tradition de l’androgynie mythique ; d’abord en choisissant pour héros-types des personnages de l’Antiquité qui furent notoirement des hommes-femmes, Hercule, Achille, Alexandre, César et, premier d’entre eux, Orphée, élu par les pionniers du genre (Jacopo Peri, 1600 ; Giulio Caccini, 1602 ; Monteverdi, 1607) et plus tard par le champion de la réforme Gluck (1762) ; ensuite, et surtout en employant, en valorisant, en exaltant les castrats, ces créatures à la sexualité ambiguë et légendaire. Des castrats interprétèrent le rôle d’Orphée (on connaît leur nom : Giovanni Gualberto pour Monteverdi, Gaetano Guadagni pour Gluck), les rôles d’Hercule, Achille, Alexandre, César, puis, peu à peu, tous les premiers rôles du répertoire. La vogue des castrats, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, peut être considérée comme le symptôme le plus éclatant de la résistance contre le progrès de l’esprit bourgeois. La France, où cet esprit bourgeois était le plus fort, fut le seul pays où les castrats ne furent ni appréciés ni invités. Gluck, pour les représentations parisiennes, dut adapter le rôle d’Orphée à la voix de ténor. Partout ailleurs en Europe, l’opéra par le moyen des sopranistes, comme on les appelait élégamment, sut préserver le mythe des hommes-femmes, non sans braver les exigences du capitalisme naissant. Tandis que le roman se mettait au service de la pensée rationnelle et obéissait à Descartes, l’opéra, royaume de l’utopie et de la chimère, demeurait fidèle à Platon.
La transgression des normes
On pourrait objecter, ici, que la vogue des castrats ne fut affaire que de mode musicale, et qu’il ne faut pas attribuer une importance symbolique excessive à un usage commandé par le goût des belles voix. Je crois au contraire posséder de solides arguments pour prouver qu’il est dans la nature de l’opéra de rejeter la division bourgeoise des sexes et de tendre à perpétuer le paradis originel de l’indifférenciation. Quand, sous l’effet de la censure, les castrats eurent disparu, les compositeurs trouvèrent aussitôt la parade, chacun avec son tempérament particulier. Rossini inventa le contralto féminin, la femme à voix masculine. Bellini confia le rôle de Roméo à un soprano féminin, en sorte que Roméo et Juliette, dans son opéra I Capuleti e i Montecchi, sont chantés par deux personnes du même sexe. De nos jours, Britten, pour suggérer l’union des sexes dans une seule voix, a employé soit des hautes-contre soit des garçons avant la mue, les fameux trebles anglais. Le procédé le plus fréquent reste celui des baroques, de Haendel, de Mozart. Rinaldo, le preux guerrier de la croisade, chanté par une femme. Chérubin, le jeune polisson, chanté par une femme. Richard Strauss développa toutes les implications ambiguës du travesti dans le personnage d’Octavian, du Rosenkavalier, jeune garçon chanté par une femme, puis quittant ses habits d’homme pour se déguiser en femme, et cru femme par le baron d’Ochs, devant le public qui sait qu’elle est censée être un garçon. Quiproquos en chaîne, comédie d’une transsexualité troublante.
Mieux encore : chez les compositeurs qu’on peut le moins soupçonner de complaisance pour l’homosexualité, on trouve des personnages de travestis. Glinka confie à un contralto féminin le rôle de Vania, fils adoptif du paysan Ivan Soussanine, dans La Vie pour le tsar, opéra de la terre et de la fidélité à la terre et à la patrie, œuvre dépourvue de toute inclination esthétisante. Verdi, le rude et sévère prophète du Risorgimento national, confie le rôle du page à un soprano féminin, dans Un ballo in maschera. Smetana, lui aussi un patriote et l’artisan de la renaissance de la musique tchèque, attribue le rôle du neveu Zavis à un contralto féminin dans Le Mur du diable. Janacek, le solitaire de Brno, le provincial à l’abri de toutes les tentations de la « décadence » fin de siecle, assigne à un soprano féminin le rôle du jeune bagnard, Alieia, dans De la maison des morts, ce qui colore d’une indiscutable tendresse particulière la relation du jouvenceau et de son compagnon de chaînes Petrovitch. Je pourrais multiplier les exemples. À quoi bon ? II me paraît clair que l’opéra, grâce aux privilèges de la vocalité équivoque, détient des pouvoirs refusés au roman, lequel n’a le choix qu’entre deux solutions également brutales, hétérosexualité ou homosexualité. Le Banquet, avec le discours d’Aristophane sur les sphères originelles qui réalisaient, avant la malédiction de la coupure, la fusion parfaite du masculin et du féminin, nous avait ouvert d’autres horizons.
C’est dans cet espace de rêve et de mythe que j’ai essayé de glisser Porporino et les romans qui ont suivi. Je dois donc beaucoup à l’opéra, et surtout à l’opéra italien. D’abord parce qu’il m’a appris à ne pas considérer comme vulgaire la curiosité des choses de la vie, à sortir de ma tour de papier, à renoncer à isoler l’écriture, sous prétexte de mieux la servir, dans une zone abstraite de pureté formelle et anémiée ; ensuite parce que, seul genre qui permette une représentation artistique de l’androgynie, il encourage le romancier à transgresser les normes et les tabous de son temps.
[1] Cité dans le Manifeste du surréalisme, et confirmé par un fragment des Cahiers de Paul Valéry lui-même (Pléiade, II, p. 1162).