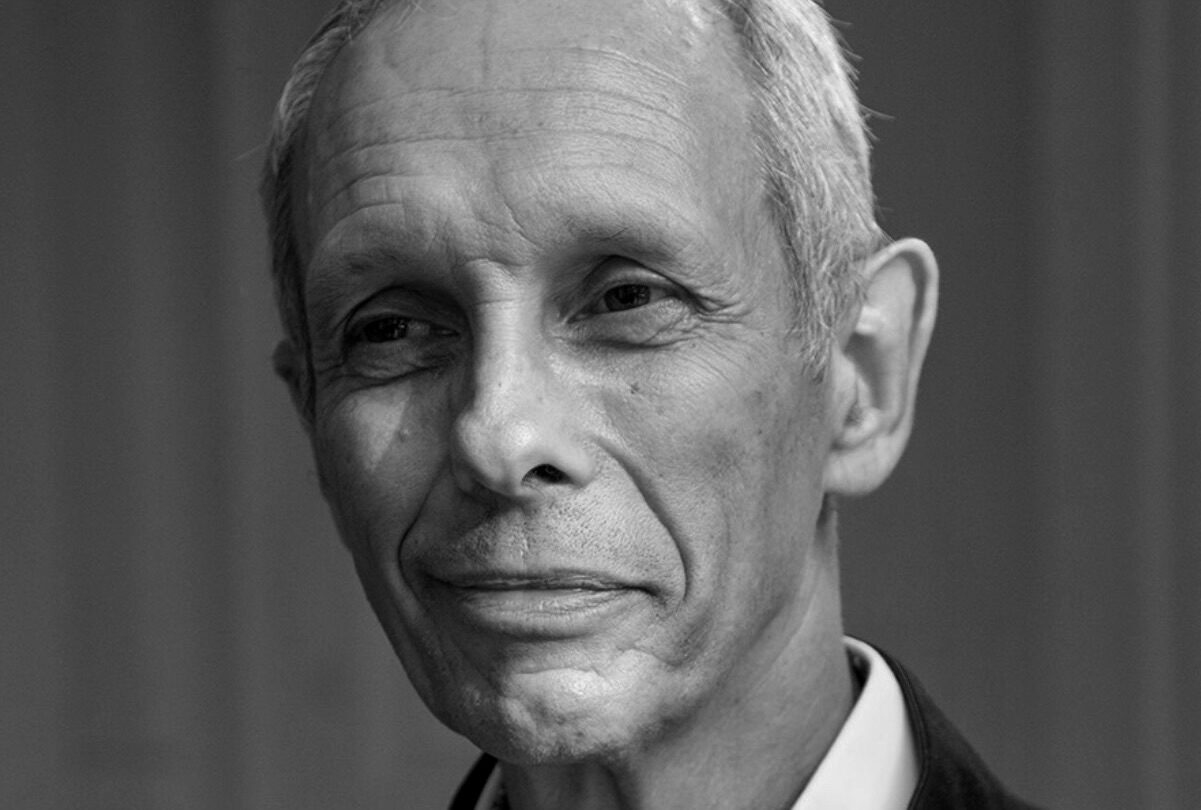Dominique et Gisèle appelons-les par leur prénom, puisqu’ils sont devenus familiers depuis que le procès a ouvert ses portes au public. De leur vie, on connait tout ou presque, désormais ils font partie de notre intimité. Ils forment un couple heureux dit-on, caché derrière la banalité d’une vie conjugale ordinaire. Dominique est le portrait du bon père de famille qui aime sa femme et ses enfants. Et voilà que tout à coup l’impensable surgit, cet homme fait chaque semaine violer sa femme à son insu en la droguant de médicaments durant plus de dix ans. Premier renversement ; la représentation que l’on se fait du viol : un acte banal, violent, commis « sans violence » par un bon mari qui peut être votre voisin ou votre ami. L’horreur pourrait s’arrêter là, le fait divers aussi. Deuxième renversement, le procès change la donne et redistribue les cartes. Contre toute attente, Gisèle demande des plaidoiries à ciel ouvert acceptée par le juge. Désormais son apparition fait l’évènement et non plus l’horreur des crimes commis. Stoïque et fière elle affronte les regards et défie la honte qui cette fois change de camp. Devenue chose publique, la cité s’empare de cette affaire ; récupérée par les médias, la presse, la politique, les sociologues. Chacun y va de son analyse, de son témoignage, de son commentaire.
La psychanalyste Elisabeth Roudinesco souligne la dimension perverse des actes commis et le déni des accusés en le comparant à celui des nazis d’Auschwitz. Cette interprétation psychopathologique minimise à mon sens sa dimension systémique et psychanalytique. Certes, Dominique Pelicot peut être qualifié de pervers au sens clinique, mais certainement pas les 50 autres accusés. Il est le seul vrai pervers de l’histoire qui manipule le corps de sa femme, orchestre le scénario et mène le jeu, les autres ne sont que de pions sur son échiquier. Des hommes sous l’emprise de son dispositif pervers, ce qui ne les innocente en rien. Même si la plupart des accusés ont grandi dans un univers instable où ils ont subi des violences tant physiques que psychiques, morales, et aussi sociales qui les prédispose à un terrain psychique fragile, voire borderline, ce ne sont pas des pervers. Non, ils sont avant tout des hommes.
Mais qu’est-ce qu’être un homme alors me direz-vous ?
Peut-être un certain rapport à ses pulsions aux origines de la masculinité et à ce que Freud nommait pulsion d’emprise, qui vaut pour les deux sexes, mais différemment, car chez les femmes, elle trouve un exutoire dans la maternité tandis que l’homme demeure dans une quête insatiable. En ce sens on peut dire que son besoin de dominer est une expression de son impuissance à canaliser cette dite pulsion en l’exerçant sur le corps féminin, que le patriarcat légitime en tant que système de domination. Et c’est là où réside la banalité du mal : dans ce monde qui autorise implicitement cette négation de l’altérité du féminin dont le viol n’est qu’un effet patent.
Une société a aussi les hommes qu’elle fabrique, les hommes qu’elle mérite. La cyber-pornographie qui exhibe des corps de femmes réifiés produit cette masculinité toxique encouragée par le discours capitaliste. Comment alors s’y repérer dans ce jeu des pulsions entre un monde virtuel sans limites et un ordre social où le symbolique ne fonctionne plus ? Quand on a grandi dans ce que les féministes nomment à juste titre culture du viol, il me semble difficile de pouvoir admettre la notion de consentement, et cela ne relève pas du déni à mon sens. Ces hommes ont préféré s’en prendre à un corps de femme parce que c’était à la portée d’un clic quasi anonyme et sans risques. Parce que la société le permet, le tolère et ferme les yeux et que le déni pervers se situe à cet endroit et pas seulement du coté des accusés.
Lâcheté masculine d’un côté et hypocrisie sociale de l’autre. A cela manque un troisième terme avec lequel il faudra désormais compter : la loi d’Antigone.
Dans un renversement logique on pourrait poser les termes ainsi : à quelle pulsion ont-ils consenti ce jour-là, quand dans leur vie ils parvenaient tant bien que mal à se contenir ? Car ce sont eux, les hommes, et non seulement les femmes qui devraient réfléchir sur ce mot : à quoi consent-ils quand ils se livrent à un viol, de quel lieu s’autorisent-ils, si ce n’est d’un discours qui conçoit la soumission des femmes comme un moindre mal ? Mais voilà, la roue tourne et ces moindres mâles finissent aujourd’hui sous les verrous. Peut-être aussi grâce à notre nouvelle Antigone nationale, alias Gisele Pelicot : Héroïne au désir pur qui ne recule devant rien, pas même devant l’entre-deux-morts de son tribunal. Contrairement à l’héroïne de Sophocle, elle a su subvertir la loi de Créon en enflammant la cité.
Retournée comme un gant. Tel est pris qui croyait prendre, mais la morale de l’histoire ne s’arrête pas là.
Si seulement Créon pouvait sauver Antigone.
Rêve impossible ? L’avenir le dira, mais il est en marche.