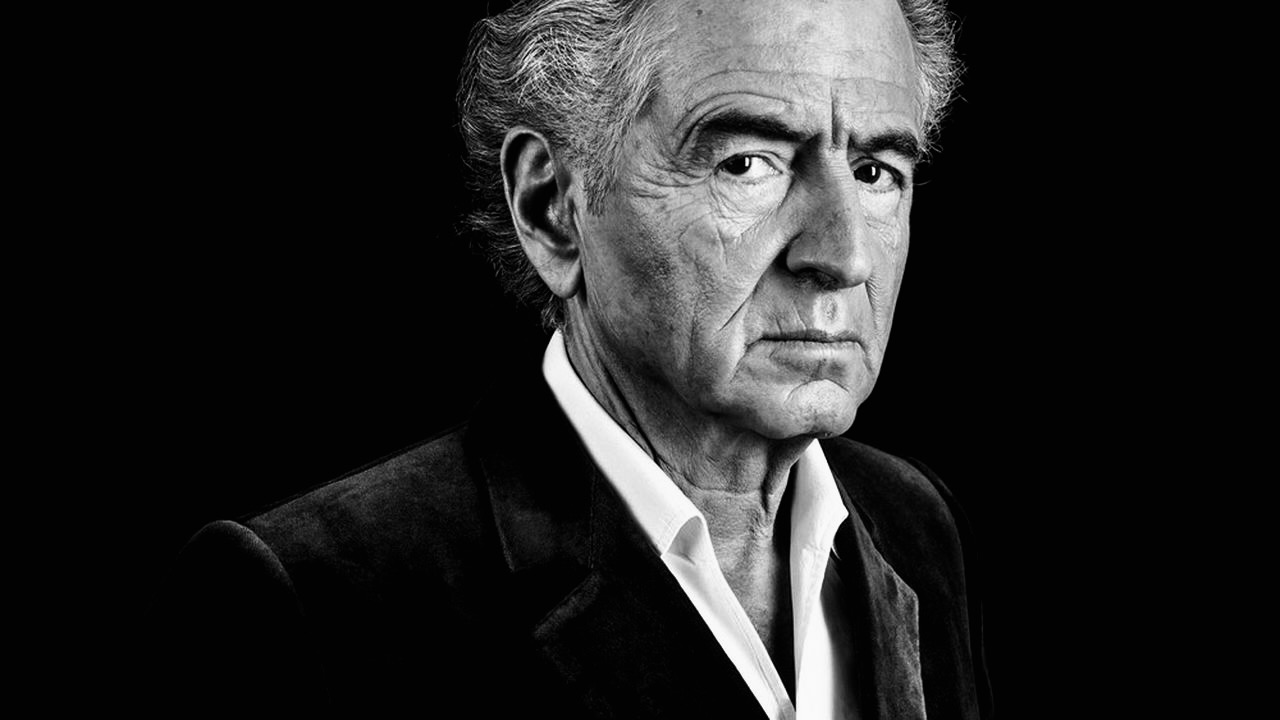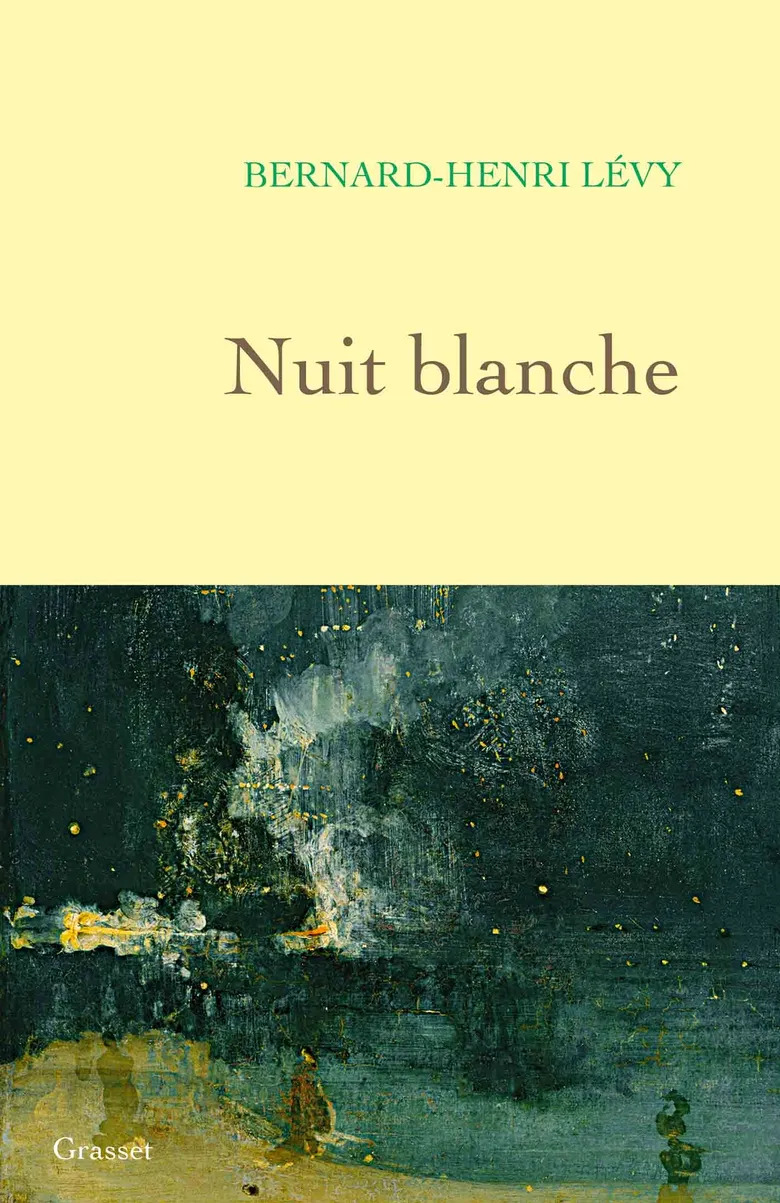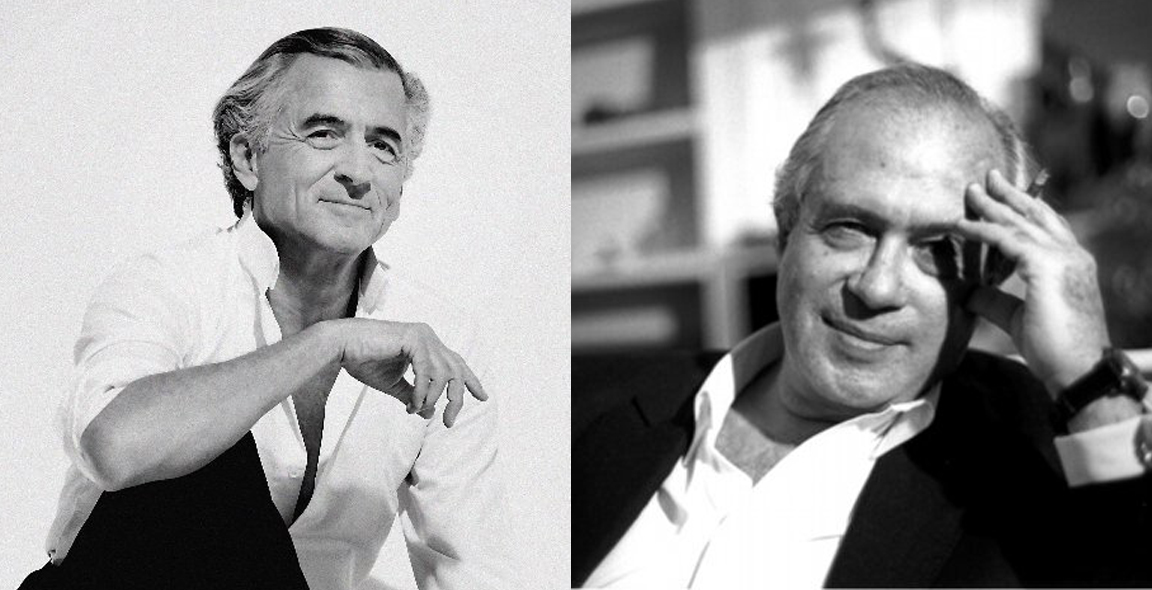Depuis le temps que je me faufile dans sa tête – s’il me le permet et, en tout cas, moins souvent qu’il ne s’autorise lui-même à se faufiler dans la mienne – j’ai fini par comprendre que mon cher ami Bernard vivait en compagnie de deux sortes de fantômes.
Ici, sur le devant de la scène, les officiels, les visibles, les ensoleillés qui parlent à voix haute, qui s’agitent sur les théâtres du monde ou de la mémoire, et qui le hantent, l’inspirent, lui donnent des raisons d’agir, de ferrailler, de se montrer : ils se nomment Byron, Lawrence, Malraux, Malaparte, Hemingway et quelques autres Magnifiques. Ce sont, pour la plupart, des vivants de grande lumière, des héros escortés de leurs belles vies, toujours dans la plénitude de leurs légendes et de leurs gestes mémorables. Bernard les consulte, les cite, les imite, les prolonge autant qu’il le peut. Tout le monde sait cela. C’est le mode d’emploi le mieux répertorié du système BHL. Pourquoi pas. À chacun sa compagnie.
Mais il y a les autres, les fantômes obscurs, les tourmentés de la tête et du cœur, les blessés du destin, les guetteurs d’absolu qui forment en lui un autre cercle, plus incandescent, moins public, plus proche du salut mais aussi de la damnation. Ceux-là, beaucoup l’ignorent, sortent d’un souterrain très intime, d’une maison des morts façon Dostoïevski, des coulisses clandestines de sa biographie et de l’histoire contemporaine. Ce sont des brûlés, des rois secrets, parfois peu recommandables, mais décisifs pour qui veut saisir l’essentiel de la nature humaine et de ce qui intrigue Bernard quand il se trouve en sa seule compagnie. Ils sont connus ou inconnus. Et se nomment : Artaud, Lautréamont, Michel Butel, Benny Lévy, Toni Negri, un certain Ahmed de Tanger, Louis Althusser, l’énigmatique et sublime isabelle, quelques talmudistes obscurs, sans oublier le très torve Jacques Vergès qui fut, tout le monde a dû l’oublier, l’un des héros du Diable en tête, le premier roman qu’il publia en un temps que les moins de vingt ans…
Aux premiers, BHL consacre ses ouvrages exotériques et combattants. Ils ont des décors guerriers – dans l’ordre des vraies batailles comme dans l’ordre des concepts. Ils permettent à leur auteur de monter au créneau, d’en découdre, de se choisir des ennemis, de défendre des malheureux.
Avec les seconds, l’instrumentiste change d’octave. Il se fait alors plus mystérieux, et choisit l’intime, la confidence, l’esquisse, le noir très noir. Il avait déjà produit ce son-là avec un livre fort ancien, pour lequel j’ai toujours eu sympathie et admiration – et qui s’intitulait Comédie. C’est dans cette veine, avec cette encre, avec cette sa saine dérision, qu’il a écrit Nuit Blanche.
Le demi-habiles, les petits malins – ceux qui haïssent d’abord, qui disqualifient sans lire, qui tirent à vue et par principe – n’aimeront pas ce livre. Ils diront que sa sincérité est une posture. Une note artificielle qui manquait à l’orchestration générale de l’œuvre. Un voyage au bout d’une nuit finalement tranquille. L’insomnie, tout le monde connait, non ?
Les autres, plus avisés, verront dans ces pages que Bernard y renoue avec sa galerie de fantômes personnels. Comme dans Hôtel Europe. Comme dans Le Jugement dernier. Retour au souterrain. Retour à la maison des morts. Et à tous ces maudits de la nuit qu’il ne peut s’empêcher de chérir même quand il se montre au soleil. Il faudra s’y faire : un écrivain a toujours le droit de passer derrière ses masques et d’explorer ce qu’il escamote. La vie, la nuit, les cauchemars, les fantômes, les démons. Et s’il ne s’agissait, à la fin, que de se rencontrer soi-même.