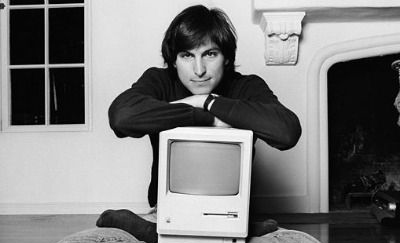La scène est digne d’un film de Scorsese. L’entourage d’un brillant et puissant espoir de la politique s’agite pour sauver la carrière de leur poulain, Premier ministre. Lequel, amoureux et donc imprudent, risque de tout perdre pour une passion adultérine. Envoyée au front, une conseillère convoque à déjeuner, pour la menacer, la femme par qui couve le scandale. Un autre conseiller, Corse et truculent, avance des arguments plus sonnants et trébuchants. L’amoureuse se résout, la mort dans l’âme. Marie-France Garaud triomphe. Pasqua et elle ont gagné. Jacques Chirac, bon gré mal gré, s’est séparé. Quelques jours plus tard, la femme victime de ces grandes manœuvres tente de mettre fin à ses jours.
Ainsi s’ouvre l’épatant livre d’Olivier Faye, journaliste au Monde, le premier à consacrer une biographie à Marie-France Garaud. Cette provinciale débarquée à Paris et vite arrivée au sommet de l’État, d’abord dans l’ombre de Pompidou, puis tirant les ficelles de l’ascension de Chirac, fut probablement, entre 1969 et 1979, l’une des femmes les plus puissantes de France, et d’ailleurs intronisée ainsi par l’hebdomadaire Newsweek. D’elle, chacun a les mêmes images – tailleur austère, chic Chanel, visage à la Alice Sapritch. Évoquée constamment pour son binôme avec Pierre Juillet, on emploie, pour parler de ces deux Père Joseph, conseillers du prince, le registre entier de l’analogie de bestiaire, souvent équin : « maquignons » ou « palefreniers », jockeys (ce mot irrésistible de Juillet sur Chirac qui exprime sa gratitude pour les deux compères « C’est la première fois qu’un cheval remercie son jockey ») ou même oiseleurs (les phrases amères et terribles de Chaban-Delmas, victime de leurs intrigues par Chirac interposé : « Chirac est un émouchet posé sur le poing ganté de Marie-France Garaud. De temps en temps Juillet tire l’anneau pour que Chirac vole une heure. Et tue. »). Faye recourt lui à une autre comparaison. En plein cœur des années 1970, le temps, sépia et enfumé, des films de Claude Sautet, il écrit : « Marie-France Garaud a rejoué avec Chirac l’antique duo d’Agrippine et de Néron, ce ballet ambigu cherchant à installer son fils au pouvoir, et à régner à travers lui. ».
Et, c’est le premier plaisir que procure ce livre : le portrait éminemment subtil, non seulement d’une femme, mais de cette relation entre Chirac et elle. Lui est touchant dans la sincérité de ses émotions, et la duplicité, voire l’ingratitude, de ses sentiments. Elle dit de lui, assez joliment : « Chirac avait du charme. Un charme adolescent. Celui d’un être inaccompli. Le genre de charme qui exerce une tentation sur les autres. » Plutôt que le parallèle racinien – c’est, on le comprend peu à peu, le roman balzacien qui se réécrit sous nos yeux. Entre un mentor, Garaud qui façonne, méprise, et s’enamoure d’un ambitieux Rubempré, dévoré par le doute et la soif de pouvoir mêlés. De son côté, Chirac, raconte le livre, est fasciné par Garaud : « Tout l’impressionne chez elle. Sa fougue, son caractère, son assurance intellectuelle, la sûreté de son jugement sur les hommes. »
Et c’est la figure de Vautrin, plutôt que d’Agrippine, qui s’impose – une relation fusionnelle vouée à l’échec et au drame, qui ne manquent pas d’arriver – et d’ailleurs, Pierre Juillet, l’autre pôle du trio, ressemble à Vautrin, énigmatique, laconique, aux mines d’agent secret. Ce lien entre Chirac et Garaud est-il de l’amour passionnel ? Probablement pas, l’auteur semble explicitement rejeter l’hypothèse. En tout cas, une composition plus compliquée, comme chez Racine et Balzac, ajoutée de relation filiale, d’avidité partagée, d’illusions de part et d’autre entretenues. Cette dialectique de maîtrise et servitude sans cesse renversée constitue la trame fascinante de « La Conseillère ». Pour rendre les choses plus sophistiquées, intervient, dans cet étrange duo politique, Bernadette Chirac, qui, finissant par se méfier de Garaud, obtient que son mari la congédie, après l’échec de la campagne des élections européennes de 1979. Et, pour décrire l’amertume de Garaud, on est tenté, cette fois, d’utiliser les mots d’un film de Sautet, lui aussi consacré à un trio fracassé, « César et Rosalie » : « Ce n’est pas ton indifférence qui me tourmente, c’est le nom que je lui donne : la rancune, l’oubli »…
Au-delà, Garaud, dont le prénom composé semble constituer le programme politique, a voué sa vie à la cause d’une patrie qu’elle croit « menacée par le parti de l’étranger » qu’il soit européen ou communiste. Une sorte de spin-doctoridéologue, mélange de Dick Cheney et d’agence Havas incarnée, qui se rêvait, apprend-t-on, ministre de la Santé, et dont l’humour caustique et cette sorte de folie finissent par rendre sympathique. Elle est, surtout, probablement la première femme à atteindre ces cimes et, même anti-féministe, éprouve tout le poids d’une misogynie constante, et d’ailleurs toujours vive, comme en attestent quelques-uns des témoins toujours vivants rencontrés par Faye. Ce dernier rappelle par exemple qu’en 1981, alors que chaque candidat à la présidentielle disposait d’un grand entretien, la télévision publique avait eu la bonne idée de composer un plateau avec les trois seules femmes en lice.
Pour le reste, « La Conseillère » vaut pour ses moments de bravoure, et, à force d’enquête, ses éléments inédits sur cinquante ans d’histoire qu’on croyait connaître. Pour les scènes d’anthologie : à la mort de Pompidou, comment Édouard Balladur, secrétaire général de l’Élysée, et Pierre Juillet, conseiller politique, fouillent nuitamment le bureau du Président à la recherche, vaine, d’un testament politique. Pour les nouveaux éclairages : une scène où Chirac, qui se sait humilié par Giscard mais ne peut se déprendre de son admiration, téléphone à l’Élysée pour se faire confirmer qu’il n’est pas le bienvenu à un dîner d’État, où le protocole, comme sa qualité de Premier ministre, l’attableraient normalement. Ou comment Daniel Vaillant, en 1981, trouve cinq cents signatures pour la candidature de Garaud à l’Élysée, sur ordre d’un Mitterrand jouant au billard à mille bandes. Surtout, Olivier Faye sous-entend, mais en s’appuyant sur les archives décortiquées d’un homme de l’ombre, que l’argent de la CIA n’est pas étranger à la carrière souverainiste de Garaud. Ce qui, étant donné le dernier livre de Philippe de Villiers, où l’anti-européen affirme, sans preuves, que la CIA a financé, à l’inverse, la construction européenne, ne manque pas d’être savoureux…
« Je suis un détrousseur de cadavres et un pilleur de tombes » affirmait Garaud, avec son mélange pince-sans-rire de provocation et de cynisme. Ainsi, tombeau de son vivant, carottage loyal d’une époque engloutie, La Conseillère se déguste comme un envers de l’histoire contemporaine du point d’une femme.