Cher Eric Marty, j’ai réfléchi à un petit speech pour commencer. Votre livre, je l’ai reçu mercredi dernier avec une dédicace que je n’ai pu déchiffrer, je l’ai feuilleté vingt minutes, et j’ai pensé à la phrase de Marx dans La Sainte Famille à propos de la réception par ses contemporains, de l’Essai sur l’entendement humain de John Locke, sur lequel j’avais fait mon mémoire de philosophie avec Canguilhem : « Il fut accueilli avec enthousiasme, comme un hôte impatiemment attendu. »
Votre livre me manquait, je m’en aperçois depuis qu’il est paru. Sans le savoir, je l’espérais. Et d’abord parce que jamais je ne suis entré dans l’œuvre de Butler, à laquelle Zizek, qui était alors mon élève à Paris, avait tenté de m’intéresser dès la parution de Trouble in gender. Plusieurs, dans et hors de l’École de la Cause freudienne, ont depuis lors exploré les dédales de la théorie du genre, pas moi.
Or, ladite théorie est désormais un phénomène mondial. Vous débutez votre livre sur une phrase emphatique : « Le genre, gender, est le dernier grand message idéologique de l’Occident envoyé au reste du monde. » C’est dit sur un ton « romantique », pour employer un mot favori, mais stigmatisant, de Butler. Est-ce excessif ?
Il est en tous les cas indiscutable que les idées des sectateurs du genre, pour le dire avec les mots du président Mao, ont pénétré les masses et sont devenues une force matérielle. Ces idées s’imposent aux États-Unis, elles pèsent sur l’évolution des mœurs dans les démocraties avancées, pour les appeler ainsi, elles inspirent la législation de plusieurs pays, dont l’Argentine, où l’influence de Lacan est si marquée dans la vie intellectuelle. En Europe, une loi similaire à la loi argentine est actuellement discutée en Espagne. Les disciples du genre sont actifs en France, ils ont connu leurs plus riches heures au temps où Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l’Éducation.
Je pense à cette phrase de Foucault que vous citez page 389, où il confie son espoir de produire « de réels effets sur notre histoire présente ». Eh bien, cette Judith Butler a réussi ça. Je dis : chapeau ! Et même, pourquoi pas : « Bien creusé, vieille taupe ! »
J’avais été rebuté d’emblée par le fait que Butler utilisait le vocabulaire de Lacan à tort et à travers, avec sans-gêne et de façon farfelue. Vous m’apprenez qu’il n’en est rien. Son usage, mésusage, des termes qu’elle emprunte à Lacan et à bien d’autres, répond chez elle à une véritable méthode, une méthode de « défiguration » dûment revendiquée, qui consiste à s’approprier des concepts pour les détourner de leur sens initial afin de les utiliser à d’autres fins. Vous la citez page 74 : « We actively misappropriate the terms for others purposes ». C’est un geste utilitariste souverain, qui n’est pas sans grandeur, ni sans culot. Les Américains ont pour le dire un mot yiddish, Chutzpah. Butler ne l’exerce pas seulement sur Lacan, mais sur Derrida, sur Bourdieu, sur Foucault et tutti quanti. Plus un terme est conceptuel, plus elle cherche à le rapter et à l’exploiter, d’où son attitude à l’endroit des théoriciens que vous qualifiez de prédatrice, confer page 77. A travers ses multiples ouvrages vous la suivez à la trace, pistant ses réutilisations, déplacements, détournements, divagations, mutations, reconfigurations, et vous projetez une lumière crue sur sa manière de faire, toujours ingénieuse et imaginative, même si parfois embrouillée et confuse. Vous vous livrez ainsi à une minutieuse « déconstruction », pour employer ce terme fameux, de la théorie du genre, déconstruction respectueuse de ses méandres, mais sévère pour ses inconséquences. Alors que cette idéologie suscite volontiers des sarcasmes et des rejets sans phrases chez les conservateurs, les réactionnaires, les tenants du soi-disant sens commun, vous en dépliez tranquillement toute la complexité, vous en étalez les paradoxes, vous en pointez les impasses théoriques, si bien que j’ai pensé en vous lisant à la célèbre maxime de Spinoza commentée par Nietzsche : « Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. » Vous ne vous moquez pas du genre, vous ne déplorez ni ne détestez, vous comprenez et faites comprendre. Enfin, par endroits, l’ironie perce.
Certes, il faut rendre les armes au mot, sinon au concept du genre, gender. Il n’aurait pas cet écho, il ne serait pas devenu pour beaucoup à la fois un slogan et une évidence, s’il n’était pas en sympathie, syntonie, résonnance, avec ce qui travaille le moment présent de notre civilisation, avec son « malaise », selon le mot de Freud, avec « ce qui chemine dans les profondeurs du goût » (Lacan).
Non, « la théorie du genre » n’est pas un complot, ce n’est pas une imposture, elle dit quelque chose de très profond sur notre actualité, modernité ou postmodernité. Il est d’autant plus fascinant de voir en vous lisant que ces idées aujourd’hui triomphantes sont issues à l’origine d’un étonnant bricolage théorique en équilibre instable, où le paralogisme le dispute à la songerie.
On dira que vous ruinez sans retour la construction du concept du genre. Certains, dont je suis, seront néanmoins sensibles à la force de l’entreprise. Judith Butler a su « imposer le genre quasi universellement comme un signifiant indépassable », page 487, elle est inventive, et elle rectifie sans barguigner ses conclusions, jusqu’à finalement les évacuer sicut palea, comme du fumier, mot de Thomas d’Aquin à la fin de sa vie, rappelé par Lacan.
Vous m’avez appris en effet que Butler fut sacrée Queen of Gender en 1994 par celle qui aurait pu être sa rivale, Gayle Rubin, que vous présentez page 38 comme « anthropologue, activiste queer, lesbienne, grande amie de Michel Foucault avec lequel elle partage un même tropisme sado-maso ». Mais, dès l’année précédente, Butler se reprochait d’avoir fait du gender « un site d’identification prioritaire aux dépens de la race, de la sexualité, de la classe ou du fonctionnement des placements géopolitiques », ou aussi bien « au détriment des subalternes, nouvelle catégorie alternative créée par Gayatri Spivak ». La pensée intersectionnelle, qui privilégie la race, prit depuis lors une place presque hégémonique chez Butler, écrivez-vous page 365. Pour elle, on dirait que le genre a duré à peine davantage que ne durent les roses, avant de se faner.
Vous faites comprendre qu’il y a comme une destinée chaotique de la pensée du genre, qui lui interdit de jamais se fixer, qui la conduit à se diversifier et à se fractionner sans répit, de telle sorte que son champ intellectuel est ravagé par une guerre de tous et toutes contre toutes et tous. C’est le moment de rappeler que la dénomination de « théorie du genre » résulte d’un forçage, puisque celles et ceux qui travaillent dans la discipline la disqualifient. Elle ressortit selon eux d’une conception unitaire, autoritaire, hégémonique, de l’activité intellectuelle, qu’ils et elles abominent, préférant s’adonner à la multiplicité chatoyante, foisonnante, sans loi, des studies. Le Un est mort, vive le Multiple ! Le genre n’a pas de Reine. Cette dynamique est, d’une certaine façon, on pourrait certainement le soutenir, conforme à la logique dite du « pas-tout » que Lacan en était venu à formuler comme propre à la position féminine, et qui aujourd’hui l’emporte partout dans la civilisation, du moins la nôtre.
Ce parti-pris du Multiple-sans-l’Un fait du domaine des études de genre un labyrinthe, ou plutôt un maquis, une jungle, et je m’y perdais si vous ne m’aviez pris par la main, comme Virgile. Ma Butler, ce sera jusqu’à nouvel ordre la Butler d’Eric Marty. J’espère que votre livre sera traduit aux États-Unis, je serai curieux de voir comment réagira Judith Butler à votre travail, et les autres. Vous fera-t-on l’hommage, ou le femmage, d’une controverse argumentée ?
Cependant, votre livre n’est pas seulement une sensationnelle déconstruction du genre selon Judith Butler. Il offre aussi un panorama inégalé jusqu’à présent, au moins à ma connaissance, de la vie intellectuelle en France dans la seconde moitié du siècle dernier. Vous jetez en particulier des regards croisés sur Barthes, Deleuze, Derrida et Foucault, sur leur complicité et leurs querelles, feutrées ou explosives, période très intense et féconde si on la compare à l’atonie présente des échanges intellectuels, que masquent mal une agitation et une nervosité médiatiques de mauvais aloi, qui ont fait dire la semaine dernière à une fine mouche, observatrice délurée des médias, Eugénie Bastié, journaliste au Figaro, que « notre débat public se caractérise par le relativisme (chacun sa vérité) et l’intolérance (ma vérité ne saurait être contestée) ». Très « gender », cette situation.
Ces quatre grands noms, au fil de votre déconstruction du genre, vous les faites revenir à de nombreuses reprises dans de savants entrelacs, qui tournent parfois en enchevêtrements. J’aimerai reprendre ces noms un par un avec vous, si vous le voulez bien.
Et enfin, il y a Lacan. Il inspire Butler, dont il ne connaîtra pas l’œuvre, puisqu’il est décédé en 1981. Il est très présent pour nos quatre Grands, il les a inspirés aussi, et lui-même les lit, les invite, tient compte de ce qu’ils écrivent. Mais votre livre fait apparaître à quel point il se distingue du Quatuor. Du moins, je ne vois nulle trace chez lui de cette « pensée du Neutre » que vous décelez chez les quatre pour l’opposer à la théorie du genre.
En tous les cas, après 1968, quand Derrida, Deleuze et Guattari, sans oublier Foucault, entreprirent de démoder la psychanalyse, de la rendre désuète et, pour le dire sans façons, de la ruiner dans l’esprit du public, Lacan jeta sur eux un filet, une tunique de Nessus, ce qu’il appelait « le discours de l’Université », dont il distinguait sévèrement « le discours de l’Analyste ». Et il y eut un partage des eaux. On cessa chez les lacaniens de lire « les universitaires ». Et ceux-ci s’éloignèrent toujours davantage de leur compagnonnage ancien avec le psychanalyste qui les avaient tant occupés.
Voilà, j’en ai fini. C’est un grand livre, si riche, si touffu, 500 pages, une fresque, un carnaval, avec son cortège de castrats et de travelos, de sado-masos et de pseudo-schizos, à la fois festival conceptuel US et défilé French Pride. C’est une épopée intellectuelle haletante. Bref, une œuvre qui, je parie, restera mémorable.
À suivre
Transcription de Rose-Marie Bognar, revue par le locuteur.

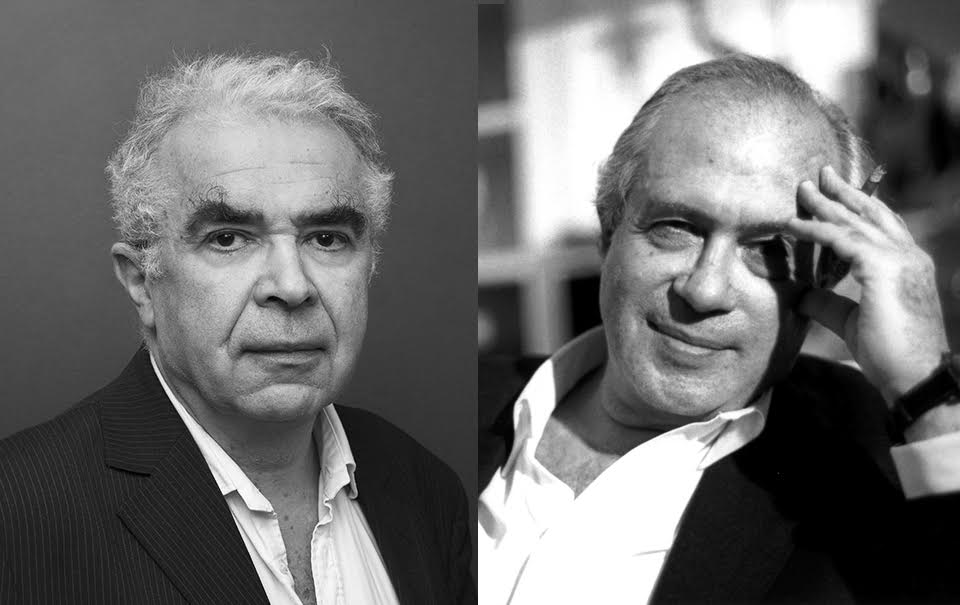





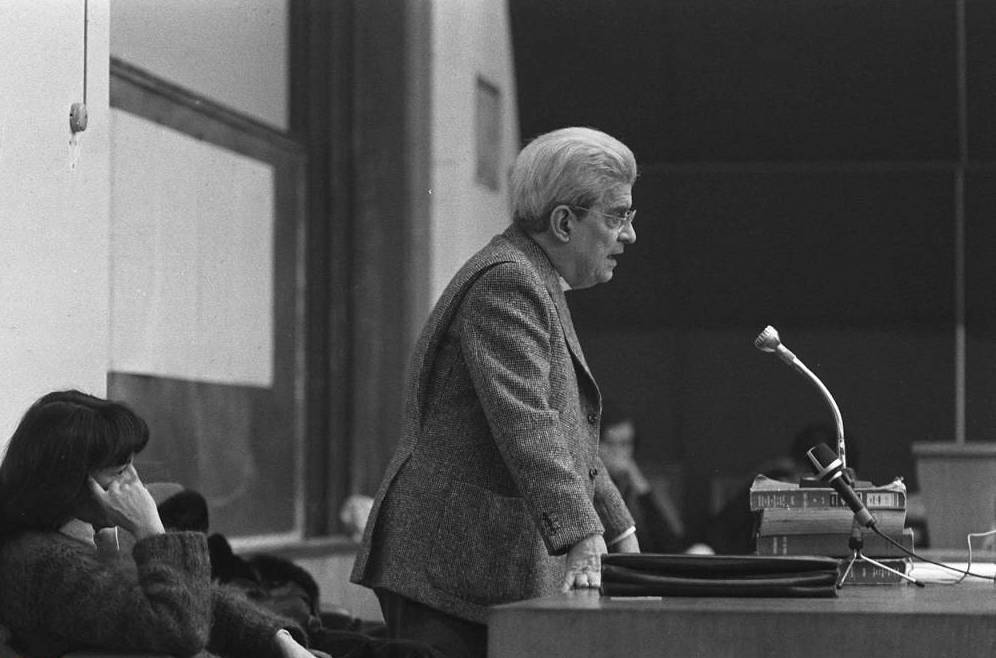

Formidable introduction de deux messieurs arcboutés sur une justification désespérée d’une domination ébranlée.
Celle de celui qui n’avait pas à rougir selon Goffman.
Quelles que soient les dominations, elles ne sont jamais remise en question par les dominants.
Merci pour votre démonstration de la preuve, que la perspective des discriminations ne plait pas à certains mais la jeunesse masculine est elle bien plus alerte.
Les temps changent messieurs, avec ou sans vous.