Mon confinement est imposé. Le confinement est l’écosystème de l’écrivain ; j’y vis depuis vingt-cinq ans, sans me plaindre. Mon quotidien n’a pas changé. Seule sa bande sonore est différente : le chant des moineaux et le croassement des corbeaux (désormais phénix des hôtes de la capitale) s’est substitué aux vrombissements des motos et aux klaxons des voitures. Je continue d’écrire, de lire, avec cette sensation que, dans toutes les villes du monde, tout le monde est devenu écrivain.
Mais mon usuel confinement reposait sur cette chose précieuse à laquelle nous sommes en train de renoncer : la liberté. J’aime le confinement quand je me l’impose, je le déteste dès lors qu’on me l’inflige. Ce n’est pas de me déplacer qui me manque, mais de pouvoir le faire. Ce qui m’était une bénédiction, rester dans mon univers, est ainsi devenu une malédiction, et ma vocation, une punition. On m’administre par la force ce que j’aime à faire d’habitude le plus volontiers et de mon propre chef. C’est violent.
Parfois, j’ai envie de mettre fin à mon confinement. Je ne le ferai pas, par esprit civique. Mais l’envie, oui, m’en prend. Je ne le ferai pas parce que c’est la première fois de ma vie que je suis un engin de mort. Non seulement je puis la recevoir, mais je peux la distribuer, la donner, la répandre, l’inoculer.
1. – J’ai envie de cesser mon confinement (ce que je ne ferai pas) non parce que je n’ai pas peur de la mort (je ne suis pas un idiot) mais parce qu’elle fait partie de ma vie. Si j’aime à ce point chaque journée de mon existence, c’est précisément grâce à la mort, qui procure une sensation d’intensité sans pareille à nos matins, nos midis et nos nuits. Je bénis la mort de me faire voir que, sans elle, je considérerais la vie comme un acquis, une formalité, une banalité, quand c’est au contraire une chance, un miracle, une joie. Alors oui, plus que de mourir, j’ai peur de ne plus vivre. J’ai peur de décéder. Ce qui n’est pas exactement la même chose.
Nos sociétés confondent la mort et le décès. La mort est ce qui nous rappelle sans cesse que la vie est unique et précieuse parce qu’à tout moment nous pouvons la perdre ; le décès est le terminus biologique de notre être. La mort est permanente et dure toute la vie en nous, elle nous habite ; le décès lui, loge sur une seule date : celle à laquelle notre cœur cesse de battre. La mort est la possibilité que nous avons de mourir à tout moment. Le décès est le passage à l’acte de cette possibilité, son adoubement physiologique. Et c’est lui, le décès, qui dans nos sociétés est devenu intolérable, inadmissible et scandaleux. C’est lui, très précisément, qui nargue les transhumanistes qui voudraient l’abolir, voire l’interdire. Chaque sortie dans la rue est en même temps un acte pour vivre et pour mourir, car nous passons notre temps à faire simultanément les deux : sommes-nous en train de vivre, ou en train d’attirer sur nous la mort ?
J’accepte implicitement que chacune de mes sorties, en temps d’épidémie ou non, débouche sur ma disparition physique. Si l’on m’ôte ce risque, je ne suis plus rien : je deviens un mort vivant, ce qui est plus insultant pour ma dignité que d’être – si j’ose dire – un mort décédé.
2. – J’ai envie de cesser mon confinement (ce que je ne ferai pas) parce que nous savons aujourd’hui que l’immense majorité des personnes les plus en danger sont des personnes malades ou âgées. Je considère par conséquent que ces personnes, qu’il n’est pas question d’exposer à la maladie, ont raison de se maintenir en confinement. A titre personnel, je m’abstiendrais de les visiter, de les croiser, de les voir ; une société qui laisse mourir les siens sur le critère de l’âge a déjà un pied dans l’abjection. L’âge n’a jamais été un critère pour jauger d’une existence ; il n’y a aucune priorité, en matière de vie ou de mort, de la vieillesse sur la jeunesse. Un homme de vingt ans ne vaut pas plus, ni moins, qu’une femme de quatre-vingt-dix ans.
Oui, j’ai bien envie de sortir (mais je ne le ferai pas). On me rétorquera que des gens plus jeunes et en bonne santé sont violemment concernés par le virus. Certes, la mort est toujours un scandale ; certes, elle n’est jamais intelligente. Mais être adulte, n’en déplaise à cette société infantilisée à l’extrême où les quadragénaires font de la trottinette, c’est être capable de prendre le risque de vivre et par conséquent celui de mourir.
Qu’une personne âgée ait peur, cela est normal ; qu’une personne ayant des problèmes médicaux lourds soit paniquée, cela est compréhensible. Mais que tous ceux qui se sentent en forme aient peur, et même peur d’avoir peur, cela, puisque nous parlons de confinement, confine précisément au grotesque. Chaque adulte digne de ce nom devrait regarder la mort en face comme on regarderait le soleil sans cligner des yeux. L’éducation n’est pas une initiation au divertissement mais doit préparer un individu à affronter la mort en permanence, la sienne en tout cas. Nous l’avons hélas oublié.
3. – J’ai envie de cesser mon confinement (mais je ne le ferai pas) parce que la mise en quarantaine de toutes celles et de tous ceux en capacité de travailler est suicidaire. On parle de « l’après », mais voici que l’anticipation de cet « après » s’avère aussi catastrophique que celle de « l’avant » : sans les forces vives, réduites aujourd’hui à tourner en rond dans leur salon, comment construire le système de santé de demain ? Comment va-t-on rénover l’hôpital dans une économie moribonde ?
4. – J’ai envie de cesser mon confinement (mais je ne le ferai pas) parce que nous nous laissons submerger par ce virus. Je ne suis pas médecin et j’ignore s’il est plus ou moins dangereux qu’un autre. Ce qu’on lui reproche surtout c’est de nous avoir pris de vitesse et par surprise. Existerait-il un vaccin demain matin, que je ne suis pas certain que les gens iraient en masse se faire vacciner : nous en avons la preuve avec la grippe. La population se dirait : « c’est bon, un vaccin existe ». C’est l’irrationalité face au vide, face à l’absence de solution, de recours, qui créé la psychose. Nous n’avons pas tant peur du virus que de l’absence de riposte au virus.
Ce qu’on nomme sa dangerosité,c’est essentiellement sa nouveauté. Ce qu’on appelle sa létalité, c’est essentiellement notre incurie. Le traitement qu’on nous inflige est le résultat de la seule légèreté. On veut baptiser déflagration « notre » impréparation – je parle bien entendu de celle du gouvernement.
La virulence de cet « ennemi » est construite sur cette proportionnalité inverse où la cause et l’effet sont intervertis : parce que nous ne sommes pas prêts, alors le Covid-19 est dangereux. La réalité de sa virulence n’a donc plus grand-chose à voir avec lui mais tout à voir avec nous. La nocivité intrinsèque du virus disparaît ; nous tombons malades de notre amateurisme à nous, non de son professionnalisme à lui. La nature réelle de l’agent infectieux est occultée au profit de ce qu’elle dévoile : la négligence, l’abandon, le relâchement, l’inconscience, quatre ingrédients diaboliques de l’actuelle improvisation.
5. – J’ai envie de cesser mon confinement (mais je ne le ferai pas) parce que le virus ressemble au monde extérieur dans lequel on m’interdit désormais de mettre les pieds. Le Covid-19 est strictement à l’image de la société dans laquelle il a éclos ; il n’est ni plus ni moins que le reflet de ce que nous avons fait de l’espace, du temps, de la nature et du réel. Comme s’il disait notre monde, qu’il le soulignait. Comme si, bien qu’invisible, il le montrait. Le virus dévoile ce qu’il y a sous le monde que nous avons développé, exactement comme la marée montre ce qui se dissimulait sous les flots : bidons rouillés, rats morts, détritus. Cet invisible donne à voir ; cet invisible rend tout visible. On ne peut pas voir le virus, mais on peut le visualiser : c’est le monde dans lequel nous vivons.
Que je sois contaminé ou non, je fais partie de ce virus et il fait partie de moi ; il m’a attrapé comme je l’ai attrapé. D’ailleurs nous ne l’attrapons pas : nous sommes en réalité rattrapés par lui. Notre tort est de dissocier le virus de nous ; il est nous. Tant que nous voudrons l’éradiquer, non tant comme une part de nous-mêmes que comme un corps strictement étranger, nous ferons fausse route. La façon que j’ai de vivre a créé l’écosystème de cette viralité.
6. – J’ai envie de cesser mon confinement (mais je ne le ferai pas) parce que si nous sommes véritablement en guerre, je ne sache pas que la guerre consiste à se planquer. Mais, surtout, je crains bien que nous ne soyons pas en guerre ; nous y jouons, ce qui n’est pas la même chose. Et surtout, nous la surjouons. C’est une guerre virtuelle, comme les virus le sont d’ailleurs quand ils contaminent nos ordinateurs. Nous avons tellement oublié ce qu’est la guerre que nous la déclarons à chaque fois, précisément, que l’ennemi est invisible : le terrorisme, l’épidémie. Dans la guerre, la mort est précisément la norme, décéder une banalité, périr une modalité. La guerre modifie le réel précisément en ceci qu’il est la perpétuelle acceptation de la mort. Le fait de mourir est à la guerre ce que le fait de vivre est à la paix. J’en ai assez de ces guerres de temps de paix, de ces fictions de guerre, de ces guerres que nous faisons sans que nul jamais ne nous la fasse, de cette « mobilisation générale » appelant chacun à devenir un planqué.
7. – J’ai envie de cesser mon confinement (mais je ne le ferai pas) parce je n’en puis plus des journaux, qu’ils soient écrits, parlés ou télévisés. Le virus a cessé d’être viral : c’est l’épidémie elle-même qui l’est devenue. Nous assistons, dans le traitement de l’information, à une épidémie d’épidémie – à une épidémie au carré. Le discours est métastasé, tout est transmission et tout est retransmission. On retransmet au prorata dont le virus se transmet. Nous sommes autrement dit chez les fous. La panique est devenue panique de la panique et les gens, devant leur télévision, ont désormais peur de la peur. La psychose a commencé avec l’impossibilité de comparer ; la grippe n’était plus un référent pertinent – tout, alors, s’est écroulé. On n’avait plus de virus étalon, de totem, de Dieu virus à idolâtrer. Les avis et les opinions, les analyses et les éditoriaux sont devenus à cet instant eux-mêmes viraux.
La pandémie n’est pas seulement celle du virus : elle est celle de l’épidémie elle-même. C’est l’épidémie qui se répand. L’épidémie est le virus de l’information et des réseaux sociaux.
Mais l’information et les réseaux sociaux, déjà viraux par nature, déjà viraux quand il n’y pas de virus à signaler, viraux pour Griveaux, viraux pour n’importe qui, jouissent de cette viralité dans la viralité.
Les réseaux sociaux véhiculent des « fake news » et on a l’impression que les chaînes d’informations ne font que diffuser des « fake news » à l’envers, des contre « fake news », plutôt que de donner des « news » tout court. Le référent étant le faux, dans ce qu’il a de pervers, de jouissif et de spectaculaire, le vrai a cessé d’être le vrai pour devenir l’antidote ou le vaccin du faux. Il ne repose que sur lui ; c’est le faux auquel le vrai, désormais, se réfère pour pouvoir se faire entendre. Le vrai est devenu le parent pauvre du faux – une manière d’excroissance, de verrue qui tente en permanence de se faire une beauté.
L’information fausse est un virus : elle brouille l’intelligence de la situation ; l’information vraie est un contre-virus : elle ne fait que brouiller ce brouillage. La première est un virus en ce qu’elle s’insinue ; la seconde est un contre-virus en ce qu’elle insiste.
Les réseaux sociaux et l’information fonctionnent comme un indissociable couple dont l’un fait incessamment muter l’autre. Nous sommes ainsi pris en tenaille entre du faux et du contre-faux. Or, le contre-faux, ce n’est pas la vérité : le contre-faux, c’est la propagande – c’est le discours officiel ; c’est, en l’occurrence, le discours de la guerre. Nous sommes pris en étau entre la guerre du faux et la fausse guerre.
8. – J’ai envie de cesser mon confinement (mais je ne le ferai pas) parce que le pouvoir politique a abandonné les commandes pour se ranger derrière quelques experts scientifiques. On sait très bien, depuis Heidegger, que « la science ne pense pas ».
Si le mot de « héros » signifie homme, femme de « grande valeur », alors, sans la moindre démagogie, je l’attribue volontiers, moi aussi, comme tant d’autres, au personnel soignant. Je les respecte, je les admire ; ils avaient la vocation de soigner les hommes, les voici en face de la décision de devoir, parfois, les laisser mourir, et d’eux-mêmes risquer leur vie. Ce qu’ils vivent n’a pas de nom.
Je ne cesserai pas mon confinement parce que se promener dans les rues serait se promener sur la mémoire des morts. Je ne vais pas flâner au soleil parce que ce serait prendre l’air parmi des tombes. En restant chez moi, je communie. C’est ma prière d’athée. Tous les jours, je sors une heure pour courir. En courant, je pense aux médecins, aux infirmières et aux malades. Je ne reste pas une minute de plus, parce que l’air que je respire, je sais que je risque de leur retirer des poumons. Je n’obéis pas à une quelconque mobilisation générale, qui n’est ici qu’un expression creuse. J’obéis à une mobilisation universelle. Car dans ce monde contaminé, surtout par la haine, la bêtise et l’incompétence, j’essaie, humblement, de rester un humain parmi les humains.


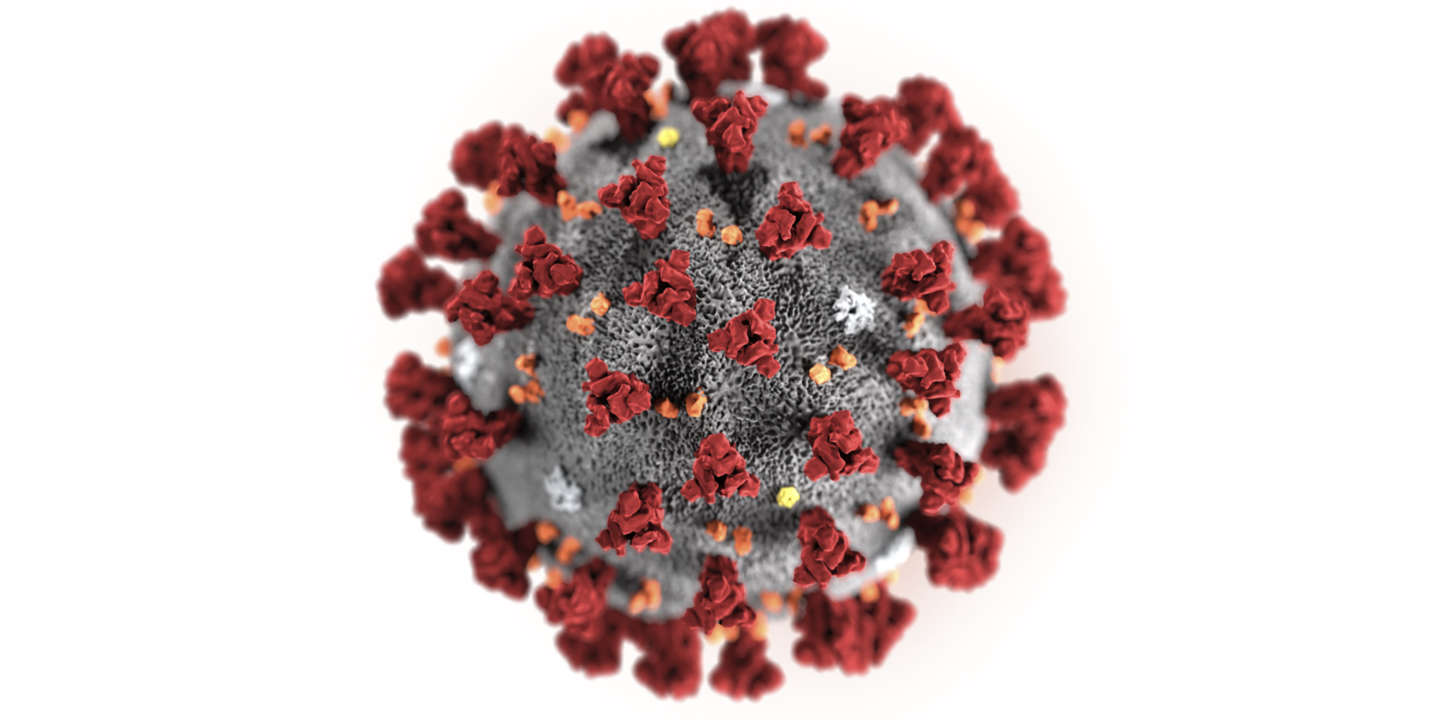
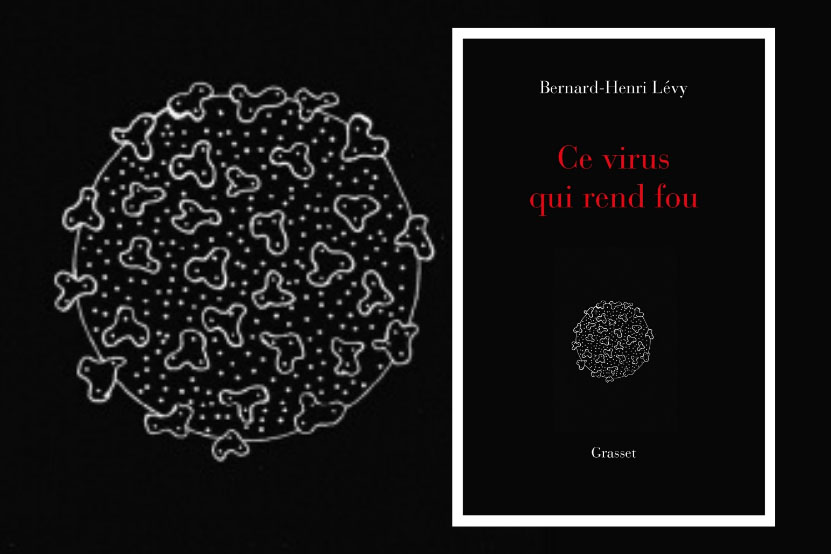




Très bonne fin. Nous éprouvons tous, normalement, vos sensations et dépits contrastés, à part ceux, dont le corps atteint va imposer sa panique, qui n’ont pas le choix. A part ceux, anonymes, dépouillés d’eux-mêmes, qui devront assumer l’afflux énorme, débordant, de ces corps contagieux jusqu’après la mort, les petites mains qui soignent mais aussi entreposent (en Equateur, les corps gisent déjà dans la rue). A part ceux qui doivent mesurer au jour le jour, les enjeux concrets sanitaires, économiques, sécuritaires, ce qui semble peu « noble » mais s’avère décisif et demande de la logique, du sang-froid, de la concertation. Il me semble que vous généralisez un peu trop. Par ailleurs, je trouve très pratique que les media, assez variés quand même, traitent autant ce sujet, en temps réel, comme un courant continu qu’on peut interrompre à loisir. Philosopher, c’est peut-être apprendre à mourir. Un exercice solitaire, un peu dérisoire quand les corps souffrants peuvent submerger les vivants, sans sépulture…
Un commentaire aussi clair que pertinent. Néanmoins, il manque un dosage de l’humour. Ce qui manifestement l’ingrédient indissociable de sa plume.
Yann Moix, toujours aussi agréable de le lire, de l’entendre et d’avoir aimé son
film Podium.
Je vous signale dans cet article une faute d’orthographe : il a éclot s’écrit il a
éclos.
Merci à la Règle du Jeu de proposer des articles aussi intéressants.