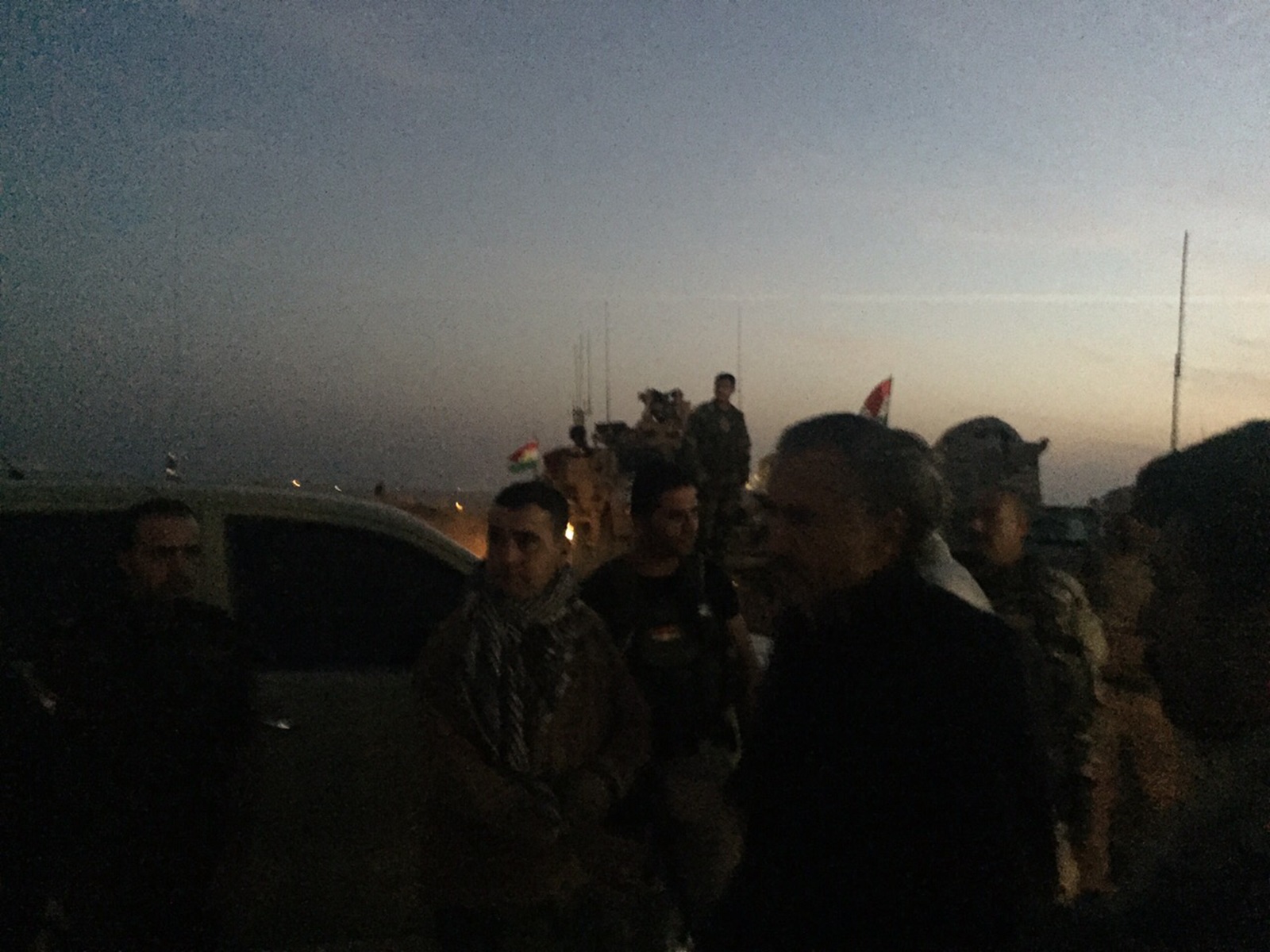Tourné comme un reportage de guerre, dont il reprend les codes, les images bougées, les rafales qui claquent, les blessés qu’on évacue, le film reste l’œuvre personnelle d’un auteur engagé. La véritable bataille de Mossoul, le terrible combat de rue livré depuis plusieurs mois par les forces spéciales irakiennes face aux voitures suicides lancées par Daech, la méthode et le professionnalisme qui leur ont permis de reconquérir les trois quarts de la ville sont moins évoqués que la noblesse et la frustration des combattants kurdes, restés en dehors de la bataille après la conquête des faubourgs. Reste un film aux images magnifiques, porté par la voix off de l’écrivain philosophe, ode épique dédiée à la cause qu’il s’est choisie: celle des Kurdes d’Irak.
LE FIGARO. – Pourquoi ce film?
Bernard-Henri LÉVY. – C’est la suite de Peshmerga, qui tournait autour de Mossoul comme autour d’un objet interdit, un mirage noir. La Bataille de Mossoul dissipe en quelque sorte le mirage et entre dans la chose même. C’est un film subjectif, à la première personne, avec une narration, un rythme, qui sont les miens. Je ne suis pas journaliste. Je suis un écrivain qui va sur le terrain, qui y engage sa tête et son corps et qui, comme disait Hemingway dans le titre de son célèbre recueil de textes de guerre, monte «en ligne». Je ne prétends pas à la neutralité, autrement dit. J’ai fait un film engagé, partisan, un film qui défend une cause et qui, comme le précédent, prend position dans une bataille plus générale…
Quelle est cette bataille?
La bataille contre le djihadisme, bien sûr. C’est-à-dire contre le fascisme de notre temps. L’aventure a commencé après les attentats de Paris. Je me suis dit: «Nous sommes en état d’urgence planétaire – il faut détruire ce nouveau nazisme comme la génération de mon père a détruit le précédent.» Pour cela, tous les moyens étaient bons. Militaires, quand on est militaire. Les mots, quand on est un homme de mots. Les images, quand on est un homme d’images. Voilà. Ce film, c’est ma contribution à cette bataille.
Est-elle en train d’être gagnée?
Oui. Parce que la communauté internationale semble avoir enfin compris que ces assassins ne sont forts que de nos faiblesses et de nos atermoiements. C’était étrange, cette aura d’invincibilité dont jouissaient les djihadistes! Certains médias ont contribué à cette narration. Et aussi des intellectuels qui disaient que Daech était si fort, si redoutable, que le mieux était de composer avec lui. Eh bien non. La baudruche se dégonfle. Ces djihadistes sont des tigres de papier. Et j’essaie de le montrer avec ce film. Au passage, je suis révolté par la thèse, que j’entends souvent, selon laquelle la supériorité des islamistes sur l’Occident est qu’ils sont prêts à mourir pour leur djihad alors que nous n’aurions, nous, plus la force de défendre nos valeurs. Regardez les forces spéciales occidentales sur le terrain, les représentants des ONG, les journalistes et, enfin et surtout, ces Kurdes qui forment les bataillons de cette grande armée de la liberté. S’il y en a bien qui prennent des risques, tous les risques, pour défendre leurs valeurs, ce sont eux! Je voulais montrer aussi cela.
Cette guerre n’est-elle pourtant pas largement menée par alliés interposés? Les soldats au sol, les combattants sont des Irakiens, des Kurdes.
Oui, bien sûr. Mais pas seulement. J’ai filmé, par exemple, les forces spéciales américaines dans la zone chrétienne de Bartella. Ce sont des images rares car les Américains, en principe, refusent d’être filmés. Mais elles sont importantes. Car, sans le feu vert et la logistique fournis par les Occidentaux, sans la décision américaine et française d’en finir avec cette farce criminelle qu’était le prétendu État islamique, il n’y aurait pas de bataille de Mossoul.
Parmi ces forces sur le terrain, les Kurdes sont au centre de ce film, comme ils étaient au centre de Peshmerga. Vous soutenez la thèse selon laquelle les Kurdes auraient été écartés de la prise de Mossoul pour des raisons politiques par Bagdad?
Pas seulement par Bagdad. Par la coalition et, notamment, par Washington. Il y a une grande ombre qui plane au-dessus de cette bataille de Mossoul: c’est l’ombre de l’Iran. Et je crois, oui, que la volonté de complaire à l’Iran a fait que la Maison-Blanche a stoppé les peshmergas aux portes de la ville. Obama a voulu faire de son «deal iranien» le cœur de sa «legacy». Et nombre de ses décisions, en apparence indéchiffrables, s’expliquent par ce choix principal. L’incroyable et ruineuse décision, le 29 août 2013, de ne pas frapper Bachar al-Assad alors qu’il avait franchi la ligne rouge de l’utilisation des gaz chimiques… Le lâchage d’Israël en fin de mandat… Et puis, là, cette volonté de laisser aux Irakiens de Bagdad – qui sont les grands alliés de l’Iran dans la région – le bénéfice politique et militaire de la victoire…
Mossoul aurait été prise plus rapidement avec les combattants kurdes?
Je crois. D’abord parce qu’ils sont plus vaillants. Et puis, je vous le disais, parce qu’ils savent, eux, pourquoi ils se battent. C’est la fameuse question de Frank Capra, en 1943: «Pourquoi nous combattons.» Les combattants, en majorité chiites, de Bagdad ne le savent pas toujours très bien. Les Kurdes, si. Mais voilà. On leur a demandé de rester l’arme au pied. C’est l’avant-dernière scène du film. On voit l’un des plus héroïques généraux peshmergas, Sirwan Barzani, rongeant son frein à quelques kilomètres de la ville où on lui interdit d’entrer. Il dit: «Si on me demande finalement d’y aller, j’irai…»
Il dit aussi que ce serait en échange de l’indépendance du Kurdistan.
C’est la moindre des choses! Les Kurdes ont été les premiers à arrêter Daech. Ils ont, depuis plus de deux ans, presque seuls, tenu le front face aux barbares. Eh bien ce peuple oublié, ce peuple éternellement trahi, ce peuple à qui l’on n’a pas cessé, depuis un siècle, de faire des promesses et de ne pas les tenir, dit aujourd’hui: «Ça suffit! Nous voulons bien être les sentinelles du monde, son bouclier et son fer de lance, mais que l’on nous donne enfin notre place dans le concert des nations!» Honnêtement, je trouve cette demande légitime. Depuis le temps que l’on nous répète, d’Henri de Boulainvilliers à Michel Foucault, que les nations se créent dans le sang des batailles! Pour une fois que c’est une bataille noble, pour l’honneur et contre l’horreur, allons-nous bouder le baptême?
Vous respectez moins le sacrifice des forces irakiennes, en particulier des combattants de la Division d’or, que vous présentez comme des «Rambo», désorganisés, qui tirent dans tous les sens. Alors que ce sont des combattants méthodiques, efficaces, qui ont repris, quartier par quartier, en laissant beaucoup des leurs sur le terrain, tout l’est de Mossoul et qui combattent actuellement dans l’ouest de la ville. N’est-ce pas un parti pris partial, et même injuste?
Je filme ce que je vois. Et je montre ce que j’ai filmé. En la circonstance, bien sûr qu’il y a des artilleurs méthodiques et c’est dans le film. Mais, avec Camille Lotteau, Olivier Jacquin et Ala Tayyeb, mes opérateurs, nous avons vu, aussi, des soldats irakiens qui tirent dans le vide, qui reperdent des quartiers qu’ils ont libérés, etc. Nous avons vu une armée fantôme errant dans les rues de quartiers dévastés qu’elle ne parvient pas à sécuriser. Et puis ce rapport à la mort, étrangement mimétique de celui de Daech… Il y a aussi ça dans la Division d’or.
Vous ne croyez pas que ce sous-entendu est un peu exagéré? Quelques têtes de mort arborées par des soldats qui risquent leur vie, et une croix gammée sur un tee-shirt. Cela suffit-il à les transformer en SS?
Je montre une croix gammée, en effet. Mais nous en avons, hélas, filmé bien davantage.
Et Peshmerga, ce n’est pas un rapport malsain avec la mort?
«Peshmerga» veut dire «ceux qui vont au-devant de la mort». Mais pour lui faire face. Pour la conjurer et la vaincre. Jamais pour la célébrer. Jamais, comme chez certains de ces combattants chiites de Bagdad, pour dire: «Viva la Muerte…»
Vous dites que vous n’aimez pas la guerre, alors qu’elle est le thème qui traverse tous vos films et une partie de vos livres. Paradoxe ou contradiction?
Non, je n’aime pas la guerre. Mais j’aime, en revanche, la grandeur. J’aime ces moments, dans la vie des hommes, où ils deviennent un peu plus grands qu’eux-mêmes. Et je dois reconnaître que la guerre est, parfois, l’occasion de cela. J’ai toujours eu un faible pour les grands condottieres et les écrivains aventuriers: Garibaldi en Sicile ; Byron à Missolonghi ; Lawrence et Malraux bien sûr ; ou, d’une certaine façon, Xénophon et son Anabase. Mais je crois qu’il y a, en chaque homme, vraiment chaque homme et pas seulement chez ces grands par vocation transcendantale que sont, selon Kantorowicz, les rois ou les presque rois, un accès possible à cette grandeur. C’est ça que je suis allé chercher, jadis, chez les résistants du Bangladesh. Puis chez les défenseurs de Sarajevo ou chez les insurgés libyens. Ou, aujourd’hui, chez les Kurdes…
Ce parti pris permanent que vous revendiquez ne laisse-t-il pas de côté les complexités de la bataille de Mossoul, avec les milices de mobilisation populaire chiites irakiennes, la rivalité chiite-sunnite, les ambiguïtés de la coalition internationale rangée aux côtés d’alliés de l’Iran?
Tout cela est là, il me semble. Mais en pointillé. Sans insister. Prenez la bataille du tout début. Nous tombons, dans le village de Fazlya, dans une embuscade de Daech. Le combat est terrible. Les hommes tombent. Et le soutien aérien américain, malgré les appels de nos compagnons, n’arrive bizarrement pas. Voilà un signe de cette «ambiguïté» de la coalition…
Ce tournage a-t-il changé votre vision de la situation?
J’ai envie de vous dire que le choc le plus important fut le choc «métaphysique». Car Mossoul, après tout, c’est le nom moderne de l’ancienne Ninive. La Ninive du prophète Jonas. La Ninive où les hommes sont devenus, dit le verset, «comme bêtes en grand nombre». La cité du crime et du mal dont la conversion, feinte ou sincère, est au cœur de la méditation juive et chrétienne sur l’idée de rédemption et d’unité du genre humain. J’ai tellement rêvé sur cette histoire! J’ai tant médité sur les interprétations du Malbim, du Gaon de Vilna, de Gershom Scholem – et, sur le versant chrétien, de saint Augustin et de saint Jérôme! Alors, oui, quel choc de se retrouver là, physiquement là, sur ce pôle magnétique, dans l’ombre portée de ces paroles millénaires qui sont au cœur de chacun d’entre nous. La bataille de Mossoul a, aussi, cette dimension spirituelle. C’est, 3000 ans après, la deuxième chute de l’empire des Ninivites et de ses adorateurs du Rien.
Vous semblez être toujours à la recherche d’une cause dans laquelle vous engager. Cela explique pourquoi vous cherchez en permanence le camp du Bien contre celui du Mal?
Je dirais plutôt le camp du moindre mal. Car, au fond, je ne crois pas au Bien… Cela dit, c’est vrai que je suis un témoin engagé et que je n’ai pas le culte de la neutralité. Dans mes reportages de guerre, qu’ils soient écrits ou filmés, ce qui m’intéresse, c’est les civils, c’est les victimes et c’est ceux qui, par voie de conséquence, risquent leur vie pour défendre ces victimes et ces civils. Je serais incapable de faire un film, par exemple, sur une armée conquérante. Je ne me mettrais pas en péril s’il s’agissait juste de couvrir «une» guerre comme une autre. Restons dans la littérature. Il y a un écrivain de la guerre, pourtant considérable, qui ne m’a jamais intéressé: c’est le César de La Guerre des Gaules. Et, si vous regardez le dernier siècle européen, vous avez deux noms immenses. Malaparte qui, dans Kaputt, passe du ghetto de Varsovie à la table du gouverneur général de Pologne Hans Frank ou au panier d’yeux énucléés offerts au narrateur par le dictateur croate Ante Pavelic. Et vous avez Malraux qui conçoit très clairement L’Espoir comme un roman engagé au service d’une cause: celle de ces républicains qui font, comme il le dit, la guerre sans l’aimer. J’admire les deux. Mais le geste dont je suis proche, c’est évidemment celui de Malraux.
Article paru dans Le Figaro le 01/03/2017.
La Bataille de Mossoul
Réalisé par Bernard-Henri Lévy
Un film de 53 minutes diffusé sur Arte le samedi 4 mars à 18h35