Jean-Marie Guénois : Votre livre sonne comme une défense du judaïsme : serait-il si affaibli qu’il ait besoin d’être défendu ?
Bernard-Henri Lévy : Le judaïsme, non. Mais les Juifs, oui. L’antisémitisme est en train de devenir cette religion planétaire dont j’annonce et redoute l’avènement depuis 30 ans. Et, contre cette nouvelle haine ou, plus exactement, contre cette haine ancienne mais qui se donne des habits neufs, il faut, plus que jamais, les défendre.
J.-M. G. : Comment caractériseriez-vous ces habits neufs ?
B.-H. L. : L’antisémitisme d’aujourd’hui s’appuie sur trois propositions. Les juifs sont les amis d’un Etat assassin : c’est l’antisionisme. Les juifs sont des trafiquants de mémoire, ils se servent de leurs martyrs pour intimider le monde : c’est le négationnisme. Les juifs, enfin, sont haïssables parce qu’ils monopolisent le capital mondial de compassion disponible et qu’ils empêchent les hommes de s’émouvoir sur le sort, par exemple, des Palestiniens : c’est le thème, idiot mais terriblement efficace, de la compétition victimaire. Ces trois propositions sont les trois composants d’une véritable bombe atomique morale. Si on les laisse s’assembler, faire nœud, être mis à feu, l’explosion sera terrible. Car il sera de nouveau possible, pour de larges masses d’hommes et de femmes, d’être antijuifs en toute conscience.
J.-M. G. : N’exagérez-vous pas ce risque ?
B.-H. L. : Non. Car la vraie question de l’antisémitisme a toujours été de trouver les arguments, les mots, donnant à sa passion une forme de rationalité et, au fond, de légitimité. Haïr sans en avoir l’air… Faire le mal en donnant le sentiment que c’est un bien… Dire : « nous n’avons rien contre les Juifs, mais ils ont tué le Christ (l’Eglise), mais ils l’ont inventé (Voltaire), mais ils sont les amis du grand patronat et les ennemis de la classe ouvrière (les socialistes du début du XX° siècle) »… Telle a toujours été la démarche… Eh bien c’est la même chose, aujourd’hui, avec ce cocktail détonant qu’est l’association de l’antisionisme, du négationnisme et de la compétition mémorielle : ensemble, les trois peuvent de nouveau donner le sentiment que l’antisémitisme est un discours, certes regrettable, mais normal, presque salubre.
J.-M. G. : Et en même temps, dîtes-vous dans votre livre, le judaïsme lui-même ne s’est jamais aussi bien porté…
B.-H. L. : Oui. Parce que les Juifs, face à cela, craignent de moins en moins d’affirmer leur judaïsme. Longtemps, ils ont eu la tentation de l’ombre. Longtemps, jusqu’à la génération, en fait, de mes parents, ils ont été tentés de penser : « il faut en faire le moins possible, donner le moins de prise possible à l’ennemi, car l’affirmation juive est source de malheur ». Eh bien ce temps-là est révolu. Et je crois que les Juifs de France ont globalement compris que c’est en se cachant qu’on se désarme et en s’affirmant qu’on se renforce.
J.-M. G. : Que s’est-il passé pour qu’on en arrive là ?
B.-H. L. : Une révolution philosophique avec Emmanuel Levinas nous rappelant qu’il y a autant de pensée dans une page du Talmud que dans un dialogue de Platon. Une révolution littéraire avec Albert Cohen et ce prodigieux Belle du Seigneur dont le personnage principal, Solal, aura été le premier juif éclatant, solaire, beau, de l’histoire de l’imaginaire français. Et puis un ébranlement politique avec l’histoire des contemporains de Benny Lévy, cet ancien chef des maoïstes français, devenu le secrétaire de Sartre et substituant au projet révolutionnaire de sa jeunesse une aventure messianique. Les Juifs français d’aujourd’hui sont les héritiers de ces trois gestes. Ce sont eux, ces trois gestes, qui font que l’identité juive peut être une identité heureuse et nouer, à partir de là, sans honte quoique sans orgueil, un dialogue fécond avec les autres.
J.-M. G. : Sans « orgueil » ? Vous avez tout de même cette phrase : « les juifs sont forts, voilà la vérité».
B.-H. L. : Oui. D’abord parce qu’ils ont, eux qui ont toujours été si seuls, des alliés solides – à commencer par les Chrétiens. Ensuite parce que leurs ennemis sont idiots, illettrés, véritables crânes rasés de la pensée – rien à voir avec les Céline, ou les Paul Morand, qui avaient, hélas, du génie. Et puis parce qu’ils sont forts, enfin, d’une force intérieure dont les antisémites, de gauche comme de droite, n’ont pas la moindre idée – et qui est la force de l’esprit.
J.-M. G. : C’est le titre de votre livre, « L’esprit du judaïsme ». Qu’entendez-vous par là ?
B.-H. L. : Si je devais le dire d’un mot : la confiance dans l’intelligence. L’idée qu’une parole ne vaut, et n’est éventuellement sainte, que si elle est commentée, discutée, reprise à l’infini, étudiée. Le contraire, autrement dit, du dogmatisme. L’inverse de la pensée figée qui répète bêtement des idées toutes faites, ressasse sans comprendre et revêt, dit le Talmud, « des vêtements déjà portés par d’autres ». L’esprit du judaïsme, au fond, c’est ce qui s’oppose à l’orthodoxie – à toutes les orthodoxies.
J.-M. G. : Vous évoquez toutefois avec tendresse à la fin de l’ouvrage les juifs orthodoxes de Jérusalem…
B.-H. L. : L’orthodoxie, je vous le répète, c’est la pensée qui s’arrête, le mécanique plaqué sur du vivant, l’esprit qui s’assoupit et cesse de travailler. Or les hyper religieux de Jérusalem, enfermés dans leurs yeshivas, plongés dans le mystère de leurs lettres de feu, les interrogeant inlassablement pour en faire surgir un sens toujours nouveau, sont souvent le contraire de cela et ne sont donc pas, au sens strict, des orthodoxes. On n’est pas orthodoxe quand on lit trop le Talmud. On l’est quand on ne le lit plus assez. Ou quand on cesse, en tout cas, de le lire avec la liberté d’invention qui fut le propre des vrais maîtres.
J.-M. G. : C’est le « génie du judaïsme » dont vous parlez ?
B.-H. L. : Oui. Avec, évidemment, la référence au « Génie du christianisme » de Chateaubriand. Qu’est-ce que le christianisme a apporté au monde, demandait Chateaubriand au lendemain d’une révolution française qui avait, dans le plus pur style Daesh, saccagé les autels, vandalisé les églises et décapité les statues de rois ? Eh bien je pose la même question, mais à propos du judaïsme : ce qu’il ajoute au monde ; de quoi il enrichit le reste de l’humanité ; cette part de poésie et de beauté, ce sens de l’éthique, ce sens de l’humain, dont les humains seraient amputés si, ce qu’à Dieu ne plaise, il n’y avait tout à coup plus de Juifs.
J.-M. G. : Est-ce là « l’universel secret » que vous évoquez ?
B.-H. L. : Exactement. Le Juif c’est comme un petit fantôme qui accompagne les nations en secret dans leur long cheminement, dans leur rencontre avec elle-même, peut-être dans leur épanouissement ou leur rédemption. Il le fait discrètement. En silence. Il est comme ce sable de l’annonce faite aux patriarches (« ta descendance sera comme le sable de la mer »), mais un sable qui se mêlerait au limon des nations pour en conjurer la ténèbre, la lourdeur, la part nocturne et dangereuse. C’est le vrai sens de l’élection. Elu, en hébreu, veut dire littéralement trésor. Et je crois que la singularité juive est le trésor secret des nations.
J.-M. G. : Parmi ces apports du judaïsme vous avez un étonnant chapitre consacré à la France…
B.-H. L. : Vous connaissez, n’est-ce pas, le titre du best seller antisémite d’Edouard Drumont, La France juive ? Eh bien j’ai voulu prendre ce titre à la lettre et, en quelque sorte, le retourner. Et j’ai cherché ce qui, dans le corps de la France, dans son âme, dans son génie singulier, n’existerait pas sans l’apport de ce génie juif que les salopards, genre Drumont et les Drumont d’aujourd’hui, rêvent d’expulser. La réponse est, du coup, assez surprenante. J’ai découvert que la langue française, par exemple, doit beaucoup à l’hébreu. Je montre que notre idée du droit, des droits de l’homme, du contrat social et républicain, doit énormément au paradigme du royaume des hébreux tel qu’on le trouve dans le Livre de Samuel. Et puis il y a la colossale affaire Proust, ce juif secret, ce quasi marrane, dont je montre qu’il était un lecteur du Zohar, qu’il a construit toute La Recherche comme une sorte de nouveau Talmud – et que son judaïsme a fonctionné comme un puissant levier pour relever une littérature française qui, de Mallarmé à Dada, et de Rimbaud à Lautréamont, était en train d’expérimenter toutes les façons qu’a une littérature de mourir…
J.-M. G. : Dans un tout autre domaine, géopolitique, ce livre semble vouloir justifier votre combat en faveur de la libération de la Libye : regretteriez-vous de vous y être engagé ?
B.-H. L. : Pas le moins du monde. Mais je me suis demandé, en revanche, ce qu’un homme comme moi avait bien pu aller faire dans la galère de cette Libye qui n’était, pour paraphraser une dernière fois Proust, franchement pas mon genre. Et, là, s’est imposé le nom de Jonas, le prophète Jonas, qui est l’une des figures les plus énigmatiques de l’Ancien Testament car il est, comme vous le savez, le seul de tous les prophètes à qui il est ordonné d’aller chez l’ennemi, au contact du pire, pour y tenir une parole de vérité. C’est ça pour moi l’expérience libyenne. C’est cet impératif d’aller au-devant, non seulement de l’Autre, mais de l’altérité en ce qu’elle a de plus radical. C’est, précisément, ce que j’ai fait.
J.-M. G. : Et si ça tournait mal ?
B.-H. L. : Je vous dirais qu’on peut avoir transitoirement tort et absolument raison. Autrement dit : admettons que l’islamisme radical, par exemple, triomphe à Tripoli – ce qui, par parenthèse, et contrairement à ce qui se répète partout, n’est, pour l’heure, absolument pas le cas. L’histoire des hommes est longue. Les idées justes y prennent leur temps pour cheminer, se perdre et revenir. Mais elles sont là. Elles s’inscrivent dans cet autre temps, ce temps secret, qui est comme le conservatoire du vrai. Et vous verrez qu’un jour ceci apparaîtra : dans la longue histoire, si tumultueuse, si pleine de malentendus, des relations entre le monde arabo musulman et l’occident, il y aura eu un moment, un seul, mais décisif, où l’on aura vu des aviateurs français et américains, des présidents Sarkozy et Obama, prendre pour la première fois le parti d’un peuple contre son tyran. C’est très important. C’est, d’ores et déjà, une date majeure dans le calendrier métapolitique de notre temps.
J.-M. G. : Ce livre, votre 30ème, est donc le livre d’une vie ?
B.-H. L. : C’est, en tout cas, le plus intime. Celui où je suis allé le plus profondément en moi. Et puis le seul de tous mes livres dont je m’aperçois que j’aurai différé l’écriture pendant plus de vingt ans. J’y songe depuis la guerre de Bosnie. Je l’ai plusieurs fois abandonné puis repris. Et j’ai décidé de l’achever, là, dans l’anxiété et la rage, face à cette France que j’aime tant mais qui est tout de même aussi celle de l’assassinat d’Ilan Halimi, de cette école toulousaine où l’on tue une fillette d’une balle dans la tête juste parce qu’elle est juive, ou des manifestations pro palestiniennes où l’on crie « mort aux Juifs » dans les rues de Paris. La question fondamentale du livre reste, pour autant, celle que je laissais en suspens, il y a 37 ans, dans Le Testament de Dieu : en quoi importe-t-il à l’économie, non seulement du monde, mais de l’Être que perdure l’exception juive ?
J.-M. G. : Mais pourquoi écrivez-vous que « Dieu est en retrait » ?
B.-H. L. : Parce que c’est, je crois, l’expérience juive fondamentale. Et, probablement aussi, la grande différence avec le christianisme. Le chrétien croit ; le juif sait. Pascal joue le pari ; Maïmonide la connaissance. L’expérience chrétienne, dans ce qu’elle a de plus génial et de plus beau, suppose le saut dans la foi, la communion avec le Seigneur ; l’expérience prophétique, dans son propre et prodigieux génie, est plutôt celle du ciel vide et du Dieu qui, comme chez les kabbalistes, se retire du monde et menace de le décréer. Je vais trop vite, bien sûr. Et je sais qu’un Jean-Luc Marion, mon condisciple de la rue d’Ulm, me répondrait que la foi, elle aussi, est un savoir et que le chrétien reste un juif dérivé. Mais enfin c’est tout de même, en gros, en très gros, ma vision de la chose.
J.-M. G. : Dieu est là pour autant…
B.-H. L. : Oui… Il est là sans l’être. Il a créé le monde – mais peut, tout aussi bien, le décréer. C’est l’intuition si belle, et si terrible, de Rabbi Haïm de Volozhine, l’un des inspirateurs permanents du livre.
J.-M. G. : En quoi croyez-vous au fond ?
B.-H. L. : Je crois, encore une fois, que la question n’est pas de croire mais de savoir. Ou, si vous préférez, que la question de la croyance en Dieu, de l’existence de Dieu, de sa volonté bonne ou non, de ce Dieu personnel qui a voulu le mal ou qui l’a fait malgré lui, n’est centrale que si on regarde le judaïsme avec les lunettes de l’entendement chrétien et, en particulier catholique. Levinas l’a parfois fait. Rosenzweig aussi. J’essaie de résister à la tentation.
J.-M. G. : Votre sœur, convertie au christianisme, décrit dans un livre récent, une communion mystique avec le Christ ?
B.-H. L. : Nous en parlons souvent. Nous sommes restés très proches et elle demeure – est-il besoin de le préciser ? – ma petite sœur chérie. Mais j’avoue que je n’ai pas compris. J’ai lu son livre. Il est beau. Mais, avec cette volonté de sauter les degrés, de courir à la conclusion qu’est la communion, avec cette façon de bruler les étapes pour arriver, en avance, au « Arrive Feu » de Holderlin, elle se situe dans un imaginaire qui n’est tout à coup plus le mien. Alors, nous en parlons, oui. J’essaie de la mettre en garde contre la radicalité où elle me semble, parfois, tentée de s’engager. Mais je ne suis pas sûr que nous nous comprenions encore. Au stade où elle est parvenue, seule une dispute à l’ancienne, une disputatio, pourrait peut-être permettre d’y voir clair. Je ne sais pas.
J.-M. G. : Est-ce la personne du Christ qui vous trouble ?
B.-H. L. : Non. Pour moi, le Christ est un grand juif, d’exception, mais c’est un juif quand même et je n’ai jamais eu de problème particulier avec cette façon de se dire fils de Dieu et de tenter se hisser, d’un seul coup, au niveau de la plus haute vérité et du martyre.. Le problème c’est la foi, cette foi de ma petite sœur qui diffère, oublie, jette aux orties, le commandement « tu feras et tu entendras » qui est le coeur de mon judaïsme mais dont je vois bien qu’elle a perdu le sens.
Entretien avec Jean-Marie Guénois pour le Figaro




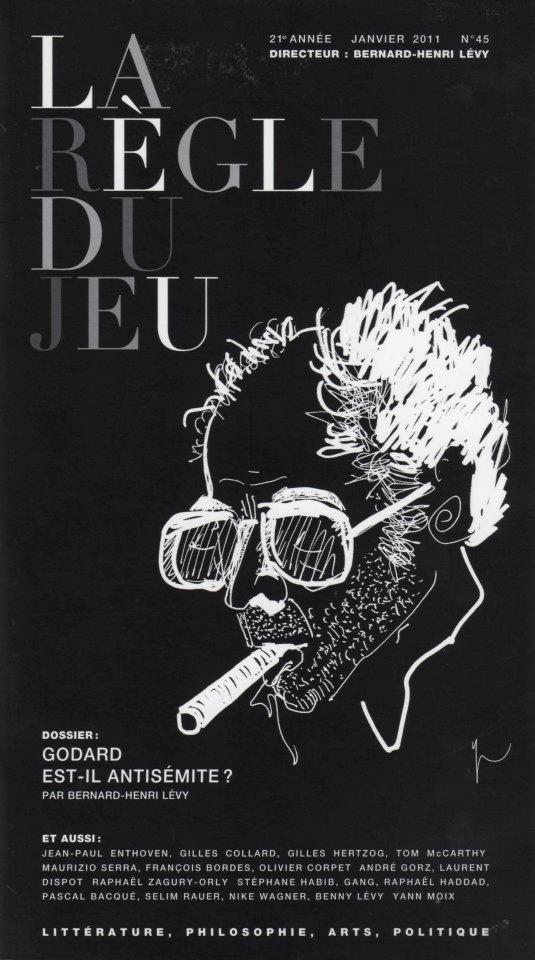




Je suis issu d’un peuple lui-même issu d’une religion elle-même issue d’un homme lui-même issu de ce qu’il appelait Un Dieu. Si je suis Juif par percussion, je suis juif à coup sûr mais par répercussion. Traversé par cette commune structure mentale que Freud se reconnaissait lorsqu’il lisait les auteurs juifs, que leur rapport au judaïsme soit résiduellement cultuel ou inexplicablement culturel. Juif tel qu’un poète israélien dont j’ai oublié le nom expliquait que, nonobstant son athéisme revendiqué, tout Juif est possédé par Dieu. C’est avec tout cela à l’esprit que j’ai ouvert l’Esprit du judaïsme comme on rouvre un fruit défendu dont je pressentais qu’il était un de ces livres doté du pouvoir d’affermir la légitimité de son auteur en tant que penseur juif et, par voie de conséquence, penseur stricto sensu. La légitimité est une valeur d’une densité trop incontestable pour ne pas donner à ses contradicteurs l’envie virale de la fracasser. Parce qu’il est un livre on ne peut plus lévysien, c’est donc la pensée du métaprésident de la Première Internationale universaliste qui fait désormais corps avec le corpus hébraïque. Une pensée pas toujours croyante. Une pensée quelquefois mécréante. Une pensée qui, en tous les cas, se raccroche à une foi indéfectible dans un innommé qui aurait le pouvoir de préserver ce qui a été fait à l’image de l’Invisible en face de tout ce qui déforme, voire déchire cette image. Impossible alors de m’essayer au commentaire d’un livre qui doit dès à présent prendre place parmi les siens, chevillé au chevet de l’homme qui étudie. De ces livres avec lesquels on dialogue toute une vie. Dont il faut s’imprégner de la pensée profonde. Qu’il faudra donc approfondir et, par là même, relire au moins autant de fois qu’il a été écrit. Un livre sur l’Esprit qui, forcément, dépasse le judaïsme au non-sens de son terme. Un livre qui, en très haute compagnie, ne sera jamais inexistant dans nos pensées à venir. Avertissement à ceux qui se mettraient en chasse pour débusquer le petit plus, la valeur ajoutée de l’âme désespérément enclose dans le champ de l’individualité et qui, pourtant confortablement sise, se décide à plonger dans l’océan de l’Esprit… quand on s’embarque dans l’Histoire vue par les Juifs, le point cardinal se confond toujours avec le point de détail. Je commencerai donc, sans plus attendre, par demander pardon à l’auteur si, dans les minutes qui me seront imparties, je ne pourrai pas m’empêcher de faire le mauvais juif. Et prenant garde à ne pas me glisser entre le fils et la fille de Lévi, je m’attarderai, si l’un et l’autre me le permettent, sur un point de christologie que le penseur a, si j’ose dire, trop abordé en juif. Car l’Église de Rome ne voit pas dans Jésus le fils de Dieu. Si tel était le cas, Jésus serait d’une essence distincte de celle de Dieu et, en l’espèce, ne serait pas Dieu. Or Jésus est Dieu. Je sais, j’ai longtemps ressenti le concept de l’Incarnation comme la chair appréhende un ongle mal coupé, mais à force de lire les Pères de l’Église, ayant couru, un jour d’écœurement lancinant poussant au lâcher prise, le risque de me retrouver, moi l’enfant mixte, en face de la contradiction vivante qui me rongeait l’âme, je crois bien m’être familiarisé avec leur étrangeté fondamentale. Et si je demande aux chrétiens de tenir compte de ce que je vais m’écorcher la bouche pour tout dire comme ils disent, j’affirme, face au temple extraterrestre, que, selon les évêques réunis à Nicée autour de Constantin Ier, celui que Daniél a nommé Fils de l’homme, c’est-à-dire le Messie, est déclaré Fils du Père. Ceci fait référence au passage de l’Évangile où Rabbi Iéshoua‘, avant d’expirer sur la croix, aurait prononcé le nom d’Abba, litt. : Père (hébreu ancien), en s’adressant à IHVH : «Papa, Papa, pourquoi m’as-Tu abandonné? » Dieu étant unique, Il ne pouvait avoir engendré un Être qui n’eût pas partagé Son unicité, un seul Fils pour le Dieu qui L’a engendré tout seul, un seul Esprit commun aux deux, les trois consubstantiels les uns aux autres. En somme, Jésus est Dieu au même titre que le Père ou l’Esprit saint peuvent L’être. Je suppose, et sur ce point la sœur du philosophe ne me contredira pas, et sur ce point le grand frère de la Sœur ne manquera pas d’en apprécier la nuance avec la délicatesse qui s’impose, qu’il y a une différence profonde entre le fait d’unir sa vie à celle d’un fils de Dieu et le fait de former une alliance indicible avec le Fils du Père.