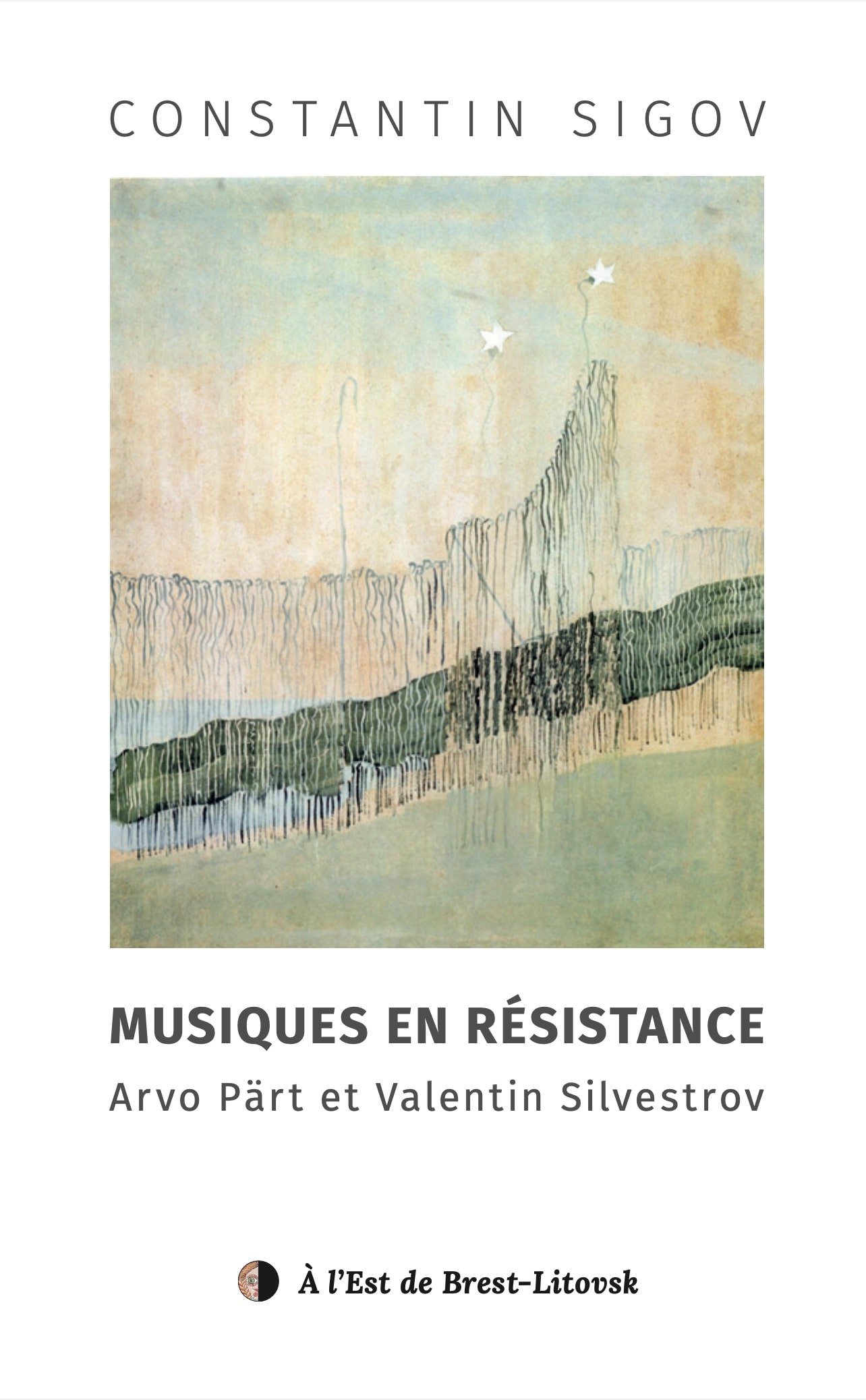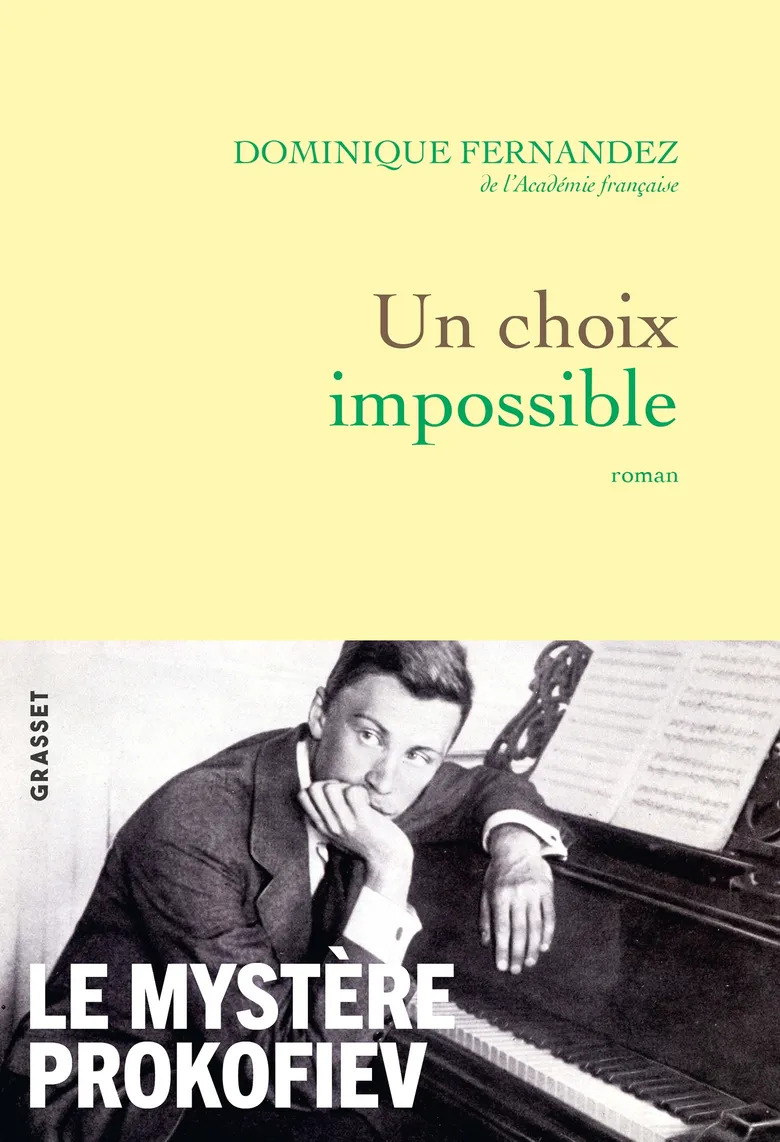La tragédie que fut l’emprise stalinienne sur la culture russe n’a cessé d’interpeller les historiens et les intellectuels européens jusqu’à nous. Face au bâillon que le Moloch totalitaire entendait imposer sur les arts et la pensée, qu’ont fait les intéressés en Russie soviétique ? Deux nouveaux livres sur ce sujet qui hante la mémoire du vingtième siècle s’emploient à nous éclairer, à travers les vies de quatre compositeurs aux prises avec le Léviathan stalinien et ses succédanés : Prokofiev et Chostakovitch dans la première moitié du siècle, Avro Pärt et Valentin Silvestrov dans la seconde.
L’histoire de la culture russe à l’ère du totalitarisme est pavée de cadavres. La chasse contre l’intelligentsia commence à la fin des années 1930, par des milliers d’assassinats et de déportations au Goulag. Elle s’interrompt à l’invasion allemande, reprendra après. Pour les Européens que les mirages du communisme égalitaire et le culte du despote n’abusaient plus, les poètes, écrivains, scientifiques, artistes qui avaient été en butte à la Terreur stalinienne, y avaient laissé la vie ou survécu par miracle, firent figure de symboles. Dénoncés comme des ennemis du peuple, exécutés à la Loubianka, déportés au Goulag, réduits pour les plus chanceux à la misère et au silence, ils s’appelaient Pilniak, Mandelstam, Babel, Akhmatova, Tsvetaïeva, Meyerhold, Grossman, Pasternak, Soljenitsyne, Chalamov. En Occident, très vite, leur sort fut tenu pour un crime contre l’esprit.
Après la mort de Staline en 1953, le dégel khrouchtchévien dura dix ans. La parenthèse se referma. Lui succéda la férule brejnévienne. Haro, de plus belle, sur le cosmopolitisme occidental ! Arrière, le formalisme en art ! Défense du réalisme socialiste ! La génération intellectuelle et artistique de ces années de plomb a connu le bannissement, les proscriptions, le placement en asile psychiatrique, l’exil forcé. Ce regel, pour autant, a été le terreau des dissidents : Brodsky, Martchenko, Sakharov, Nekrassov, Medvedev, Boukovski, Pliouchtch, Grigorenko, Paradjanov, Ginzburg, Siniavski, Sharansky. Face au temple orwellien du soviétisme, cette intelligentsia rebelle, mettant à nu la novlangue officielle, a rendu justice dans ses œuvres en samizdat, par ses actions sous le manteau, aux morts du Goulag restés sans noms ni sépultures. Parallèlement, ces activistes de la vérité ont brossé en creux le tableau d’un peuple russe perclus de servitude. En Occident, politiques et intellectuels soutenaient leur combat. Le prix Nobel de littérature attribué en 1970 à Soljenitsyne, puis la parution en Europe, trois ans plus tard, de son Archipel du Goulag, ont amplifié ce basculement de l’image de l’URSS dû aux dissidents. Cela a donné en France, rompant avec le marxisme et l’idée même de révolution, le mouvement des nouveaux philosophes. Sur place, les procureurs solitaires de l’oppression totalitaire, sans autre mandat que leur conscience d’hommes révoltés, ne furent pas pour peu dans la chute du communisme au cœur même du pays qui l’avait vu naître. Lucioles héroïques clignotant dans la nuit moscoutaire, ils l’avaient emporté ; 1991 vit la fin de l’URSS. Ils n’ont pas eu, hélas, de descendants dans la Russie poutinienne.
Venons-en à la musique. Là comme ailleurs, il y eut tout l’éventail, durant l’ère communiste, des lâchetés et du courage. Il y eut les parangons purs et simples du régime ; il y eut ceux qui plièrent, acceptèrent les compromissions ; il y eut ceux, une poignée, qui tentèrent de sauver d’un même mouvement leur âme et leur art, ceux qui se prêtèrent aux pires commandes tout en continuant à créer « pour le tiroir ». Comme la musique demeurait l’un des grands piliers de la civilisation et de l’identité russes, les compositeurs semblent paradoxalement avoir échappé davantage que les représentants d’autres disciplines à la persécution par les autorités durant l’ère communiste. On avait besoin des meilleurs pour galvaniser les masses durant la Grande Guerre patriotique, puis, la paix revenue, pour exalter l’avenir radieux, les lendemains qui chantent, et construire l’homme de fer du futur. La répression s’exerça au gré des circonstances, les allers et retours en grâce furent nombreux. Trois célèbres cas illustrent ce traitement bifide : Sergueï Prokofiev, Dmitri Chostakovitch – objet d’une biographie romancée de Dominique Fernandez, intitulée Un impossible choix – et Aram Khatchatourian.
Prokofiev, d’abord. Lassé de se produire, dans l’ombre de Stravinsky, en avant-gardiste zélé devant les publics snobs d’Europe et d’Amérique, Prokofiev, qui s’était exilé en 1918, rentre en Russie en 1936, atteint du mal du pays et plein d’une ardeur prolétarienne, rêvant de mettre la musique moderne à la portée des masses. Il est accueilli en héros, alors que débutent les purges et que, dans la Pravda, un article assassin rédigé par Staline en personne éreinte un opéra de son alter ego Chostakovitch. Passés les premiers succès – dont Pierre et le loup –, la descente aux enfers commence. Appels du pied des instances officielles de la musique d’État, invitations répétées à produire de grandes compositions symphoniques sur des thèmes prométhéens tels que la construction des barrages, le percement du canal Baltique, les combinats sidérurgiques, les kolkhozes et autres chromos du monde nouveau. Impossible de se dérober. Le pic de la servilité, chez Prokofiev, sera atteint en 1939 avec Zdravitsa, une ode à Staline pour ses 60 ans, dont voici les paroles édifiantes : « La vie maintenant est meilleure, elle est devenue plus joyeuse. Le soleil brille sur la terre pour nous d’une manière différente. Il semble avoir visité Staline au Kremlin. Il voit tout, entend tout, la manière dont le peuple vit et travaille, et il récompense chacun pour ses efforts. Il invite chacun à le voir à Moscou. Il les accueille avec le sourire, en personne […]. Vous êtes la flamme qui fait bouillir notre sang, Ô Staline. » Le génie musical est devenu un vulgaire propagandiste, un flagorneur du tyran. Prokofiev recevra le prix Staline en 1943. Pour autant, Dominique Fernandez, dans son livre, se refuse à condamner Prokofiev ; il risquait sa peau, sa famille était retenue en otage dans l’Oural. Fernandez cite en miroir un poème d’Éluard qui, lui, ne risquait rien :
« Et Staline pour nous est présent pour demain
Et Staline dissipe aujourd’hui le malheur
La confiance est le fruit de son cerveau d’amour
La grappe raisonnable tant elle est parfaite »
Fernandez va plus loin. Il prête à Chostakovitch, interdit d’opéra, l’invention d’une méthode : l’autosabotage des œuvres de commande par la boursouflure systématique, l’emphase programmée, l’orchestration dégoulinante. Trop contents d’avoir fait plier le rebelle moderniste, tout à leurs flagorneries, les commanditaires n’y verraient que du feu. Les vrais mélomanes, les aficionados, eux, ne seraient pas dupes, comprendraient qu’il s’agissait là d’un masque, d’un double langage. Le procédé était aussi ingénieux que risqué. Mais sans chercher plus avant, la presse occidentale se déchaîna contre le malheureux Prokofiev pour son ode à Staline.
La culture, l’art, devaient impérativement illustrer les canons politiques et esthétiques du réalisme socialiste. Impossible de passer outre. Prokofiev et Chostakovitch, sommés d’entonner les mêmes péans insanes à la gloire du tyran, endurèrent la même censure, les mêmes humiliations. La même épée de Damoclès a plané au-dessus de leurs têtes jusqu’à la mort de Staline en 1953, dans une alternance de chauds et de froid, ponctuée de commandes impératives, de mea culpa publics ; mais cette période n’a pas été moins riche de créations cachées, comme si l’oppression aiguisait le génie créatif – ces œuvres attendraient des jours meilleurs que le cauchemar prenne fin.
Chostakovitch, on l’a dit, eut droit aux foudres de Staline en 1936 pour un opéra avant-gardiste. Revenant l’année suivante à un classicisme tempéré, avec la Cinquième symphonie dont le sous-titre – « Réponse créative d’un artiste soviétique à de justes critiques » – sonnait comme une rétractation, il obtiendra le prix Staline en 1941. Pendant la guerre, il écrira des symphonies patriotiques sur les sièges de Léningrad et Stalingrad, et en 1947 il sera élu député au Soviet suprême de Russie. Mais l’embellie allait être de courte durée. Fin janvier 1948, l’inquisiteur en chef de la culture soviétique, gardien de l’orthodoxie stalinienne, Jdanov, convoque au siège du Comité central du Parti communiste le ban de la musique soviétique : les compositeurs, dont, au premier rang, mines défaites, Prokofiev, Chostakovitch, Khatchatourian, les plus grands solistes, les chefs d’orchestre prestigieux, ainsi que la presse étrangère. Tous sont littéralement pétrifiés. Jdanov leur fait la leçon comme à des délinquants, pilonne la musique moderne, atonale, dissonante, bruitiste, chaotique, tout en rythmes, sans ligne mélodique, antipopulaire, individualiste, cosmopolite et décadente, à l’image de ces portraits cubistes où le nez est à la place des yeux. Deux semaines plus tard, un décret établit la liste des œuvres prohibées : presque tout Chostakovitch et Prokofiev y passent. Chostakovitch multiplie les autocritiques – en vain. Frappé d’ostracisme, proscrit, privé de revenus, Prokofiev mourra en 1953, le même jour que son persécuteur en chef, Staline.
À côté du calvaire qu’ont subi Chostakovitch, Prokofiev et tant de créateurs soviétiques sous Staline puis ses épigones, le sort d’Avro Pärt et de Valentin Silvestrov, deux contemporains amis, âgés l’un et l’autre aujourd’hui de près d’un siècle, semble léger. Il n’en fut rien. Nés quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, l’un en Estonie passée bientôt aux mains des Russes, l’autre à Kiev au temps de la domination soviétique, tous deux allaient inventer une nouvelle musique, quasi liturgique, empreinte de spiritualité. Accusés de saper les fondements du réalisme socialiste, ils furent exclus dans leurs pays respectifs de l’Union des compositeurs. Pärt s’exila à Berlin en 1980 et, en 2006 et 2007, il dédia ses concerts à la mémoire de la dissidente russe assassinée par le régime de Poutine Anna Politkovskaïa. Silvestrov opta quant à lui pour l’exil intérieur, où il écrira notamment un cycle pour chœur a cappella lors de la Révolution du Maïdan, avant de rejoindre Berlin après l’invasion russe de l’Ukraine en 2022. Admirateur depuis toujours de ces deux grandes consciences musicales unies une fois encore dans le malheur, le philosophe Constantin Sigov, à la tête du Département de français de l’Université Mohyla de Kiev, leur consacre aujourd’hui un émouvant portrait (écrit directement dans la langue de Molière !). Entre témoignage vivant – vox musica, vox memoria –, piété filiale, aperçu de musicologie (on y apprend ce qu’est le tintinnabuli chez Pärt) et traité sur la liberté face au nihilisme – dont le rétablissement de l’hymne soviétique en 2000 sonnait les trois coups –, on est emporté. Quelle flamme, quelle passion chez Constantin Sigov ! À le lire, l’âme de l’Ukraine combattante est plus forte que jamais. Pärt et Silvestrov, combien de divisions ? devrait peut-être se demander Poutine.
Sigov explique : « La stratégie de Staline et de Jdanov était inscrite dans la résolution du Comité central du parti communiste datée du 10 février 1948 “Relative à l’opéra de V. Mouradeli La grande amitié”, publiée dans la Pravda du 11 février 1948 et qui stipulait : “s’agissant des compositeurs dont l’orientation est de nature formaliste et hostile au peuple. Cette orientation a trouvé son expression la plus achevée dans les œuvres de compositeurs comme D. Chostakovitch, S. Prokofiev, A. Khatchatourian, où ressortent avec une évidence particulière des perversions formalistes et des tendances musicales antidémocratiques étrangères au peuple soviétique et à ses goûts artistiques…” »
Pour l’heure, l’histoire de la Russie et de ses voisins se répète inlassablement. De Staline à Poutine, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Entre la terreur et la liberté, la partie, sanglante, continue. Et alors que le destin de l’Europe se joue en Ukraine, les musiques en résistance d’Arvo Pärt et de Valentin Silvestrov reflètent le courage d’un pays engagé dans un combat vital.
Mais si, là-bas, la musique, les arts, la pensée, combattent le crime contre l’Ukraine en arrière des soldats, où sont, en Russie ou en exil, les Maïakovski, les Boulgakov, les Eisenstein, les Pasternak, les Sakharov d’aujourd’hui et de demain ?