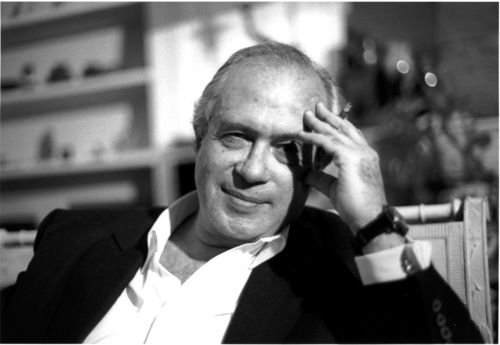Il devait être dix-huit heures, dix-huit heures trente peut-être, un vendredi, quand le téléphone sonna. Le fixe, qui ne sonne quasiment plus. C’était une femme, qui cherchait un psychanalyste qui accepterait de faire les consultations au téléphone car, m’expliqua-t-elle, elle était agoraphobe, il était hors de question qu’elle sortît de chez elle. Je lui demandai à quel moment de sa vie le fil avait cassé. Il y avait vingt-six ans, à vingt-deux ans. Le fil ténu et puissant qui l’avait liée à sa mère, à son père et à son frère avait cassé net lors du divorce de ses parents, et ce qu’elle appelait ses « symptômes » depuis roulaient tout seuls. Elle m’expliqua encore qu’elle n’avait plus d’amis, plus de fréquentations, qu’elle ne supportait pas le moindre contact humain, que même croiser quelqu’un dans la rue lui était insupportable, qu’elle ne se risquait plus dehors que la nuit, ne s’éloignant jamais de plus de cent mètres de son immeuble, laissant ouverte une fenêtre de l’appartement qu’elle occupait au rez-de-chaussée au cas où il lui faudrait vite rentrer : l’idée d’avoir à chercher ses clefs pour ouvrir d’abord la porte d’entrée de l’immeuble, puis la porte d’entrée de l’appartement la plongeait dans un état de panique.
Pour ses besoins alimentaires, pour ses besoins vestimentaires, pour tous ses besoins, elle se faisait livrer. Les livreurs devaient poser devant sa porte ce qu’elle avait commandé et payé en ligne, sonner deux fois et partir. Alors seulement elle ouvrait la porte et récupérait les paquets déposés. Depuis vingt-six ans la vie était suspendue, la vie n’en finissait pas de finir.
Voilà du sérieux, et qui serre le cœur. Elle m’avait ému, j’acceptai donc d’être celui pour qui, en même temps que pour elle-même, elle ferait l’agoraphobe, s’acharnerait à se faire reconnaître comme seulement victime, avec ferveur rejouerait son sort, refuserait tout espoir, toute lueur, toute chance, tout encouragement, tout humour, tout pas de côté, tout éloignement de son malheur. Le fondement de la réalité, de ce qui se donnait pour tel, c’était le mal qu’on lui avait fait et la haine que ce mal faisait vivre en elle. Elle s’était cousu le masque de la victime haineuse à même la peau. C’est un état de vie coûteux. Folle de rage sous ce masque, verrouillée dans un questionnement éperdu, déboussolée, rien ne semblait exister pour lui faire pièce ou l’amener à abandonner cette place qui était comme un trône sur lequel elle était assise mais dont elle disait qu’il est une prison, un cercueil. Privée de vie personnelle, de maison, elle avait fait de la vengeance de ce sort sa seule raison de vivre, et le sérieux avec lequel elle s’y employait serrait le cœur. Elle disait qu’elle avait le cerveau comme de la viande morte, pourrie par la méchanceté des gens, des choses, de la vie. C’est ce qu’elle répétait, inlassablement, hargneusement, comme une espèce de laus perennis, de paradoxale louange perpétuelle, de prière ininterrompue, mais assurée par elle seule et non par trois équipes de moines se succédant. Elle ne vivait plus que pour mettre à mort ceux qui ne l’avaient fait naître que pour l’abandonner. Ces monstres étaient sur terre sa principale compagnie ; elle voulait tuer des irremplaçables. Ce sont leurs voix despotiques que dans son parlement intérieur elle entendait. Rien ne lui était plus intime, à le fois plus cher et plus méprisable, plus écrasant et pourtant plus indispensable. C’est une lente et terrible vie dans laquelle elle était verrouillée, dans laquelle tout allait plus vite qu’elle, trop vite. C’est une petite fille qui avait vieilli sans devenir femme, qui allait vainement souffrir jusqu’à la vieillesse. Car dans cette souffrance sans nom, elle s’était peu à peu confondue avec ses bourreaux. À force de les haïr, elle leur ressemblait. À force de les poursuivre, elle portait en elle leur ombre. Il n’y avait plus de frontière entre la vengeance et la mémoire, entre la douleur et la fidélité à cette douleur. Chaque jour, elle rouvrait les plaies pour se souvenir qu’elle avait existé, qu’on l’avait brisée, qu’il restait encore quelque chose à punir. Mais les visages s’effaçaient, les voix se confondaient – et c’est contre le vide qu’il lui faudrait lever les armes. Il me fallait le lui faire entendre. Lui faire entendre que tuer ne la délivrerait pas. Que ces êtres qu’elle maudissait n’existaient plus qu’en elle, et qu’il lui faudrait s’arracher elle-même pour les anéantir. C’était là sa dernière bataille : s’effacer sans disparaître, se taire sans mourir, devenir enfin étrangère à ce qu’on avait fait d’elle. Mes efforts pour le lui faire entendre la mettaient en rage – tellement qu’elle mit brusquement fin au travail que nous avions engagé. Plusieurs mois passèrent, puis elle me rappela. Pour me dire que dans le silence qui avait suivi, pour la première fois, elle avait senti la lenteur du monde la rejoindre – non plus pour la devancer, mais pour l’attendre. Le monde autour d’elle respirait encore, un souffle tiède, indifférent, presque doux. La vie, malgré tout, persistait, même dans les ruines. Il n’y avait plus d’ennemis à abattre, plus de spectres à poursuivre. Seulement le silence, vaste et presque pur, qui s’étendait là où jadis régnaient la peur et la rage. C’était insupportable d’abord – ce vide sans haine –, mais peu à peu il prit la forme d’un apaisement. Elle put se souvenir de l’enfant qu’elle avait été, celle qu’on n’avait pas protégée. Elle voulait lui parler, lui dire que la guerre était finie, qu’il n’y avait plus rien à craindre, plus rien à prouver. Peut-être même qu’on pouvait encore aimer. Elle en pleurait – non de douleur, mais d’une fatigue ancienne, délivrée enfin. Et dans ces larmes, il y eut tout : la mort, la vengeance, le pardon, et la première esquisse d’un retour à la lumière. C’est ainsi qu’elle comprit, me dit-elle, que survivre n’était pas un hasard, mais un choix. Et que, peut-être, au bout de toute haine, il reste une dernière tendresse : celle qu’on se doit à soi-même.