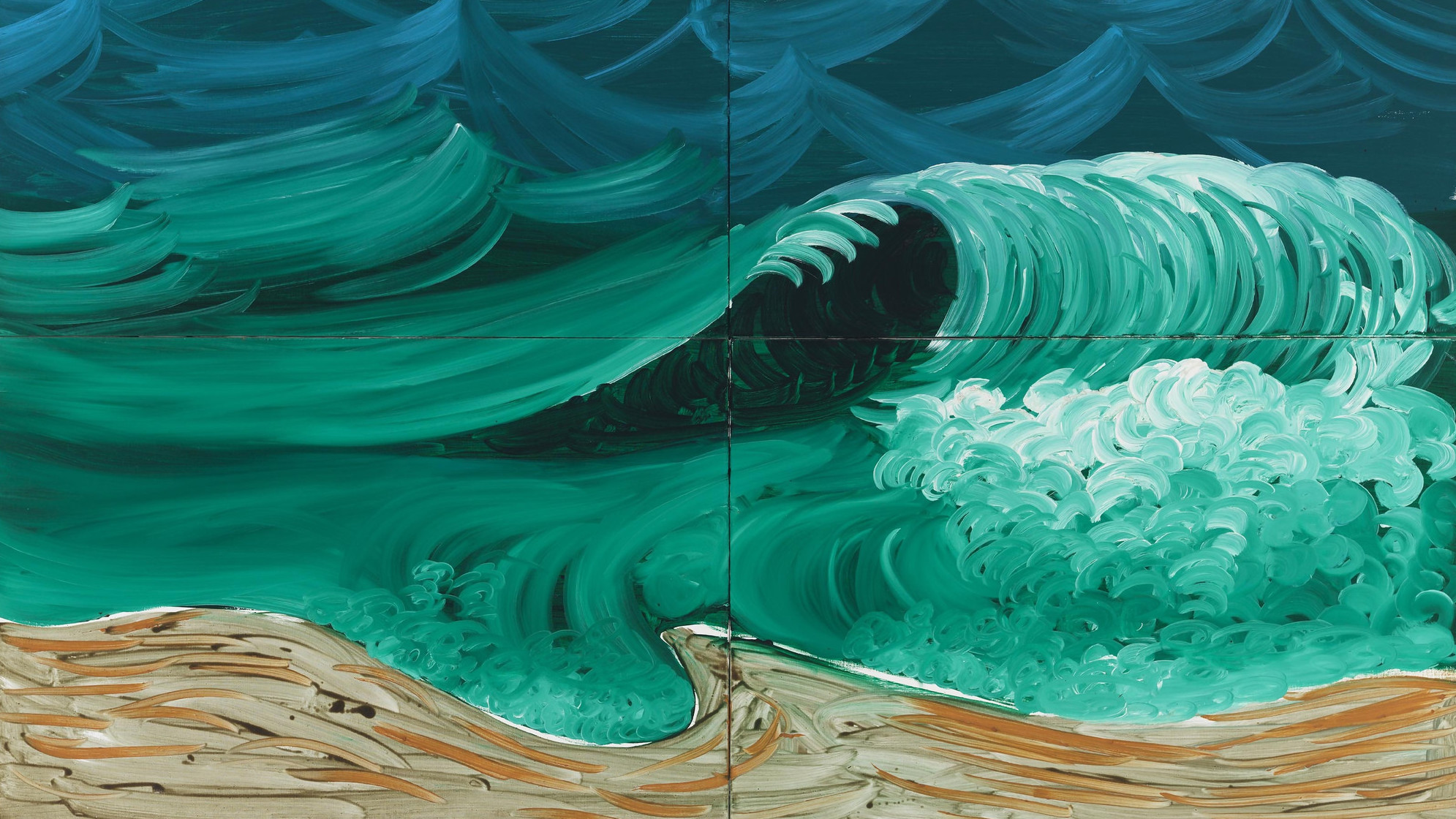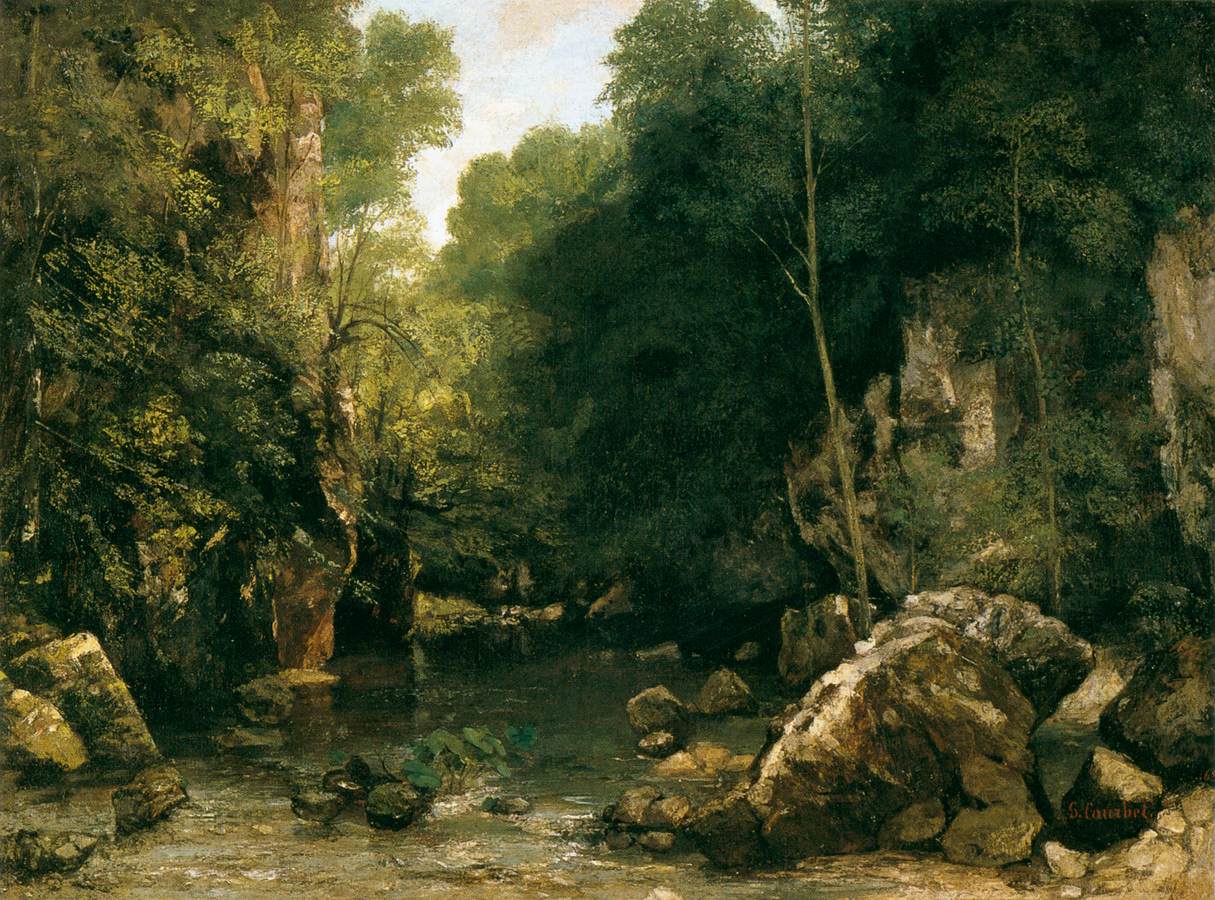Je suppose que je devrais avoir honte ; pas possible, un choix pareil. Je vous dirai, vous verrez. Mais d’abord, je vous explique les circonstances atténuantes. C’est que je n’étais pas de leur monde, tous ces gosses de bourgeois qui tenaient bien en ordre leurs petites affaires, qui travaillaient en conscience, qui savaient leurs règles et avaient de l’élégance dans les tournures.
Moi, mes affaires, je ne les tenais pas en ordre ; je les oubliais, les égarais, parfois je les perdais. On aurait presque dit que je n’y tenais pas, mais ce n’était pas ça. C’était plutôt que je décrochais à tous les niveaux – scolaire, mais pas seulement – et que je ne savais pas quoi faire de moi-même. Alors, mes affaires, voyez, je n’en avais pas grand-chose à foutre. Pour les règles, en revanche, c’était autre chose. C’est qu’elles m’étaient inaccessibles. Je n’arrivais pas, comme on dit, à les « intégrer ». Si bien que je prenais les choses comme elles venaient, sans trop comprendre et sans pouvoir même me demander quelles conséquences mes réponses, mes réactions, mon comportement pourraient avoir, ni imaginer ce qu’il faudrait assumer plus tard. Remarquez, dans l’ensemble, je restais plutôt tranquille. J’étais tellement mal dans ma peau, je n’osais pas me mêler aux autres, les copains, les filles, tout ça, je ne savais pas comment faire. J’étais comme celui que décrit la chanson de Roland Hayes, vous voyez qui c’est? Le ténor noir des Fisk Jubilee Singers, cette chorale d’étudiants de la Fisk University, fondée en 1871, qui chantaient surtout, a capella, des negro spirituals : « Sometimes I feel like a motherless child; sometimes I feel like I never was born, then I go down and pray; sometimes I feel like a feather in the air. » D’accord, ça ne vous dit rien ; une chanson du début des années 20, qui est-ce que ça pourrait intéresser à part un inadapté comme moi ? Bon, bref, j’étais à côté de la plaque, à côté de mes pompes, j’étais ailleurs, je ne comprenais pas comment c’était, la vie, les mille façons qu’elle a de se donner des formes et des forces. Surtout au milieu de ces gosses de bourgeois, comme je vous disais, qui me semblaient former une communauté de certitudes avec leurs codes, leurs joies, leurs luttes, leur système de valeurs achevé.
Il me fallait un refuge, une planque, un trou où me cacher. Je l’ai trouvé par hasard, une fin d’après-midi d’hiver, à l’étude. On appelait comme ça l’heure qui était réservée en fin de chaque journée aux devoirs et à la préparation des leçons du lendemain. J’en avais profité ce jour-là pour lire un livre que j’avais piqué à mes parents. Un très mauvais roman : A Stone for Danny Fisher, de Harold Robbins. Tout le monde lisait Harold Robbins à cette époque. Enfin, tout le monde auquel appartenaient mes parents, ce qui fait déjà pas mal de monde. Bref, j’ai oublié le roman, une histoire de jeune boxeur très doué, issu d’une famille juive et pauvre de Brooklyn, qui refuse de truquer un match et qui le paye de sa vie. Mais je n’ai pas oublié l’effet qu’il m’avait fait, surtout sa liaison avec Nellie, une jeune fille catholique, qui scandalisait sa mère. On en a aussi tiré un film, que je n’ai pas vu : King Creole, avec Elvis Presley, vous voyez le genre. Honteux je vous dis. Mais c’est comme ça, il faut se rendre à l’évidence, les expériences par lesquelles nous nous inventons une place dans le monde ne sont pas toujours recommandables. On apprend le « comment » de la vie dans les lieux les plus improbables. Et la lecture de ce roman et de quelques autres du même Robbins – Never Love a Stranger, The Dream Merchants, Never Leave Me, The Carpetbaggers, Where Love Has Gone, The Adventurers, 79 Park Avenue –, il en a publié vingt-trois, tous aussi mauvais, aussi mal écrits les uns que les autres, vendus au total à plus de 750 millions d’exemplaires tout de même, excusez du peu, cinquième plus gros vendeur dans l’histoire du livre, a fait partie des expériences qui ont contribué à me révéler ce à quoi par-dessus tout je tenais : le sexe, l’argent et, aussi étrange que cela puisse paraître, les livres. Eh oui, c’est comme ça, je suis venu à la littérature d’abord grâce à ces mauvais livres, dans lesquels les femmes étaient clémentes, l’argent moins rare et les plaisirs excessifs. C’est que ces livres me faisaient croire sinon que ça allait mieux, du moins que ça allait aller mieux ; que ma condition, ça n’était que la faute aux circonstances ; que ce que j’étais, je ne l’étais pas absolument, irrémédiablement ; que ça n’était pas à tout jamais que j’étais installé dans le pire. Je ne demandais qu’à croire ce qui était écrit, j’étais incapable alors de penser que tout le langage ment. Je mettais bien devant mes yeux les plaisirs et les états décrits. Lire, à cet âge-là, était encore chose simple.
Ces mauvais livres me mirent donc dans la peau des étonnements qui ne me quittaient plus, que je gardais bien cachés sous l’uniforme du collège et les routines scolaires et familiales, et qui longtemps demeurèrent inchangées et juvéniles. La vie dont ils parlaient était une chose féroce, j’en aimais la sauvagerie, la promesse d’ivresses hors la loi et de vengeances assumées. Tout ça me faisait une vie intérieure, me donnait des idées, faisait qu’il était moins tuant d’être qui j’étais. J’y trouvais les poses et les paroles rebattues qui font ce qu’on appelle un caractère, toutes les bricoles qu’il faut pour ne pas être décavé en deux coups par le premier Judas venu. Ils m’apprenaient encore que Caïn n’était pas un conte de bonne femme ; que les paroles et les dents étaient bel et bien faites pour mordre ; que la valeur de l’argent est la plus visible. Mais, bon, ces leçons apprises, et vite apprises, j’eus besoin d’autre chose. Et c’est à l’été suivant que j’ai trouvé.
J’avais donc passé l’hiver, puis le printemps, à lire les romans de Robbins. Rien n’existait pendant ces mois pour faire pièce à ce que je découvrais, et tout d’abord, plus que le sexe en soi, qui m’avait jusqu’alors été une chose à la fois rêvée et abstraite, le désir des femmes. C’était donc possible, c’était donc vrai, elles aussi étaient faites de chair, et cette chair vivait, exultait. On me disait que la partie était jouable. Je la jouerais donc dès cet été qui arrivait et que j’allais passer au bord de Silver Lake, près de Woodstock, où mes parents avaient un chalet. Nous y passions tous les mois de juillet et août et j’y retrouvais tous les ans le même groupe d’amis. Sauf qu’allait s’ajouter cet été-là une jeune femme qui changerait ma vie, Leigh Mackenzie Smith.
Je l’avais rencontrée – enfin, rencontrée, il serait plus juste de dire qu’elle m’était tombée dessus – au cours d’une soirée où la bière coulait bien, les alcools raides aussi. Elle était l’Incarnation ; elle était évidente ; elle était ardente ; elle me regardait en face ; elle avait la farouche bravoure de la vie.
Plus qu’ému en la voyant venir vers moi, souriante et offerte sans ostentation, à la fois discrète et flagrante, sans minauderie ni vulgarité, avec des manières franches et directes, soudain je n’étais plus dans le texte qu’intérieurement je m’étais mis à répéter en l’apercevant en début de soirée, dansant avec Brian Gibson, un type détestable, arrogant et con. En la voyant venir vers moi, donc, j’avais aussitôt décroché. Je veux dire que je m’étais tout de suite mis à lui parler, sauf que je m’entendais, c’était comme sans moi, ça roulait tout seul comme un moulin à prières. Heureusement que je voyais à son regard, à son sourire, qu’elle y croyait, ou voulait y croire, ou faisait semblant d’y croire, ce qui revenait au même, sinon je n’aurais plus su quoi lui dire. J’avais vaincu ma timidité, j’avais vaincu ma terreur, j’étais libre. Je lui avais proposé qu’on s’éloigne du groupe, du bruit, des regards. Elle avait accepté, m’avait suivi. Nous avions traversé le jardin planté de hauts sapins noirs, sans dire un mot. J’avais le cœur qui battait à tout rompre, j’avais peur de trembler, mais je tenais bon. Nous avions rejoint le long escalier de bois qui descendait au lac.
– Shall we go down?
– All right.
Au bas de l’escalier, un large quai fait du même bois menait à l’abri pour bateaux, dont le toit était aménagé en terrasse.
– Shall we go up?
– Yeah, ok.
Nous étions donc montés. Je vous laisse imaginer à quel point j’étais nerveux. Je pensais à Danny Fischer, à la première fois qu’il avait défait le soutien-gorge de Nellie. Je pensais, c’est irréversible, je suis là avec elle, j’ai ce que je voulais, il faut maintenant assurer. Mais je n’avais jamais défait de soutien-gorge. Je me disais, t’as l’air de quoi, maintenant, tu fais comment ? J’aurais voulu prendre des épaules, changer de voix, me réinventer, et voilà que je me mettais à n’être qu’un adolescent avec des fossettes. Shall we go down, shall we go up? quelle conversation… Je savais qu’elle attendait que je fasse le premier pas mais j’espérais qu’elle le fît, elle, comme ça j’aurais été tout à fait sûr qu’elle voulait ce que je voulais, que je ne prenais pas mes seuls désirs pour des réalités. Évidemment, nous avions un peu bu, comme tout le monde, mais pas au point de ne pas nous rendre compte de ce qui se passait, et qui était pour moi une espèce de transgression monumentale. J’étais là avec cette fille que tous les garçons regardaient comme le loup de Tex Avery regardait la pin-up Red Hot Riding Hood – j’ai oublié de dire qu’elle était grande, brune, et très belle, qu’elle était le sosie de Raquel Welch, mais je suppose que vous aviez compris –, stupéfaits, n’en croyant pas leurs yeux de merlan frit, salivant, interdits devant autant de sensualité. Bref, il fallait maintenant que j’assure et j’avais l’impression d’aller à l’abattoir. Mais voilà qu’elle me dit : look, en détachant la fine gourmette en or qu’elle portait au poignet gauche. Trois lettres y étaient gravées : LMS. Elle me demande : do you know what this means? Je lui réponds, your initials : Leigh Mackenzie Smith. Elle me dit, no, it means Lay Me Sweet. Oh, God!Baise-moi doucement, qu’elle me disait ! Mais comment allais-je faire ? Il n’y avait que des transats, des fauteuils en osier et des petites tables sur cette putain de terrasse. Alors j’ai fait ce que j’ai pu, et apparemment pas trop mal, puisque nous avons passé presque tout le reste de l’été à nous revoir tous les jours et à remettre ça, et même pas toujours doucement.
Comme vous pouvez l’imaginer, j’étais bien décidé à continuer, à connaître tous les jours la même splendeur, les mêmes merveilles ; je tenais ma vie, j’avais du soleil sur la tête et dans l’âme. Mais non, elle en décida autrement. Avec le même rire qu’elle m’avait offert en juillet, elle s’en alla fin août avec le bellâtre niais, Brian Gibson, qui la faisait danser la première fois que je l’ai vue. Le prince qu’elle avait fait naître ce soir-là n’était plus qu’un enfant perdu.
***
C’était il y a des lustres et je ne m’en suis jamais remis. J’ai laissé la vie passer. Depuis longtemps déjà, tous les jours mon âge me saute à la gueule. Il me sautait d’ailleurs à la gueule même quand il n’y avait pas de raison, donc bien avant que j’eusse commencé à prendre de l’âge, comme on dit. Ma jeunesse est morte avant même que je ne l’eusse vécue. Pourtant, on dit de moi que j’ai bouffé la vie, projet après projet, et ce n’est pas faux. Mais ça n’a servi à rien, tous mes projets ont fini par prendre l’eau. Ce qui s’est passé ce jour-là s’est révélé irréversible. Aujourd’hui je suis vieux, je n’ai pas su être heureux, je me suis défait au fil d’aventures semblables à la première, si bien que j’ai fini par me résoudre à vivre avec l’idée de n’avoir personne. Et comme dit l’autre, n’avoir personne, c’est n’avoir même pas soi-même. Toute ma vie, je n’eus qu’un seul désir : me livrer pieds et poings liés à une femme qui m’aurait aimé dans ma chair, qui m’aurait aimé absolument.
J’avais d’ailleurs bien cru en avoir trouvé une, huit ans, dix ans plus tard. Mais je me suis trompé. J’avais fait le dos rond pendant ces années, j’avais docilement regagné mes pénates, repris ma vie d’avant, solitaire, mélancolique, ennuyeuse de bon fils bien correct. Je m’effaçais, je souhaitais par-dessus tout disparaître et pourtant je restais là, gourd, renfrogné, à regarder sombrement ceux qui en plein soleil roulaient voiture, avaient fière allure, portaient beau, avaient les filles les plus riantes, les plus délurées, les plus miraculeuses. Certain que le bagne pour moi allait durer, le chemin qui me restait à faire me pesait de plus en plus, mes cieux n’avaient que des nuages et autant que le chemin ils pesaient. Me restait l’esbroufe, avais-je un moment pensé. Comme s’il pouvait y avoir ça. Qu’aurais-je pu faire avec ça ? Me donner des airs de prince quand je me sentais gueux, jouer les hardis quand je n’étais que déférent ? Bien sûr que non. Avec tant d’envie et si peu de dons et autant de peur, il faut faire autrement. Huit ans, dix ans donc que je me posais là, désespéré et me forçant à sourire, à attendre mon heure sans croire qu’elle viendrait, je n’en pouvais plus de me ressouvenir de ma joie en allée. Alors je résolus d’être remboursé, de prendre ma revanche, d’embobeliner des catins, de me faire une réputation.
C’était septembre, c’était avant que l’âge ne m’eût gagné, je me disais qu’il n’y avait pas de raison que je ne réussisse ma vie, moi aussi, que j’avais bien le droit de considérer fièrement qui je pouvais être dans le temps qui venait. Leigh Mackenzie Smith m’avait donné du goût pour les femmes, m’avait appris qu’elles peuvent être excessives, qu’elles peuvent crier quand le plaisir fait enfler les lèvres de leur sexe, que parfois même elles giclent plus et mieux qu’un homme, qu’elles peuvent jouir tellement que tout leur sang bondit dans leur cœur, qu’elles peuvent aimer d’une manière inconcevable à nos entendements craintifs. Je remettrais donc ma vie en train, je lancerais des lessives, viderais des bagages, ferais des achats, règlerais des factures, expédierais toutes les affaires courantes. Je m’armerais de patience, le sortilège qui m’avait paralysé serait levé, très vite, comme il s’était abattu, voilà. Je n’agirais désormais que pour mon propre compte et je cesserais de me plaindre d’avoir été dépossédé de part en part du temps qui eût dû être le mien. Il n’y aurait plus que des jours limpides, pleins de bleu, infusés de soleil. Le temps serait suspendu, la vie s’exalterait. Et j’excellerais dans le crapuleux métier de séducteur.
Mais.
C’était sans compter avec la morne permanence des choses. On ne s’arrache pas impunément à l’étroit périmètre où l’on avait très tôt et sans trop savoir ni pourquoi, ni comment trouvé refuge. On ne se défait pas comme ça, brusquement, comme par magie, du sentiment de solitude, d’être déconnecté, d’être intouchable, d’être pris au piège par la société, par sa classe sociale, sa famille, son corps et ses désirs, voire par la possibilité apparente de faire comme on veut, ce qu’on appelle la liberté. Faulkner a très bien décrit ça dans Sanctuary, ce roman qui raconte l’enlèvement et le viol d’une jeune fille de bonne famille, du nom étrange de Temple Drake. Cette jeune fille est incapable de ne pas faire encore et toujours le mauvais choix, elle est même incapable de saisir l’occasion qui se présente à elle de fuir ceux qui l’ont enlevée et violée, et elle ne comprend rien à ce qui la pousse à agir comme elle le fait. Eh bien, voyez-vous, j’étais un peu comme elle, menant depuis le début de l’adolescence une vie hâtée, anxieuse, brisante. Rien ne m’était acquis, tout était en question, toujours. Je me souviens de ces années pendant lesquelles je tournais sans but dans la maison de mes parents, l’œil sombre, la mine renfrognée. Et j’ai à peine changé : c’est toujours sans but, même si c’est avec l’œil moins sombre et la mine moins renfrognée, que je me suis plus tard mis à aller, à tourner de femme en femme, m’efforçant chaque jour de ramasser le puzzle infini de ce qui me servait de vie. J’ai récolté de cette errance une fatigue prématurée. Las, j’ai fini par me poser, avec une femme que j’ai cru pouvoir aimer mais que je n’aime pas, excessive et déterminée comme une reine, qui sait où elle va et où je n’irai pas. Je hais son âme mais j’aime son corps, sa bouche vorace, sa belle humeur constante, son sexe toujours mouillé. Elle a à peine l’usage de la parole, elle m’a toujours été étrangère, comme moi pour elle.
Cette étrangeté fut notre liberté, belle et indubitable. Et terrible. Elle permit que nous trouvions le plein usage de nos corps, souvent ivre, parfois rude, toujours évident, jamais mensonger. Mais désespéré aussi. Nous savions vide le chemin sur lequel nous nous étions mis mais il était impensable que nous le quittions. Car c’était trop tard, il n’y avait plus de retour, impossible de dételer. La vie nous aura été une lèpre. C’est bientôt la fin du jour et quand cette fin viendra nous n’aurons toujours rien compris, le ciel ne nous aura jamais été qu’un vieil endroit bleu sous lequel nous n’aurons trouvé qu’un désert. Ce qui fut là, dans nos vies, ne fut jamais à nous.
Je suppose que nous devrions avoir honte, qu’il n’y a pas lieu d’invoquer de quelconques circonstances atténuantes. Que c’est simplement que nous n’étions pas de leur monde, les autres, tous ces autres qui travaillent et aiment en conscience, qui savent leurs règles et ont de l’élégance dans les manières, les usages, qui tiennent leurs affaires en ordre, bref qui ont ce qu’on appelle, très justement, du savoir vivre.