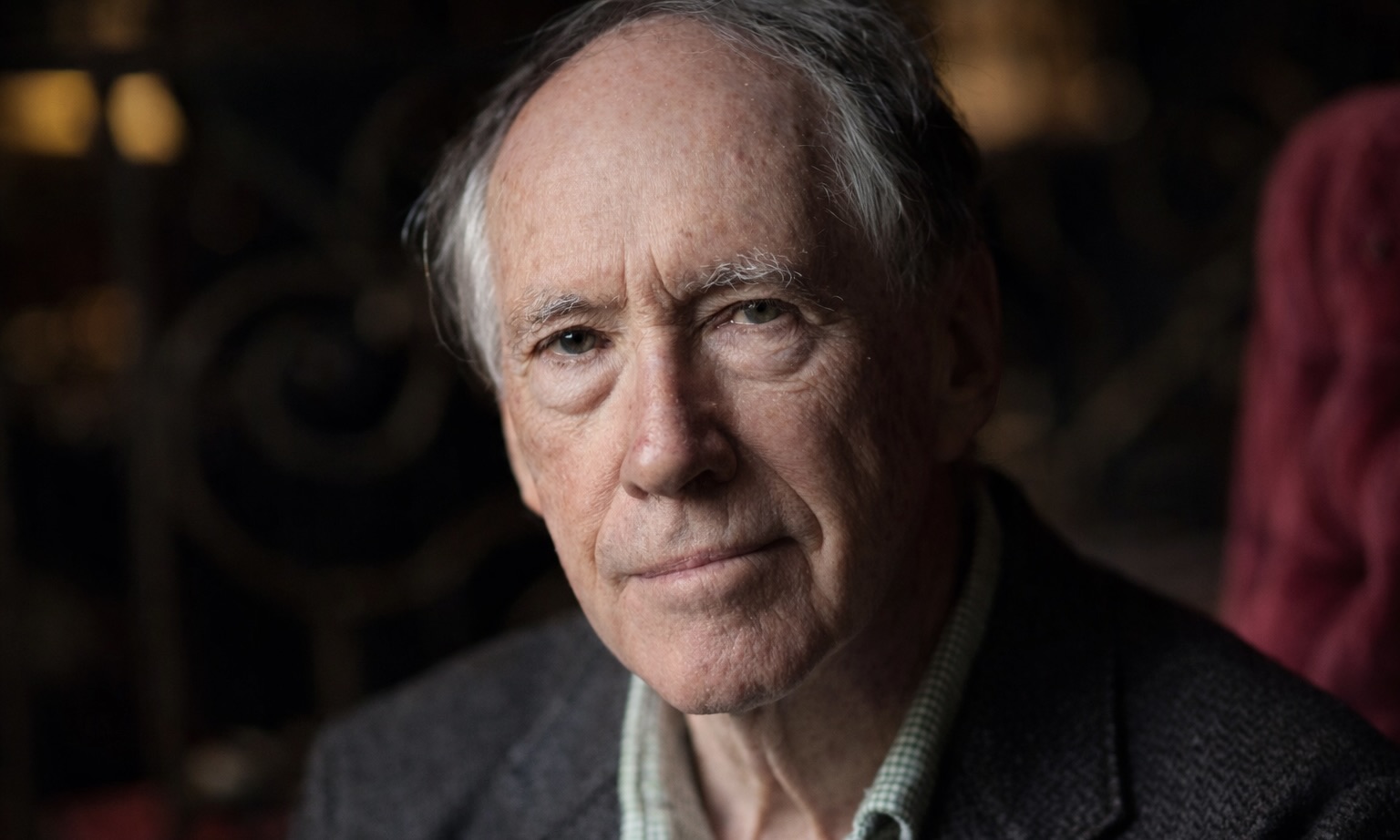Comment raconter, sous forme de roman vrai, la vie d’un personnage historique dont une pièce de théâtre au succès planétaire, il y a plus d’un siècle, aurait, une fois pour toutes, figé les traits et chanté les hauts faits ? C’est ce pari un peu fou de libérer Cyrano de Bergerac de l’étreinte d’Edmond Rostand que tente aujourd’hui Gérard de Cortanze. Disons d’emblée qu’il s’y emploie magistralement, à une réserve près.
Mais n’anticipons pas et découvrons notre héros, délivré autant qu’il est possible de sa prison théâtrale, tel que son romancier nous le fait vivre et aimer, plume au vent, nous entraînant dans le Paris des bas-fonds, du Marais, du Pont-Neuf et de la Foire Saint-Germain, à l’avènement du jeune Louis XIV en pleins troubles de la Fronde.
Chez Cortanze, plus de pâtissier Ragueneau, plus de frivole Roxane, de Christian piteux énamouré, de Le Bret, plus de De Guise. Encore moins ce héros de cape et d’épée brûlant à vie d’un amour secret pour une mondaine retirée du monde. A l’inverse, un Cyrano revisité : disciple de Lucien, de Campanella, de Gassendi, pèlerin des autres mondes, esprit sublunaire né avec un quartier de lune dans la tête, libertin affiché, nostalgique de l’amour, athée – parlant haut et fort, au risque de finir décapité en place de Grève, de « ces dieux que l’homme a faits et qui n’ont point fait l’homme » –, sceptique absolu en politique, révolté de la foi, de la société, sac à chimères sans fond, homme de cour détestant ses puissants protecteurs à qui il prêtait sa plume et ses piques rebelles, et non moins méprisant les salons et les ruelles des Précieuses où pourtant il se produisait avec succès. Ou encore libelliste, changeant de parti au cœur de la Fronde sans changer sa satire, joyeux luron mal-élevé, grand consommateur de dames à rubans comme de pauvres ribaudes, pilier de taverne, bagarreur, bretteur invétéré atteint du démon de la bravoure, éternel enfant perdu, qu’une amie dévote – seule femme qu’il ait jamais aimée –, n’aura cessé d’essayer de sauver de lui-même, non sans brûler, dans un feu expiatoire, tous ses papiers blasphématoires et lettres impies. Ce météore qui fascina ses contemporains et exaspéra les autres, mourrut jeune de la syphilis, en 1655. Le Grand Siècle pouvait commencer. Sans lui.
Il sombra dans l’oubli, jusqu’à ce que Rostand l’exhume du néant et lui dresse une statue quelque peu patriotarde, réputée indétrônable. Reste que, pour mieux – je suppose – contourner ce totem encombrant, ce mammouth tissé d’inventions, Gérard de Cortanze a choisi, d’un bout à l’autre de sa fresque (sauf en couverture), de ne jamais appeler son héros Cyrano, mais par son prénom, Savinien – aussi inusité et obscur que le nom de Cyrano est illustre, intangible. Nous avons donc affaire continûment à un certain Savinien, parfait inconnu, qui prend la place de Cyrano. À charge pour le lecteur de se reprendre, à chaque fois que ce prénom d’état civil revient au fil des pages, et de se dire : « Savinien ? Ah oui, Cyrano. » Ce constant exercice brouille la lecture, par ailleurs passionnante, du livre de Gérard de Cortanze.
Pourquoi cette forclusion du mot si sonore et magnifique de Cyrano – nom et prénom fondus ensemble pour ne faire qu’un dans la représentation courante –, au profit d’un prénom passe-partout, sans sel ni saveur, quand le nom bien-aimé, lui, brille par sa totale absence ? Pourquoi, grands Dieux, avoir débaptisé Cyrano ? Même Victor Hugo, dont le pseudonyme était – excusez du peu – Olympio, n’a pas troqué son nom d’homme-océan pour mieux habiter l’Olympe.
Serait-ce péché, si j’ose suggérer une version de l’ouvrage où le nom de Cyrano lui serait restitué de plein titre ?
Sartre, qui écrivit L’idiot de la famille, un livre consacré à Flaubert, disait d’expérience : « On entre dans un mort comme dans un moulin ».