L’intranquillité
Dans Le Petit Prince : un homme affairé passe son temps à compter les étoiles, sans s’arrêter jamais pour en admirer une… Allégorie, qui réveille et qui révèle : au commencement était le verbe, aujourd’hui il y a le chiffre !
Le déluge d’enthousiasme des médias pour les données (pardon, les datas), les algorithmes et l’intelligence artificielle m’installe dans la méfiance. La technologie, numérique ou pas, n’a jamais été ni bonne ni mauvaise en soi : seul l’usage qu’en font les hommes mérite vigilance. Mais si l’on essayait parallèlement un regard critique sur la société que nous préparent les « technophiles » ?
Je n’évoque pas ici l’évidente addiction numérique qui nous caractérise tous aujourd’hui. Encore y aurait-il beaucoup à dire sur la perte de présence aux autres, conséquence de la manipulation compulsive de nos écrans. Cette frénésie de connexions est aujourd’hui une maladie bien analysée à défaut d’être bien traitée. Il y a plus grave. En isolant l’individu de son environnement immédiat sous prétexte de le relier au reste du monde, la numérisation de notre société confirme le pressentiment de Freud lorsqu’il évoquait « le Malaise dans la civilisation ». Sur la toile, l’intérêt général n’existe pas. La désintermédiation forcenée induite par la fièvre numérique détruit les solidarités anciennes tout en construisant de nouvelles bulles « cognitives » dont l’individu devient vite l’otage. Combien d’amis sur Facebook sont-ils de vrais amis ?
Nous traversons une de ces époques où les changements surgissent en avalanche avec un feu d’artifice d’avancées technologiques majeures. Il serait illusoire de penser qu’une telle accélération est sans effet sur la conscience individuelle et collective. Elle donne à une minorité un sentiment de surpuissance mais à la grande majorité le vertige. L’avenir est en effet voleur d’identité. Il est devenu, redevenu, source d’hubris pour quelques-uns et d’intranquillité pour le plus grand nombre.
Il y avait autrefois la paroisse, le village, la famille, l’école, l’église, le syndicat, le parti, le café même, comme lieux d’échanges où se forgeaient les solidarités. Ces lieux sont en voie d’implosion. Et à l’heure où l’on se gargarise de technologies et de réseaux dits sociaux nous sommes tous, maintenant, plus ou moins plongés dans ce que j’appellerai une « solitude grégaire » qui explique pour beaucoup la débandade intellectuelle de nos sociétés libérales.
Le grand remplacement
Ces considérations ne justifient en rien les pyromanes qui se disent insoumis. Elles montrent juste que le problème remonte loin et que, sauf volonté politique très forte, le moteur continuera à produire ses explosions. Sans remonter aux canuts lyonnais, la mécanisation a souvent suscité craintes et révoltes. Il n’est pas nécessaire d’avoir fait une thèse sur Schumpeter pour comprendre que le progrès, après avoir détruit des emplois, en crée de nouveaux dans la foulée. Et pourtant, le débat resurgit aujourd’hui avec une acuité plus brûlante que jamais. Pourquoi ?
Parce que les nouvelles technologies (numériques aujourd’hui, cognitives demain, génétiques après-demain…) accélèrent l’histoire avec une brutalité inouïe. Il a fallu cinq cents ans pour passer de Gutenberg à l’imprimante informatique, dix années à peine pour rendre possible l’imprimante 3D et deux mois pour que Chat GPT attire 100 millions d’utilisateurs. Alors arrêtons de nous mentir : à l’heure des robots interconnectés, la réduction du travail humain dans le processus de production est un mouvement irréversible. Nous avons le nez dessus. Ce qui arrive avec l’intelligence artificielle ressemble à un tsunami en termes d’emploi : il faut être bien aveugle pour imaginer qu’on pourra faire face à ce « grand remplacement » avec les rustines de la politique sociale habituelle. Chacun comprend qu’il était hier possible de convertir un mineur en ouvrier d’usine. De nos jours, tout le monde saisit qu’il aura encore plus de mal à occuper un poste demandant une compétence numérique. Les emplois de demain ne bénéficieront pas aux chômeurs d’aujourd’hui. Et peut-être même pas à leurs enfants. Pour eux le diable s’habille en datas.
On nous dit : l’imprimerie a fait disparaître quelques centaines d’emplois de copistes mais a généré des milliers d’emplois par ailleurs. Certes, mais a-t-on vu un copiste devenir libraire, ou même ouvrier imprimeur ? Et quand les fiacres ont disparu, certains cochers ont réussi à devenir chauffeurs de taxi, mais pas leurs chevaux ! Le bon peuple est crédule mais jusqu’à un certain point. Il arrive un jour où le mensonge lui saute aux yeux. Il ne faut pas être surpris s’il explose alors, de façon débraillée et sonore sur les Champs Élysées ou aux portes du Capitole. La violence est inadmissible en démocratie. Mais le cri de la rue, du « gilet jaune » ou du « bonnet rouge », sonne parfois comme un appel au secours. Il faut relire Saint Paul et son « trésor de colères accumulées »…
Une désintégration sociale
Le libéralisme poussé à l’excès aura gravement échoué si ses tenants continuent à nous raconter des histoires. Le modèle de la grande entreprise dont la mission était d’assurer une certaine sécurité à un grand nombre d’employés est mort. Dans le nouvel âge entrepreneurial, où la notion d’écosystème horizontal remplace l’ordre vertical, le lien entre individu et entreprise se distend à toute vitesse. La multiactivité se répand, et le changement régulier d’emploi devient la norme. L’entreprise a perdu sa fonction d’intégration sociale. Hier, le cadre supérieur et l’agent d’entreprise appartenaient à la même entité, qui pouvait assurer leur rencontre. Aujourd’hui, avec l’externalisation des taches, c’est fini. À chacun sa tranchée : les officiers d’un côté, les troupes de l’autre.
Depuis les années 1990, on assiste à une réduction sensible de la durée d’emploi au sein d’une même entreprise et à une généralisation des contrats très courts. Plus précisément, les contrats temporaires représentent une part de plus en plus grande de l’emploi total dans les pays de l’OCDE[1]. Ce phénomène touche fortement les jeunes générations : un quart des travailleurs de l’OCDE de moins de 24 ans possède un contrat temporaire. Ce taux atteint plus de 50% en Espagne, au Portugal et en France, alors qu’il était de 13% dans notre pays au début des années 1980. Toujours en France, la part des CDD a nettement progressé en vingt-cinq ans pour atteindre près de 90% des embauches et 30% des CDD ne durent qu’une seule journée ! De fait, aucune situation n’est plus assurée comme hier. Les enseignants eux-mêmes, qui travaillent la matière humaine, ne sont pas mis à l’abri de cette précarité alors que l’éducation exigerait une patience infinie.
L’entreprise elle-même vit dans un monde désarticulé. Hier, il fallait des années pour s’installer sur son marché, pour disposer d’équipements et de la main-d’œuvre appropriés, pour faire connaître sa marque. Aujourd’hui, un concurrent peut surgir de toute part, parfois de très loin, à tout instant. Si votre santé financière est encore un peu fragile, vous serez racheté par un fonds d’investissement dopé par la dette qui exigera des rendements très élevés. Si vous êtes prudent vous serez attaqué par un fonds activiste qui critiquera votre lenteur. Si vous faites tout pour satisfaire le marché, vous serez confronté à des géants qui s’appuient sur une nouvelle vague technologique : Facebook est né il y a vingt ans, et Amazon il y a moins de quarante ans. Personne, hier, ne connaissait Tesla ou SpaceX. Quant à Chat GPT… Dans ce grand manège, inutile de parler de culture d’entreprise ! Le capitalisme d’aujourd’hui n’est ni latin ni rhénan : il est frénétique.
L’angoisse des classes moyennes
Hier, la puissance d’une nation se mesurait au nombre de ses soldats, aujourd’hui, au nombre de start-up, nous dit-on. Tous les paradigmes du capitalisme classique sont défiés. Le travail ? Il sera de plus en plus rare dans sa forme actuelle, le salariat. Déjà les nouvelles plateformes qui mettent en relation producteurs et consommateurs finaux font appel à des millions d’indépendants multi actifs qui échappent aux règles anciennes. La propriété, elle, va se diluer dans une économie de partage où l’échange, la location, la mutualisation, l’usage l’emporteront sur la possession. Là encore, le numérique change les mentalités : le producteur prête son produit sans le vendre, tandis que la consommation en paie l’usage sans le posséder. Et comme ils peuvent être des millions à communiquer directement… Les intermédiaires classiques sont violemment concurrencés : de la banque à l’hôtellerie, du transport à l’énergie, ce sont des business models très établis qui sont à revoir de fond en comble. Enfin, la production elle-même se décentralisera à l’infini par l’impression en 3D et l’IA.
D’où l’angoisse grandissante des classes moyennes. Ce n’est pas un hasard si nos voisins allemands comptent 10% de travailleurs pauvres. D’ailleurs, peu importe que cette attrition représente 10, 20 ou 30% des emplois actuels : comme pour la météo, le « ressenti » est plus important que le fait lui-même. Le chômeur aura du mal à admettre que le cours de Bourse de son entreprise flambe parce qu’elle a annoncé un plan de licenciement. Ainsi s’expliquent les troubles du comportement, individuels et collectifs, qui jaillissent de partout sous la forme du populisme. Le changement, quand il n’est pas préparé, est voleur d’identité.
Vae Victis ?
Alors revenu universel ou pas ? Au-delà des slogans de campagne et des mécaniques de mise en œuvre, une chose est claire : au moment où la flexibilité est de toute façon imposée, la compléter par un peu de sécurité serait un progrès et non une régression. Si les générations sacrifiées ne sont pas sécurisées d’une manière ou d’une autre par un nouveau pilier de la Sécurité sociale, attaché aux personnes et non plus aux statuts, elles se retrouveront dans la rue et bloqueront tout. Il faut être bien septique sur la nature humaine pour penser que ce filet de sécurité encouragera la paresse !
Mais en attendant une telle réforme que faire ? Crier vae victis et laisser les vaincus crever au bord de la route ? Construire une déchetterie à côté de l’usine ? Ou conserver aux plus démunis un minimum de dignité et d’espoir ? Il est peu de pistes comme celle du revenu universel capables de conjuguer impact économique (relancer la consommation), incidence sociale (atténuer le sort des 9 millions de Français sous le seuil de pauvreté) et préparation de l’avenir (par la formation). Quitte à revisiter à cette occasion le fatras d’aides sociales existantes.
Ajoutons à cela une dimension plus politique. Si l’on veut redonner un sens à la démocratie, il faut que le citoyen ait du temps à consacrer à la vie civique. Comment le faire quand on est écrasé par un travail harassant et des fins de mois problématiques ? Il n’y aura pas de « démocratie participative » si l’homme n’est qu’un travailleur – consommateur… Redonner un peu de temps « libre » au citoyen, c’est lui permettre de participer à la vie de la cité. Ceux qui n’en sont pas convaincus devraient lire la Lettre à nos petits-enfants, publiée par John Maynard Keynes en 1930. Prophétique.
[1] L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) est une organisation intergouvernementale d’études économiques. L’OCDE compte 38 pays membres et regroupe plusieurs centaines d’experts. Il offre une d’expertise en matière de données, analyses et bonnes pratiques dans le domaine des politiques publiques.






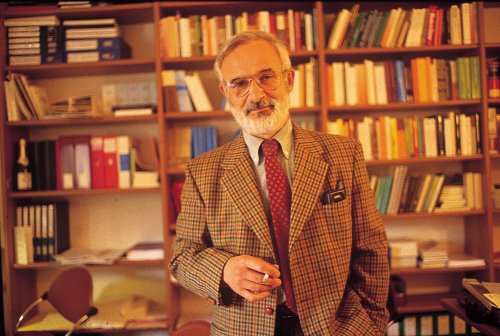

La progression spectaculaire de « Yahya » dans la liste des prénoms les plus attribués en Angleterre et au pays de Galles en 2024, conforte nos inquiétudes quant à une renazification de l’Europe d’autant plus difficile à contrer pour d’authentiques humanistes et universalistes qu’elle opère par un mouvement de reptation sociétale prenant appui sur le marché du droit social et de la liberté individuelle.
La crainte de représailles éventuellement inévitables paralyse l’Occident dans tous ses États et ses corps destitués.
Les masses se hamassisent, orientant ainsi de façon suicidaire un clientélisme politique ayant les yeux braqués sur des néoboomers religieusement hostiles à la contraception : élevage en batterie voué à l’esclavage moderne ; pari sur l’avenir extra-muros.
Les Juifs de l’Arrépublique ne maintiendront pas la Méduse à flots en se portant garants pour son collège de capitaines déboussolés, ne pouvant se raccrocher qu’au statut stationnaire de restaurateurs syncrétistes, semi-légitimistes, à la lettre bons à rien.
Et c’est pourquoi personne, à commencer par Celui qui nous a fait à Son image, ne saurait ni ne devrait même éprouver le désir de disposer du pouvoir de priver quiconque de la possibilité d’être d’accord avec le chef de l’exécutif israélien, quand celui-ci accuse son homologue français d’alimenter le feu de l’antisémitisme.
Israël n’a pas peur.
Si le 7-Octobre a été conçu comme la matrice d’un génocide à fragmentation, son évidence y est conscientisée, la preuve des faits qui le caractérisent y fut démontrée, les méfaits qu’il charrie y seront anticipés, leurs planificateurs localisés et leurs perpétrateurs neutralisés.
N’ayons pas peur d’Israël.
Sachons être à ses côtés.
Pour ce faire, comprenons que nous le sommes.
La sœur du martyr profané ne dépasse pas les bornes ; au contraire, elle vise juste. Et c’est précisément ce qui autorise les petits soldats de nos années plombées à contester, chiffres à l’appui, les taxations de laxisme émanant d’un gibet de caricatures de la nouvelle entre-deux-guerres, honnies avec délectation par une partie de l’Occident… pas la meilleure.
La stratégie du en-même-temps est une fabrique de rouerie. Les macronistes manient non sans malice l’art de la duplicité. Certains, plus ravis que les autres, s’y adonnent avec noble candeur ; cela doit réjouir leur maître à dépenser. Car on ne peut pas dire que le président des Français n’ait rien fait pour lutter contre l’antisémitisme depuis son OPA sur la démocratie à l’agonie. Or l’antisémitisme, cette maladie mortelle qui guette les peuples à cran, ne fait qu’aller croissant au pays de Pétain et de Philippe-Auguste, et Macron n’y est pas pour peu.
Dès lors, comment résoudre le paradoxe du philosémitisme judéophobe ? En s’efforçant peut-être de ne pas insinuer qu’Anne-Laure Abitbol a dérapé quand elle accusa l’Élysée d’alimenter l’antisémitisme et de ne rien faire d’efficace pour empêcher qu’il ne progresse, alors même qu’une grande partie du problème de l’antisémitisme et de l’antisionisme se dénouerait si le credo de l’extrême centre s’éclairait sur ses propres dérives et renonçait à prendre, dans son sillage biaiseur, les routes barrées de la mauvaise foi.
Une politique se réduit à néant lorsqu’elle s’applique à défaire tout ce qu’elle fait. Celui qui, fort d’avoir ménagé ses relations avec la nébuleuse rampante des Frères musulmans et les États sponsors du terrorisme à mode opératoire variable, peut arguer qu’il s’échine à lutter contre la haine des Juifs, ce genre de stratège court-termiste ne mérite pas qu’on l’érige au rang de prince machiavélien.
On peut concevoir qu’un énorme mensonge, fût-il émis par omission, vaille mieux qu’une bribe de vérité dont la luminosité trop intense aveuglerait une population inculte ou, si vous préférez, déculturée, ce qui équivaudrait à une masse de crétins puérils, tyrannique par le bas, sauvage en puissance. Va donc pour le mensonge d’État, à cette seule condition qu’il protège la nation contre sa pulsion de mort jusqu’à la compulsion à l’autodestruction. Hélas, lorsqu’une politique se soumet aux intimidations du pire fascisme qu’ait engendré l’humanisme depuis que le paradigme de l’internationalisme s’est voué dès le principe à l’autodévoiement, on la retrouve dans le ravin, un lendemain de Grand Soir, et dans un piètre État.