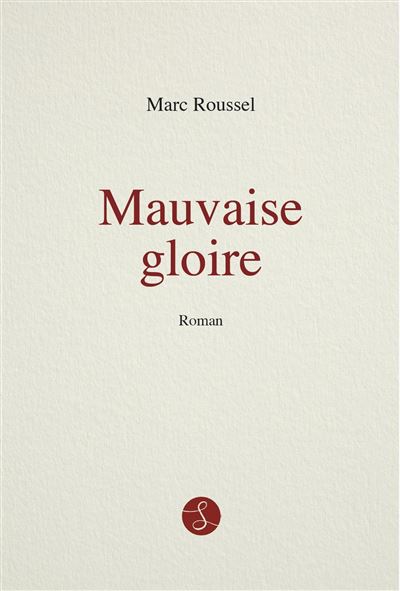Marc Roussel est un ami.
Ancien de Gamma, il est l’un des grands du photoreportage contemporain.
Je l’ai rencontré à Kaboul, il y a vingt-cinq ans, le jour d’un tremblement de terre où son imperturbable sang-froid m’avait impressionné.
Puis, en Libye, où nous avons, avec mon plus vieil ami, autre baroudeur de grand style, Gilles Hertzog, erré dans les décombres de l’empire du mensonge et du crime qu’avait édifié Kadhafi.
Nous avons fait équipe en Irak, en Syrie, au Bangladesh, en Somalie ; en Afghanistan encore, à la veille du retour des talibans ; nous avons rapporté l’impardonnable misère des camps de migrants de Lesbos, où, enfermant les hommes sous prétexte de Covid, on les laissait mourir de tout le reste.
Nous avons, notamment sur la guerre en Ukraine, réalisé des films documentaires produits, pour deux d’entre eux, par un autre de nos compagnons, François Margolin, qui fut l’un des producteurs de Claude Lanzmann.
Bref, voilà un homme qui regarde les choses comme je les regarde ; qui m’a photographié, filmé, observé comme aucun autre, et dont je connais l’œil, en retour, comme si c’était le mien ; et, attendu qu’il y a peu de choses, en ce monde, qui créent une si grande proximité entre les êtres que cette commune prise sur le réel, j’avais l’impression de tout savoir de ses réflexes, de ses manières d’être et d’agir.
Jusqu’à ce premier roman, Mauvaise Gloire, auquel je ne m’attendais pas et dont je sous-estimais, et l’immense qualité, et la façon qu’il aurait, tel un Aragon dont le Matisse s’appellerait Robert Capa, d’y abattre son jeu.
Est-ce l’exemple de ces artistes qu’il admire mais qui ont cru, leur vie durant, s’être trompés d’art ?
Godard qui se pensait poète ?
Paul Bowles persuadé jusqu’au bout, malgré Un thé au Sahara, qu’il était, en réalité, musicien ?
Ou l’Aragon de La Semaine sainte n’ayant, comme le photographe du Peintre de batailles de Pérez-Reverte, jamais douté qu’il aurait dû être un autre Paolo Uccello.
Marc Roussel s’est trompé une première fois quand, sous la pression d’une famille ouvrière et aimante, il a choisi de devenir ingénieur centralien avant de s’aviser qu’il s’ennuyait et d’acheter son premier Leica.
Puis quand, en Libye, devenu un nom du photojournalisme à l’ancienne, habité par l’exemple des grands anciens, Cartier-Bresson, Gilles Caron, il a longtemps hésité devant l’infime mais décisif mouvement du doigt qui suffit à mettre un Canon 5D en mode film et à devenir documentariste de cinéma.
Eh bien, de la même manière, il lui aura fallu un temps fou pour passer à l’acte littéraire avec ce livre qu’il porte en lui depuis des décennies et qui tient à la fois du roman d’apprentissage, des confessions tardives et des notes pour servir à la mémoire de ce temps.
Le moment était venu car le roman, paru chez Sama Éditions, la maison débutante de Rachel Deghati, et habilement construit autour de trois générations de Roussel ayant chacun vécu leur guerre (la guerre d’Espagne pour le grand-père, la guerre d’Algérie pour le père, la guerre de Syrie pour Manuel, le narrateur, alias de l’auteur) est une éclatante réussite.
Qu’est-ce qu’une guerre juste ?
Qu’est-ce, à l’inverse, qu’une guerre sale où l’âme se corrompt et se brise le cœur ?
Qu’y a-t-il d’inavouable dans la première ? d’inévitable dans la seconde ? comment, parti pour sauver le monde, devient-on une machine à tuer ? et comment, à l’inverse, une guerre peut-elle glisser sur la vie d’un homme, devenir un souvenir parmi les autres ? et qui jugera un héroïque combattant des Brigades internationales qui, à Cadaqués, au moment de la Retirada, tue d’une balle entre les deux yeux son sergent qui a perdu la tête ?
Comment fonctionnent les guerres humanitaires modernes ?
Quel type de héros fut Jean Bernès, alias Jacques Bérès, cofondateur légendaire de Médecins sans frontières, puis de Médecins du monde, et qui jugeait que la seule mort accidentelle, pour un homme de sa trempe, serait de mourir, comme tout le monde, dans son lit ?
Telles sont quelques-unes des questions que posent, chemin faisant, ces trois récits disposés en florilège.
Il y a, dans ce roman, quelque chose de L’Air de la guerre de notre contemporain Jean Hatzfeld croisé pendant le siège de Sarajevo.
Mais, ici, ce sont trois guerres, un enterrement et une surprise, à la fin, que je laisse au lecteur le soin de découvrir.
Roussel décrit, comme peu d’autres, le bleu d’un ciel, la solitude des questions sans réponses, les adieux qui font rougir les yeux, les chimères de la nuit qui peuplent le long ennui des jours, le bruit sec des balles sur la façade d’un hôtel à Beyrouth, les massacres à la hache ou à la pioche, l’héroïsme que l’on fuit, in fine, comme une partie de poker trop bien engagée, ou une mort en direct qui est aussi un trésor de guerre.
Décidément, il a eu raison de franchir le cap.
Je l’affirme ici, à Soumy, dans l’est de l’Ukraine où je le lis et écris : il est bien romancier, et il convient, toutes affaires cessantes, de le lire.