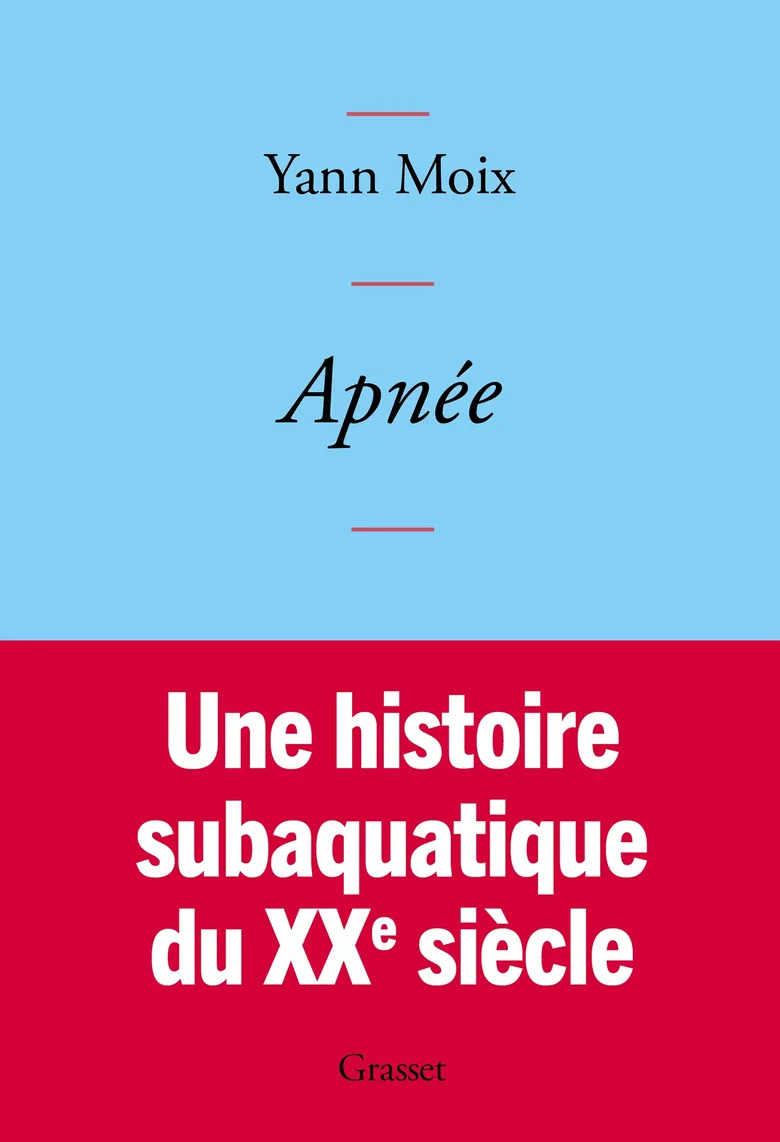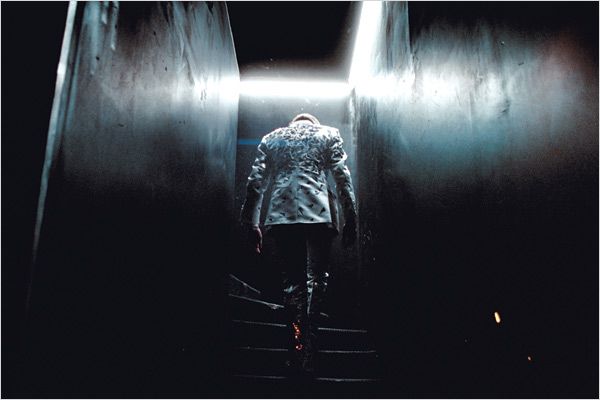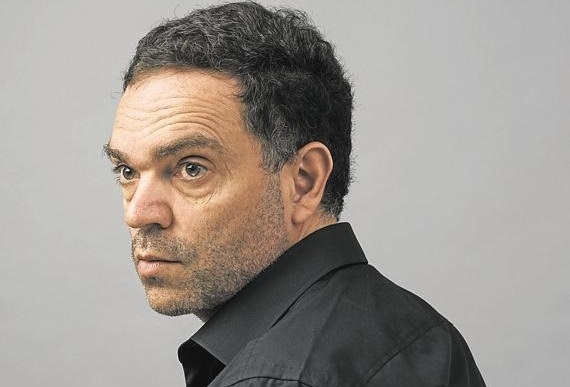Yann Moix est toujours là où on ne l’attend pas. Dernièrement, il nous avait surpris avec Visa, dialogue fictif entre un représentant nord-coréen et lui-même, dont le format court et le burlesque tranchaient par rapport aux plus de mille pages et la richesse réflexive de son journal intime de l’année précédente, Hors de moi. En cette rentrée littéraire de janvier, il continue de veiller à ce que son œuvre n’enferme son nom dans aucune étiquette générique, en nous proposant Apnée, un roman en alexandrins. Son tour de force n’est pas de se contenter de ce seul exploit stylistique – qui se lancerait dans une telle entreprise aujourd’hui ? –, lequel eût pu rester un exercice purement formel, mais de nous entraîner dans une aventure textuelle inédite : si le narrateur et sa bien-aimée explorent les profondeurs sous-marines, c’est pour faire la rencontre des figures marquantes du XXe siècle, et de ce contact avec l’immémorial, laisser infuser dans l’écriture aussi fluide que le courant, aux rayons aussi lumineux et aveuglants que ceux qui fendent l’eau et font se rejoindre le ciel et l’abîme, la vocation même de la littérature : une réponse vibrante à l’appel de l’éternité, qui redonne vie à ce qui s’est perdu – le génie, l’amour de la langue, l’ouverture au silence de l’invisible étrangers à notre époque. Apnée est cette résistance-là, cette conversion du regard et des mots, qui ne font que confirmer que Yann Moix est bien le maître de l’inattendu : celui qui permet mieux que nul autre d’attendere, de « tourner son attention » vers l’Être oublié.
Lire Apnée revient effectivement à retenir son souffle, comme on ferait ce que l’on appelle dans la tradition philosophique une epochè, autrement dit une mise en suspens de toute forme de jugement et croyance pouvant avoir une influence sur la perception en jeu – ici, tout ce qui provient du temps présent : l’obscurité est totale, les sons s’évanouissent, la vision et l’ouïe se confondent dans le seul pouls des vers dont l’intensité augmente au fur et à mesure des paliers atteints. Jankélévitch disait dans une conférence, reprenant Bergson : fermez les yeux, et ce qu’il vous reste, ce sont bien les battements du cœur, la vie à son état pur ; cela prouve que le néant n’existe pas. Plongez, rajoute-t-on, et ce qui vous semblait disparu à la surface se révélera dans l’éblouissante clarté des abysses : l’élan créateur dans son absolue singularité, cette vie dans et par la parole à la chair immortelle. Le parcours des deux personnages tient à la recherche non seulement de cette origine qui n’a plus sa place aujourd’hui, mais aussi, par cette (re)trouvaille, à la volonté d’y imposer coûte que coûte son impossible présence. Les alexandrins portent cet impétueux désir d’un nouveau langage ; leur nerf poétique, conformément à l’étymologie de « poésie », est une récréation du monde, à travers laquelle les apparitions de Kafka, de Rossellini ou d’Elvis, la confession de Léon Bloy, le portrait de Sartre, en passant par l’énumération impressionnante des multiples espèces de la faune décrite – cabot, natice, hermodice, surmulet, gouane… – sont autant de « bulles » comparables, nous dit le narrateur, aux balbutiements des « nouveau-nés ». Ces « bulles » nous enveloppent, nous portent, et nous mettent progressivement à bas : chacune d’elles en convoque une autre, et nous absorbe un peu plus dans ce ventre de l’inouï duquel on sortira autre. En elles se déploie ce procédé unique, celui d’une maïeutique littéraire : l’accouchement d’une pensée et d’une sensibilité insoupçonnées, et dont cette expérience subaquatique est la grâce.
Une renaissance, qui est le fait d’un dédoublement : ce n’est pas un hasard si on a d’emblée affaire à une référence directe à La Doublure de Raymond Roussel. Cet ouvrage de 1897 est également un roman en alexandrins, qui comporte la même phrase liminaire que celui que l’on a entre les mains (« Ce livre étant un roman, il doit se commencer à la première page et se finir à la dernière »), et a pour histoire l’itinéraire d’un comédien ne dépassant pas son salut de « doublure ». S’offre dès lors à nous une puissante mise en abyme : Apnée en double formel de La Doublure, avec, dans le même temps, le double sous-marin conquis par le narrateur en dépassement de l’échec de son prédécesseur à être autre, justement, que sa doublure. Voici précisément le « défi » que lui lance le fantôme de Roussel : « Remonte à la surface, / Et commence ton labeur, ton travail de chien : L’envers de ma Doublure – et mène-le à bien ». « L’envers de ma Doublure », ce qui la renverse : là où fusionnent l’abîme de l’écrit et l’abîme des sens, la littérature-mère et l’infini de la mer, là où « parvient / A s’établir tout un cosmos dont on retient / Miraculeusement chaque détail (…) » – la naissance de l’autre. Autre que celles et ceux qui ne sont que des doublures inauthentiques dans leur existence, autre que le masque dont nous affuble la scène publique, l’autre qui est le véritable soi : « une vie dont le Beau est le centre ».
D’où le contraste entre cette profondeur préservée et l’« affreuse odeur de poubelle » du rivage, « la vermine (…) des réseaux sociaux », les « Esprits, écrivains nuls, pigistes abêtis / Humoristes du matin, pourrissant la France – / Et tant d’autres pays. Menaces, malfaisance / Ragots, excès de nitrites dans nos jambons / Vedettes plus périssables que des bonbons » qui le polluent. A la surface, ce qui attend les deux protagonistes sont « le ciel sale », la pluie, le vent. Apnée est un geste de survie pour faire face à l’hostilité, aux tempêtes contemporaines ; plonger – dans le moi profond, l’inconnu mémoriel qui le relie à plus grand que lui – est ce sursaut souverain qui nous sauve instamment. Le voyage ne s’arrête pas là, il doit être incessamment repris – tel est son sens : ce qu’il signifie, et la direction qu’il nous adresse. Le récit se clôt sur ce vers : « Bientôt s’annonce une rafale ». « Le vent se lève ! Il faut tenter de vivre ! », renchérirait avec sa célèbre phrase Paul Valéry. Tenter de vivre dans ce monde qui est le nôtre, se laisser imprégner par ce pneuma de l’inactuel, laisser respirer cet « esprit » en nous lors de l’apnée – esprit des Esprits qui nous oxygène, oxygénation qui permet cet évènement de la venue-à-soi : « La parole du passé est toujours parole d’oracle : vous ne la comprenez que si vous devenez les architectes du futur et les interprètes du présent ». Apnée reprend formidablement ces mots de Nietzsche à son compte, perçant le voile opaque du présent, s’abreuvant de la source de l’avenir pour lui donner un corps à travers la transcendance de sa parole-dévoilement. Finalement plus qu’une renaissance, le roman de Yann Moix est cette réincarnation de ce qui n’a pas encore eu lieu : une « réalité sur mesure », selon sa propre expression au sujet de Raymond Roussel, qui est la contrée ontologique où, par cette mesure confondant les mètres de l’eau et des vers, le destin des grandes figures du passé est l’enfance d’une destinée.