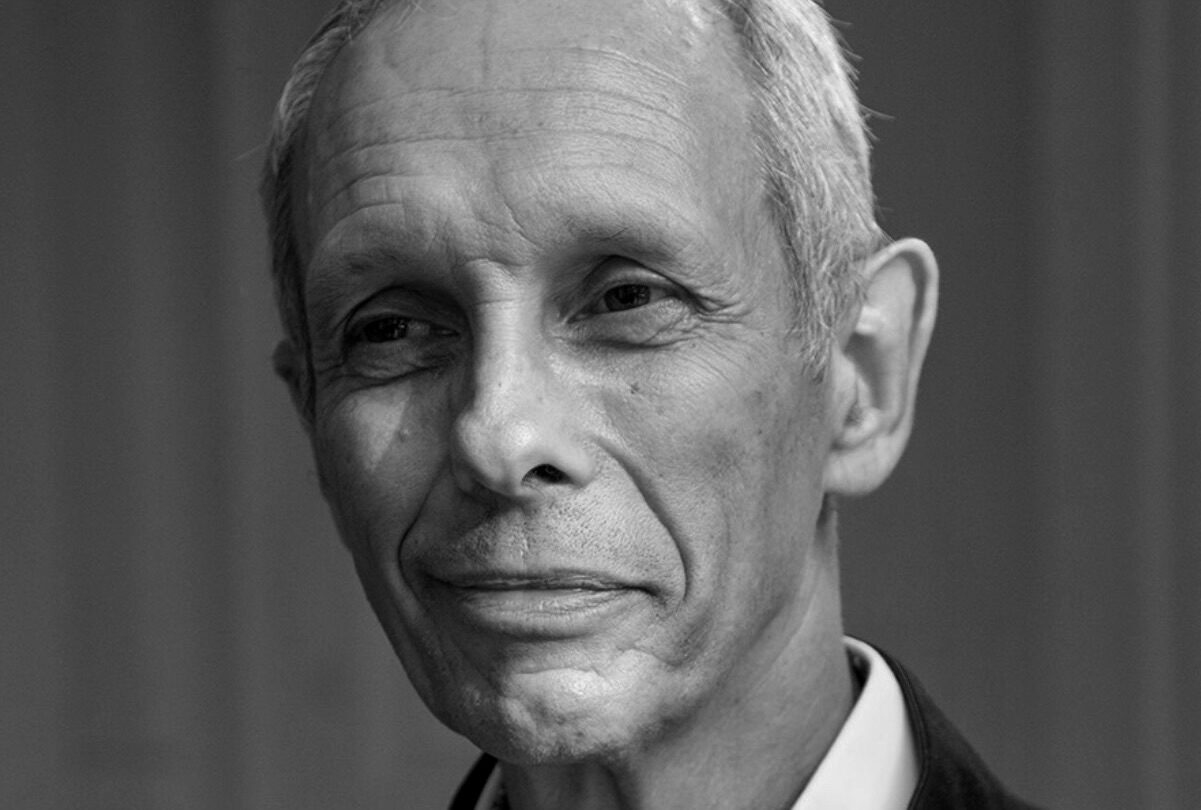Commençons par une précaution de méthode : il est toujours hasardeux de vouloir analyser une affaire judiciaire, surtout si l’on y cherche un miroir de quelque réalité sociale.
Sous le coup de l’émotion, de l’absence de recul voire de la révolte, le risque est omniprésent d’un commentaire qui court-circuiterait la singularité propre à chaque « cas » pour en tirer un diagnostic général, enjambant à l’aveugle le hiatus qui sépare l’universalité du concept de la matière des faits, aussi tragiques soient-ils. Face aux drames, aux horreurs, aux crimes qui peuplent les journaux, la tentation est grande de passer de l’indignation intemporelle de la métaphysique – « comment est-il possible d’agir aussi mal ? » – à la colère politique : « pourquoi notre société tolère-t-elle de telles horreurs ? » De la particularité intrinsèque au judiciaire, on passe à la généralité politico-morale. Glissement en apparence parfaitement légitime, mais qui opère en douce une déduction douteuse : si, dans tel ou tel village, X assassine Y, c’est l’époque tout entière qui devrait par principe se remettre en question. Trop laxiste, impuissante face à la montée de l’insécurité, « ensauvagée » disent désormais certains jusqu’au sommet de l’État, en proie à la « culture de l’excuse », elle n’aurait rien fait pour empêcher ce crime. Alors, obnubilé par l’effet zoom du drame, on l’accuse en bloc. On disserte sur la maladie qui la ronge. On traque les symptômes de sa violence larvée. La voix alarmiste, on proteste contre sa passivité face à la montée du Mal. Et, avec l’assurance que semble conférer cette déduction implacable, on donne libre cours à la « volonté de punir » pour en prôner des solutions radicales : un tour de vis sécuritaire, un tournant répressif, une sanction exemplaire.
De l’affaire Papy Voise à celle de Palmade, cette mécanique d’extrapolation déguisée en syllogisme fonctionne à plein régime. Mi-vautour mi-elle-même incendiaire, elle flaire l’odeur de la souffrance pour la multiplier. Chaque fois, son dispositif est toujours le même : surfer sur l’horreur d’une situation, faire fi de sa singularité en instrumentalisant la colère qu’elle suscite et forcer l’opinion publique à s’y réverbérer – comme si les lecteurs de journaux devenaient responsables du drame par simple contamination informationnelle.
Or, en dehors de ce sensationnalisme qu’elle agite à tour de bras, cette machine discursive repose sur une mystification. Dans un texte datant de 1807 et intitulé Qui pense abstrait ?, Hegel a montré que l’abstraction est moins l’affaire de la métaphysique que des commentateurs de faits divers. Tandis qu’ils croient que leur esprit s’enracine dans des données palpables (tel meurtre commis par Monsieur X dans le village Y), ils ne font que projeter sur ces dernières des concepts découpés à l’avance, qu’ils plaquent violemment sur le réel en érodant toute la dentelle de sa complexité. Ainsi, ils réduisent les protagonistes des affaires judiciaires à des rôles aussi figés que des masques de cire. L’assassin, dans son prisme, est l’étrange substantif de cette rhétorique. Ce nom ne désigne pas un être humain, doté d’une existence où s’insère son crime, mais un caractère essentialisé, limité à l’action qu’il a commise. « C’est avoir pensé abstraitement, écrit Hegel, de n’avoir vu dans l’assassin rien d’autre que cet abstrait qu’il est un assassin et anéantir en lui, avec cette qualité simple, tout le reste de son essence humaine. » Un raccourci causal se substitue ici à l’explication ou à la narration : si X a tué, c’est parce qu’il est un tueur dans l’âme, comme si la praxis se déduisait d’un éthos prédéterminé. De là à convoquer l’imaginaire du monstre, de la barbarie ou de la sauvagerie pour rendre compte des crimes ou dissiper le problème du Mal, et voici que le récit du fait divers auto-entretient la vacuité de sa répulsion fascinée envers une violence transformée en spectacle.
N’est-ce pas la notion de « fait divers » qui est viciée en soi ? Nous retrouvons ici la critique, élaborée par Bourdieu dans Sur la télévision, de ce signifiant creux. En rangeant sous la catégorie du « divers » toutes les informations qui ne rentrent pas dans des rubriques thématiques (politique, économie, juridique, international…), le champ médiatique les placerait moins sous l’égide de la diversité que de la diversion. Le « presque rien » de ces faits « omnibus », à force de dépolitiser leur mise en lumière au profit d’une narration centrée sur leur dimension exceptionnelle et monstrueuse, servirait à « attirer l’attention » sur des sujets destinés à « écarte[r] les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques ». Aux faits sensationnels, au récit des affaires judiciaires, il faudrait préférer, pour garantir la qualité du débat public, l’analyse de tendances statistiques : des données froides, objectivées, permettant d’analyser tel ou tel sujet en prenant du recul.
D’où la prudence qu’il faudrait adopter, en règle générale, pour commenter un crime, quelle que soit sa nature. Non sous l’effet d’un quelconque déni, mais au contraire au nom d’une sorte de tremblement face aux dégâts que pourrait engendrer le discours face à l’impensable réalité du Mal. Car les mots, surtout s’ils se drapent derrière l’alibi de la littérature, auraient ce pouvoir funeste de dénaturer ce qu’ils prétendent décrire. On se souvient de « Sublime, forcément sublime Christine V. », l’article où Marguerite Duras, sans avoir enquêté, sans s’être documentée, sans avoir rencontré la femme qu’elle accusait, feignait d’avoir cerné la vérité de la mort du petit Grégory, ce crime dont elle « cri[ait] » qu’elle y « cro[yait] » « au-delà de toute raison ». Comme s’il suffisait de crier ou de croire pour que la parole fasse œuvre de justice. C’est ce danger qu’il s’agi- rait de conjurer quand l’écriture s’invite dans les prétoires. Car son commentaire n’est jamais aussi périlleux que lorsqu’il s’empare telle quelle de la substance des crimes.
Si j’ai rappelé ces « principes de précaution » en préambule de mon article sur l’affaire Pelicot, ce n’était pas pour les imposer à l’appréhension de cette dernière, mais au contraire pour les mettre à l’épreuve – pour les interroger, sinon les accuser, à la lumière du procès qui s’est ouvert en septembre dernier, au tribunal d’Avignon, pour juger les viols dits de Mazan. Car, tout au long de ce procès-fleuve, il s’est produit un phénomène qui contredit à lui seul la thèse de Hegel ou celle de Bourdieu. A travers l’horreur qu’elle a suscitée, à travers l’importance croissante qu’elle a prise dans les médias et sur les réseaux sociaux, l’affaire Pelicot a déclenché, à travers l’opinion – française et internationale –, non seulement un cri unanime de condamnation, mais aussi une vague d’introspection, un véritable examen de conscience sur une série de questions, bel et bien politiques, qui peinaient pourtant à gagner les consciences. La question de la culture du viol. De la dimension systémique des violences sexuelles. Des lacunes de la justice face à cette structure de la domination patriarcale. De la construction sociale d’un schème toxique de la masculinité. Tous ces termes étaient certes opératoires dans le débat public, mais leur présence restait considérée, par beaucoup, comme précisément abstraite. C’est que le débat public n’y voyait précisément, tels qu’ils résonnaient à ses oreilles, que les linéaments d’une théorie : une doctrine parmi d’autres, sujette à caution, voire à controverses, qui peinait à s’imprimer sur l’agora virtuelle ou réelle de nos démocraties. Face à elle, un autre paradigme entendait continuer de régner sinon en maître, du moins en mentalité implicitement admise : l’idée, aux allures trompeuses de lapalissade, selon laquelle les violences sexuelles, n’incriminant pas le patriarcat dans son entier, ne concernaient qu’une minorité de ses représentants – ceux qui les commettaient.
En se heurtant à l’insupportable réalité de l’affaire Pelicot, cette tautologie de façade s’est fracassée au grand jour. Par millions, les Français ont découvert l’insoutenable dispositif inventé par Dominique Pelicot. Sous ses masques de mari idéal et de père attentionné, cet homme a méticuleusement organisé et commis d’innombrables viols en droguant son épouse, et en faisant croire à leur entourage qu’elle était « fatiguée » ou « souffrante » afin de la livrer à des internautes qui ont sciemment abusé d’elle alors qu’elle était inconsciente. Ce système inimaginable aura sévi pendant des années entières sans qu’aucun de ses membres n’ait songé à mettre fin au calvaire de Gisèle Pelicot. Comment est-il possible que, parmi les milliers d’utilisateurs du site « Coco » qui apprirent ou devinèrent l’existence de ces viols en série, aucun n’ait songé à les dénoncer à la police, ne fût-ce qu’anonymement ? Comment est-il possible qu’à l’inverse, des dizaines d’entre eux aient répondu positivement à cette proposition ?
La réponse se trouvait sur le banc des accusés. Car ce dernier, comme l’a noté Lola Lafon, tordit le coup à la mythologie du « monstre », dans la mesure où il constituait un échantillon représentatif de la société française. On y trouvait des hommes de tous les horizons, de tous les âges, de tous les milieux sociaux et de tous les profils. Des riches et des pauvres. Des jeunes et des vieux. Des pères de famille et des célibataires. Les homme que tout séparait, sinon ce point commun : tous avaient vu, sur internet, l’annonce où Dominique Pelicot leur proposait de violer son épouse « à son insu » ; aucun n’avait vu d’objection à cette situation; tous avaient accepté, estimant que le mari était propriétaire du « consentement » de son épouse ; tous s’étaient rendus au domicile en question ; aucun d’entre eux n’avait reculé devant l’évidente soumission chimique de Gisèle Pelicot ; et la plupart d’entre eux, face à l’évidence des preuves filmées qui les accablaient, continuaient de plaider non-coupable.
Face à cette spirale, il était impossible de s’en tenir à l’abstraction dénoncée par Hegel ou au sensationnalisme critiqué par Bourdieu. Non, l’observation tautologique selon laquelle ces violeurs étaient des violeurs ou des criminels ne suffisait pas, car elle ne répondait pas à la question que soulevait cette affaire : comment expliquer que, parmi les centaines de protagonistes impliqués (incluant donc les internautes qui refusèrent de violer Gisèle Pelicot sans dénoncer pour autant l’annonce de son mari), il ne se soit pas trouvé un seul homme qui ait interrompu cette mécanique du viol ? Comment comprendre qu’à l’exception du vigile de supermarché qui surprit Dominique Pelicot en train de filmer sous les jupes des clientes, la masculinité tout entière se soit rendue ou bien complice ou bien indifférente face à ce système de prédation sexuelle ? Certains observateurs invoquèrent la notion de « banalité du mal », forgée par Hannah Arendt lors du procès d’Eichmann pour théoriser l’idée selon laquelle la barbarie résultait d’une absence de pensée. D’autres comparèrent ce dispositif à l’expérience de Milgram, destinée à montrer comment la pression peut pousser des individus à la cruauté. D’autres encore se demandèrent si tous les hommes (le fameux all men) ne devaient pas se sentir « coresponsables » des viols de Mazan. C’était oublier que, dans l’affaire de Mazan, la criminalité sexuelle n’advenait pas de nulle part. Elle naissait précisément d’un arrière-plan symbolique et social, d’une représentation explicite ou latente du corps féminin et de la sexualité, en somme d’une mentalité opératoire dans le discours des accusés et parfois même de leurs avocats : cette vision de la femme perçue comme objet d’un désir prédateur et non comme sujet de désir consentant.
Car voici l’autre question de ce procès : en plus de refléter notre époque, agira-t-il sur elle ? Puissions-nous l’espérer. Car, en ayant le courage inouï de refuser le huis clos, c’est un miroir que Gisèle Pelicot a voulu tendre à notre société. Le travail consciencieux des journalistes qui ont rapporté en direct ce qui advenait au tribunal a permis à l’opinion publique de regarder enfin l’évidence : de voir combien la violence sexuelle résultait d’une culture bel et bien structurelle, autant dire globale, de la sexualité vécue et valorisée comme dépossession d’autrui. Une culture dominante de la domination, dénoncée depuis MeToo et pourtant persistante, dont le continuum continue de régir les rapports humains. Une culture dont l’étendue totalisante s’est révélée à Mazan. Une culture dont le dévoilement doit, désormais, engager chacune des consciences que cette affaire a bouleversées.