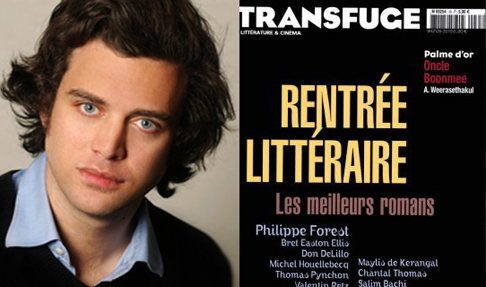Parfois on cueille les mots et parfois ce sont les mots qui nous cueillent. Et lorsque l’on est pleinement cueillie, cela relève de la grâce. Une grâce puissante qui vous emmène jusqu’au fin fond de vous-même. Cette intensité littéraire rare et si précieuse, Emma Becker me l’a offerte. Au travers de Mr, de L’inconduite, d’Odile l’été ou encore du Mal joli, j’ai passé mon mois d’août hantée par les tourments de ces œuvres dont je percevais chaque éclat de cœur et dont les abîmes vibraient contre les miens. Les mots disent la grandeur des sentiments, la difficulté à s’aimer, la vie intense plus que tout, l’addiction au regard de l’autre et le regard sur soi, le sublime dans le banal, la liberté que l’on paye au prix fort. Emma Becker, le temps de quelques livres, a ouvert ces portes que l’on ne soupçonne pas et qui deviennent soudainement indispensables. Emma a déboulé dans ma vie, elle m’a transformée, et il fallait qu’elle le sache.
Le coup de cœur a assez vite pris la route du coup de tête et m’a emmenée dans un colloque près de Tours : La Forêt des Livres. Un aller simple, aucune idée de comment rentrer, mais tout cela n’avait aucune importance, vous comprenez, il y avait urgence. Je l’ai vue, je lui ai parlé, j’étais émue. Elle aussi, un peu, je crois. Je lui ai proposé un entretien. Rendez-vous est pris un mardi matin, aux abords de Saint-Germain-des-Prés.
Au fond de la cour, bâtiment deux, un visage sort de la porte soudain ouverte : « Vous allez bien ? J’ai un café saveur noisette : ça vous dit ? Vous voulez manger quelque chose ? On se met ici, ça vous va ? »
Elle porte une robe légère aux couleurs douces, me regarde avec ses yeux emplis de malice et de curiosité, parle de désir, d’une montée d’escaliers, de transmission, de culpabilité, d’amour et de famille, fume une clope, m’en propose une, verse quelques larmes quand on évoque son grand-père. La grâce puissante, c’était elle.
Entretien
Le mal joli est une autofiction où se déchirent amour et culpabilité… Ce livre vous a-t-il libérée ?
La culpabilité et la haine de soi, non, je ne m’en libère pas – la preuve : je continue à écrire des livres. Mais je crois que le processus d’essayer de se libérer est déjà une libération. C’est performatif. On écrit un livre pour se libérer, donc, de fait, on est libéré. En revanche, la culpabilité que j’évoque, par rapport à mes enfants et mon mari, elle est toujours là et je pense qu’elle le sera toujours parce que je sais que mes errements et mes doutes auront jalonné l’enfance de mes petits. La culpabilité est inhérente à la condition humaine et je pense qu’une mère qui ne se sent pas coupable est certainement une moins bonne mère qu’une mère qui vit avec ce moteur : « Que puis-je faire de plus pour me faire pardonner ce soir où je n’étais pas là ? » C’est cela, le boulot d’une mère : c’est essayer de faire en sorte que la culpabilité mène à faire quelque chose de mieux que la veille.
Alors, au contraire, ce livre vous a-t-il rendue encore plus coupable ?
Je me sentais coupable au sens où il fallait que je m’isole des miens pour écrire un livre où je parlais justement de ce que je faisais en douce quand ils avaient le dos tourné. Et ensuite, quand on pense que le livre va sortir et donc que le monde entier va être au courant, comment est-il possible de se libérer ? On a une autre culpabilité. Mon mari, bon gré mal gré, vit avec une femme qui parle de la vie qu’elle mène, parfois en secret, puis qui le raconte à toute la France… Donc bien sûr qu’il y aura toujours en moi cette culpabilité de femme qui se sert des gens qu’elle aime pour en faire des livres. Ce genre d’écrivain, c’est un peu monstrueux, je ne peux qu’être bourrée de culpabilité.
Vous avez écrit Le mal joli au moment même où vous viviez cette histoire : comment perceviez-vous les retombées de sa publication ?
Quand on écrit un livre, on sait qu’entre le moment où on l’écrit et le moment où il sera publié, il se passera à peu près un an. C’était le délai que nous nous étions fixé avec Antonin pour prendre une décision, pour voir si ce n’était qu’un coup de sang ou s’il y avait vraiment une histoire là-dessous. Quand j’écris un livre, c’est toujours à peu près la même chose : je suis dans une espèce d’état d’impunité jusqu’à ce que je reçoive les premières épreuves. Mais étrangement, je n’ai jamais la tentation de me dire que je vais enlever des passages. J’ai eu des moments où je me suis demandé s’il ne fallait pas mieux que j’écrive à la troisième personne, mais cela ne marche pas, ce n’est pas ce que j’écris. Les lecteurs verront très vite que c’est ma vie et ils vont se dire que j’ai envie de la cacher. Autant dire un je franc et massif, et s’excuser. Mieux vaut s’excuser d’avoir eu trop d’audace que de s’excuser d’avoir l’air un peu piteux car la couverture n’a pas marché.
Concrètement, comment écrivez-vous, notamment en tant que mère ?
Mes enfants me font la grâce d’être des enfants et me ramènent donc de force dans la vraie vie. C’est dans la vraie vie que l’on écrit, ce n’est pas dans un monde de rêverie. C’est quand on est attablé dans un PMU, qu’on a une heure devant soi et qu’il faut en faire quelque chose. Je me plains toujours de mes enfants et du temps que cela me prend, mais sans mes enfants je n’aurais pas écrit les livres que j’ai écrits. Mes enfants me donnent la possibilité d’écrire ce que c’est que d’être une femme, une mère, qui n’a plus que quelques heures à elle pour avoir sa vie. Je crois que lorsqu’on n’a pas le choix, on se trouve d’incroyables ressources.
L’écriture vous a-t-elle permis de comprendre ce que vous ressentiez, et par conséquent de vivre l’histoire d’amour dépeinte dans le livre ?
Le prétexte que je me suis trouvé pour vivre cette histoire, c’était que j’écrivais un livre. J’avais très peur, en écrivant à chaud, que ce soit niais, car l’amour est le degré zéro du recul. Mais dans ce manque de recul, il y avait quelque chose de vrai : l’état dans lequel on est tous quand on est amoureux. C’est la mort des responsabilités, c’est anticonstructif, même antisocial, au sens où brusquement on déteste tout ce qui n’est pas l’autre. La seule chose qui me restait et que j’aimais, c’était l’écriture, parce que c’était le temps où je le retrouvais.
Les deux personnages sont écrivains et tiennent une correspondance. Les mots échangés rendent-ils l’amour plus intense ?
On s’est inventé un langage qui était à la croisée du mien et du sien. Cela a toujours été un fantasme d’être avec un homme qui comprenne ce que je fais. Je crois que lorsqu’on est écrivain, il n’y a pas beaucoup de gens qui comprennent comment votre travail fonctionne. Ils sont souvent très intimidés par la mécanique de l’écriture ; et il faut ajouter à cela que je n’écris pas n’importe quel genre de bouquins. Toute ma vie, j’ai eu autour de moi des hommes qui ont eu très peur de ce que j’écrivais ; mais là, je me suis retrouvée face à quelqu’un qui n’avait jamais eu peur et qui était au contraire très flatté que j’écrive sur notre histoire. Pour une fois, j’avais l’impression d’être comprise et de ne pas être cette espèce d’écrivaine sulfureuse. Il comprend mes tempêtes et nous cohabitons très bien, car nous partageons ce même travail un peu mystérieux. C’est essentiel de partager la même langue quand elle est aussi importante dans nos vies.
Dans votre livre, vous évoquez un sentiment de « manque de légitimité » face à Antonin, qui fait partie du monde littéraire de Saint-Germain-des-Prés… Mais vous aussi vous êtes écrivaine, et à succès, alors d’où vient ce « manque » ?
Je n’ai jamais habité à Paris. J’ai grandi en banlieue, et une fois adulte j’ai vécu à Berlin et dans le sud de la France, mais je n’ai jamais été une écrivaine germanopratine. Quand j’ai rencontré Antonin, je m’amusais de son monde, je trouvais cela très exotique ; mais quand je suis tombée amoureuse, j’ai eu autour de moi tout un tas de gens qui me disaient que nos milieux étaient incompatibles. Ce n’était pas contre moi, mais j’étais trop libre, on ne m’accepterait pas. L’aristocratie, c’est un véritable monde, en revanche ce n’est pas comme la bourgeoisie. Un bourgeois aurait eu peur de ce que j’aurais écrit dans ce livre ; Antonin, il s’en fiche, il n’a rien à perdre, cela fait vingt-cinq ans qu’il est dans ce petit monde-là, cela lui coule dessus. Et puis ce monde-là m’attirait aussi, il doit toujours y avoir une petite fille en moi qui rêve d’être une princesse, et quand cette petite fille a vu apparaître ce mec avec ses deux particules, son allure et le milieu dans lequel il trempait, elle a eu envie d’en faire partie ! C’est puéril mais je n’en n’ai pas honte. Quand on accole un nom pareil au sien, on est pleine de désespoir : s’il rentre dans mon monde, ce serait une dégringolade sociale, mais moi, est-ce que je pourrais un jour faire partie du sien ? Bien sûr que la véritable aristocratie est dans les livres et la littérature, mais je me suis toujours sentie illégitime, il n’y a pas de raison que cela change.
J’ai l’impression qu’il émane de vos écrits une forme d’addiction à l’intensité : est-ce qu’écrire permet de garder auprès de soi l’intensité vécue ?
J’ai toujours trouvé que la vie était merveilleuse dans ce qu’elle me donne à écrire. Ma vie n’est pas plus exceptionnelle que celle des autres ; en revanche, je crois que j’ai une disposition d’esprit qui fait que j’arrive à trouver du merveilleux dans le banal. Je pense effectivement que j’ai écrit beaucoup de choses parce que je voulais m’en rappeler de cette façon-là. On dit toujours qu’on écrit pour mettre à mort, pour tuer ; moi je crois que j’ai bien davantage écrit pour immortaliser. Lorsque j’ai écrit mon deuxième livre, Alice, j’étais pleine de haine mais aussi pleine d’amour pour mes parents, et c’est cet amour-là que je veux conserver. Mr, c’est la même chose : j’ai eu beau le détester et souffrir le martyre, j’avais envie de garder cette intensité-là. Je crois que j’ai envie de raconter à quel point la vie banale est à plein d’égards miraculeuse.
Quand vous parlez de vos enfants, on sent énormément d’amour mais aussi une certaine forme de colère…
J’essaie de discipliner la colère en moi, mais cette colère que je ressens, je sais que mes enfants la sentent. Je me dis que si j’arrive à l’écrire, si j’arrive à raconter comment se passent les scènes, mes enfants (s’ils lisent un jour mes livres) auront sans doute un meilleur portrait de la vie de parent que celui que j’ai pu avoir, moi, des miens. Je me suis toujours posé la question de ce que les miens pouvaient ressentir intérieurement et cela a toujours été une souffrance pour moi de n’avoir qu’une facette de ces gens que j’aime : celle de parents et de grands-parents. J’aurais aimé savoir qui ils étaient comme homme et comme femme. Sûrement que je vais au-devant de ce que mes enfants auront envie de savoir de moi, je ne crois pas qu’ils aient envie d’en savoir autant ; mais s’ils peuvent lire ces passages qui parlent d’eux, peut-être qu’a posteriori ils se diront : non, elle ne nous a jamais détestés, elle était juste bourrée de tout un tas d’émotions, ce qui fait qu’à certains moments nous lui étions insupportables. Je pense que c’est une vérité qui est encore sacrilège et je ne crois pas qu’elle doive l’être ; c’est tout à fait normal.
On vous associe très souvent à l’image d’une écrivaine sulfureuse. Avez-vous l’impression qu’on ne comprend pas ce que vous faites ?
On a du mal à catégoriser ce que j’écris. Si l’on s’ôtait de la tête cette idée d’autrice érotique, on se rendrait compte que je parle plutôt d’amour et de relations entre les gens que d’érotisme. Il se trouve que les histoires que je raconte sont souvent des histoires d’amour, donc il y a du sexe, c’est normal, c’est un phénomène de la vie. Je crois que l’on s’empresserait moins de faire un auteur érotique d’un homme qui écrirait à peu près la même chose que moi. Mais je pense que les gens qui me lisent me comprennent. Simplement, il est encore compliqué de considérer comme un écrivain « normal » quelqu’un qui s’empare de sujets comme ceux dont je m’empare. Ce que je trouve très intéressant, c’est l’écart entre le traitement dont je fais l’objet dans les médias et, par ailleurs, ce que les gens me disent quand ils viennent me faire signer leurs livres. Ils me racontent des histoires d’une intimité folle, ils me font des confidences ahurissantes. Mais je tiens quand même à tempérer ce que je viens de dire, parce que plus je publie de livres, plus il y a de journalistes autour de moi qui tendent à me faire sortir de cette catégorie d’autrice érotique. Je pense que le malentendu se dissipe peu à peu. Lorsque je lis les articles qui ont paru sur Le mal joli, je suis assez contente – et je viens d’apprendre que je suis sur la liste du prix des Deux Magots ! Et puis, je ne me plains pas d’avoir cette image sulfureuse, c’est aussi ce qui pousse les lecteurs à acheter mes livres…
On vous compare à Catherine Millet, notamment en établissant un parallèle avec La vie sexuelle de Catherine M., alors que sa manière d’écrire le sexe est si différente de la vôtre…
Catherine Millet, effectivement, ce n’est pas du tout la même chose. Les gens n’ont que cette référence, dans l’actualité, d’une femme qui parle de sexe. Catherine Millet écrit de manière très clinique, ce qui n’est pas mon cas. Cela dit, quand j’ai lu La vie sexuelle de Catherine M., j’ai été fascinée par la division qu’elle opérait entre son corps et sa tête. Elle était capable de coucher avec cinq hommes, cela ne lui faisait rien, mais elle allait en tirer quelque chose de littéraire. Et je sentais cette même division en moi : je me disais que physiquement je ne ressentais pas grand-chose mais que j’avais envie de le raconter.
Est-ce que vous écrivez votre désir ou sur le désir (le désir en soi) ?
Je crois qu’on a toujours envie d’écrire sur le désir mais qu’on écrit toujours son idée du désir. On n’écrit pas sur le désir en soi, on écrit sur la représentation qu’on a du désir. Le désir est beaucoup plus facile et envoûtant à écrire que le plaisir. La montée des escaliers est toujours plus intéressante à raconter que ce qu’il se passe en haut dans la chambre – et c’est peut-être même plus intéressant à vivre… C’est comme parler du bonheur : c’est toujours moins facile de parler du bonheur que des problèmes, parce que le bonheur, on sait tous ce que c’est. C’est un travail assez difficile car il faut réussir à parler au plus grand nombre en ne parlant que de soi. Mais si l’on commence à vouloir parler à tout le monde, je pense que l’on ne parle à personne. On parle aux gens à partir du moment où l’on part d’une toute petite expérience personnelle et que chacun en fait son beurre.
Et ce désir de parler aux lecteurs, est-il satisfait lorsque vous avez finissez vos livres ?
Non. Certes, on est quand même porté par l’idée d’écrire quelque chose qui va parler aux autres, parce qu’on a tellement besoin qu’on nous écoute et qu’on nous soigne que l’on se dit qu’il y a peut-être des gens qui sont dans la même situation. Personne ne mérite une médaille de vertu pour vivre une histoire extraconjugale ; en revanche quand on écrit cette histoire, on a terriblement besoin d’aide et terriblement besoin d’en parler. Finalement, on est dans la même situation qu’une personne qui n’arrive pas arrêter l’alcool ou la drogue : tout le monde nous fait bien sentir qu’il faut que l’on arrête mais on n’y arrive pas. On a ce désir coupable en soi et l’on a envie que quelqu’un nous dise qu’il comprend. C’est à la fois horrible et délicieux à vivre. Mais je ne pense pas que la littérature doive représenter les gens exactement ; nous sommes tout à fait capables de tirer des enseignements d’un Fabrice del Dongo dans La chartreuse de Parme alors que l’on ne mène pas du tout la même existence. Il y a toujours cet espoir, quand on écrit, qu’au-delà de tout ce qui nous sépare de notre lecteur, il va percevoir quelque chose qui lui parle.
Moi, vous m’avez parlé, dans ce livre, parce que l’adultère est au service de ce qu’il y a à l’intérieur des gens, dans leur intimité, et c’est cela qui, finalement, est universel…
Je le crois aussi. D’ailleurs, un des malentendus qui me hérissent le plus, c’est l’idée que j’écris pour les femmes. Je n’écris pas pour les femmes. Je suis moi-même une femme et j’essaie de décrire l’expérience féminine de la façon la plus exhaustive possible. Je crois que l’erreur vient du fait que les hommes s’imaginent qu’il n’y a rien à tirer, pour eux, de la description de l’expérience féminine. Mais c’est faux, dans la mesure où les femmes se sont aussi bâties avec de la littérature d’hommes, qui ne parlait que de l’intériorité des hommes. Si nous avons réussi à nous bâtir nous-mêmes avec cette littérature, à nous sentir comprises dans des livres écrits par des hommes, il n’y a pas de raison que les hommes ne se sentent pas compris dans des livres écrits par des femmes. Et l’expérience féminine, c’est l’expérience d’une bonne grosse moitié de la planète qui se trouve être convoitée par l’autre moitié de la planète. Je crois même que si les hommes lisaient plus de livres écrits par des femmes, ils comprendraient mieux ce qui sous-tend notre vie intime que l’on décrit toujours comme tellement compliquée, ou notre sexualité que l’on dépeint comme un continent noir… Ce n’est pas si noir que ça, c’est juste que pendant très longtemps les hommes n’en avaient rien à faire ! Et le résultat, c’est que maintenant, notre sexualité à nous, femmes, nous est tout aussi mystérieuse qu’elle l’est pour les hommes. Pourquoi y a-t-il autant de femmes qui, comme moi, font presque frénétiquement l’amour dans l’espoir d’y comprendre quelque chose ?! C’est parce qu’on nous a toujours dit que c’était incompréhensible et que le plaisir n’était pas automatique. Mais je ne vois pas pourquoi le plaisir ne serait pas automatique. Pourquoi sommes-nous les seules à avoir un organe sexuel qui n’est fait que pour le plaisir ? En fait, on est beaucoup plus faciles à faire jouir que les hommes ! Simplement, pendant très longtemps, cela n’intéressait personne.
Toujours dans Le mal joli, vous découvrez que votre grand-père avait été le chef opérateur de Walerian Borowczyk, réalisateur polonais considéré (lui aussi !) comme sulfureux. Apprendre cette filiation vous légitime davantage ?
Effectivement, à ce moment-là c’était un peu comme m’ajouter un petit galon : je ne suis pas n’importe qui, je suis la petite-fille du chef opérateur de Walerian Borowczyk. C’est vrai que j’aurais pu m’ajouter un galon avant en disant : je suis Emma Becker, j’écris des livres. Apparemment, cela n’a pas suffi. C’est drôle de voir qu’il faut un homme dans ma famille pour légitimer mon existence artistique. Mais j’ai eu cette sensation d’une main tendue de je ne sais trop où. C’est peut-être complètement idiot mais peu importe, pour moi ce n’est pas un hasard. Peut-être que mon grand-père a vécu ainsi, avec cette impression de faire un boulot gênant et que personne ne comprenait. Ce n’est pas que cela m’a « légitimée », mais d’un seul coup j’ai eu l’impression d’un clin d’œil de quelqu’un que j’avais passionnément aimé, et qui me disait que l’on ne s’était pas si bien connus et qu’à trente-cinq ans c’était peut-être le moment de se connaître. [La voix d’Emma se noue, ses yeux deviennent humides.] C’est quand même fou : je vais voir des films par l’œil de mon grand-père. Pour moi, cela a été quelque chose d’énorme. Quand on écrit les livres que j’écris, même si j’ai la chance d’être très appuyée par la critique et que je me sens très entourée, dans ma famille je me suis souvent sentie très, très seule, et découvrir cette facette de cet homme que l’on m’a toujours décrit comme très froid, cela m’a donné le sentiment que non, je n’étais pas là par hasard, qu’il y avait eu quelque chose et que, peut-être, ce quelque chose m’avait été transmis par lui au détour d’un câlin quand j’étais bébé. Il se peut que ce soit du sentimentalisme mais je me sens à l’orée d’une incroyable découverte sur ma propre famille. Mon grand-père était quand même celui qui mettait en lumière tous ces corps de femmes – c’est incroyable ! Je l’aurais inventé, on ne m’aurait pas crue ! C’est là qu’on se dit que la vie banale est tout de même merveilleuse. Alors c’est peut-être cela que j’essaie d’écrire : à quel point une vie banale dont on ne parlera jamais, c’est un roman.